Toute langue prétend
inventer Babel, c'est-à-dire fonder l'empire absolu des mots. Nommer, c'est
annexer, figer dans le vocable l'insupportable ondoiement des choses. « Toute
langue est fasciste », assure Roland Barthes : Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. En elle, immanquablement, deux rubriques se dessinent : l'autorité de l'assertion, la grégarité de la répétition (Leçon inaugurale). Cette puissance assertive, la langue la trouve assurément dans la répétition (mots-outils, clichés  , formules figées), c'est-à-dire dans le consentement grégaire à l'usage. Y échapper n'est pas si facile : le langage est tapi en nous, et nous dicte les valeurs qui vont avec les mots. Faire œuvre de liberté suppose ici une sécession bien plus âpre et dangereuse que ne l'est la subversion politique, car elle engage un nouvel entendement, un regard neuf capable de dégourdir les choses pour les délivrer de la gangue dont l'utilité les a revêtues. Tel est le propre de la littérature : l'écrivain a décidé d'imposer au monde son langage, non pour le figer sous de nouvelles étiquettes, mais pour lui rendre son étrangeté et nous inviter à le désigner à notre tour. Il consent au tremblement des choses où fourmillent les signes encore vierges, comme le monde tournoie sous le pinceau de Van Gogh ou vacille sous celui de Monet. Roland Barthes écrit encore : « L’écrivain […] est celui qui ne laisse pas les
obligations de sa langue parler pour lui, qui connaît et ressent les manques de son idiome et
imagine utopiquement une langue totale où rien n’est obligatoire »
(Sollers écrivain). , formules figées), c'est-à-dire dans le consentement grégaire à l'usage. Y échapper n'est pas si facile : le langage est tapi en nous, et nous dicte les valeurs qui vont avec les mots. Faire œuvre de liberté suppose ici une sécession bien plus âpre et dangereuse que ne l'est la subversion politique, car elle engage un nouvel entendement, un regard neuf capable de dégourdir les choses pour les délivrer de la gangue dont l'utilité les a revêtues. Tel est le propre de la littérature : l'écrivain a décidé d'imposer au monde son langage, non pour le figer sous de nouvelles étiquettes, mais pour lui rendre son étrangeté et nous inviter à le désigner à notre tour. Il consent au tremblement des choses où fourmillent les signes encore vierges, comme le monde tournoie sous le pinceau de Van Gogh ou vacille sous celui de Monet. Roland Barthes écrit encore : « L’écrivain […] est celui qui ne laisse pas les
obligations de sa langue parler pour lui, qui connaît et ressent les manques de son idiome et
imagine utopiquement une langue totale où rien n’est obligatoire »
(Sollers écrivain).
Le propos de cette page est d'examiner les conditions par lesquelles la langue totalitaire peut devenir cette langue totale dont parle Barthes : répétition et assertion ont été souvent illustrées (dans le roman comme au théâtre) et dénoncées (par la philosophie). Nous irons voir cela du côté de Flaubert, Ionesco et Cioran. Partant ensuite du constat de Francis Ponge, décidé à fonder une nouvelle rhétorique, nous essaierons d'examiner quelques voies d'échappement et de création.
Objets d'étude :
La question de l'homme dans les genres de l'argumentation - Les réécritures.
Corpus :
 Gustave Flaubert : Madame Bovary Gustave Flaubert : Madame Bovary
 Eugène Ionesco :
Rhinocéros Eugène Ionesco :
Rhinocéros
 Emile-Michel Cioran :
Précis de décomposition Emile-Michel Cioran :
Précis de décomposition
 Francis Ponge : Rhétorique (Proêmes). Francis Ponge : Rhétorique (Proêmes). |
 1 : La répétition. 1 : La répétition.
|
 Les signes dont la langue est faite, les signes n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus, c'est à dire pour autant qu'ils se répètent ; le signe est suiviste, grégaire ; en chaque signe dort ce monstre : un stéréotype : je ne puis jamais parler qu'en ramassant ce qui traîne dans la langue. Dès lors que j'énonce, ces deux rubriques se rejoignent en moi, je suis à la fois maître et esclave : je ne me contente pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes : je dis, j'affirme, j'assène ce que je répète. Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement.
Roland Barthes : Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France prononcée le 7 janvier 1977 Les signes dont la langue est faite, les signes n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus, c'est à dire pour autant qu'ils se répètent ; le signe est suiviste, grégaire ; en chaque signe dort ce monstre : un stéréotype : je ne puis jamais parler qu'en ramassant ce qui traîne dans la langue. Dès lors que j'énonce, ces deux rubriques se rejoignent en moi, je suis à la fois maître et esclave : je ne me contente pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes : je dis, j'affirme, j'assène ce que je répète. Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement.
Roland Barthes : Leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège de France prononcée le 7 janvier 1977   . .
|
Énoncer, c'est donc répéter, s'installer dans un monde déjà "parlé" qui nous impose ses formules et ses représentations. Le paradoxe souligné par Roland Barthes est que cette servilité manifeste aussi un pouvoir : pouvoir de s'installer avec plus d'aisance que d'autres dans un langage utilitaire, pouvoir de répéter mieux les sentences apprises et d'y fonder l'autorité d'un discours. La littérature romanesque s'est employée de bonne heure à la démystification de cette parole assertive, à commencer par Flaubert.
Gustave FLAUBERT  , Madame Bovary (1857), II, I. , Madame Bovary (1857), II, I.
Lorsque Flaubert, dans son
Dictionnaire des idées reçues  , recense les formules figées sous lesquelles ronronne le conformisme bourgeois, il continue à s'inscrire dans le projet globalement ironique qui est celui de toute son œuvre. On écoutera ici le pontifiant apothicaire M. Homais présenter à Charles Bovary la région où celui-ci va exercer ses fonctions d'officier de santé. , recense les formules figées sous lesquelles ronronne le conformisme bourgeois, il continue à s'inscrire dans le projet globalement ironique qui est celui de toute son œuvre. On écoutera ici le pontifiant apothicaire M. Homais présenter à Charles Bovary la région où celui-ci va exercer ses fonctions d'officier de santé. |
— Du reste, disait l’apothicaire, l’exercice de la médecine n’est pas fort pénible en nos contrées ; car l’état de nos routes permet l’usage du cabriolet, et, généralement, l’on paye assez bien, les cultivateurs étant aisés. Nous avons, sous le rapport médical, à part les cas ordinaires d’entérite, bronchite, affections bilieuses, etc., de temps à autre quelques fièvres intermittentes à la moisson, mais, en somme, peu de choses graves, rien de spécial à noter, si ce n’est beaucoup d’humeurs froides, et qui tiennent sans doute aux déplorables conditions hygiéniques de nos logements de paysan. Ah ! vous trouverez bien des préjugés à combattre, monsieur Bovary ; bien des entêtements de la routine, où se heurteront quotidiennement tous les efforts de votre science ; car on a recours encore aux neuvaines, aux reliques, au curé, plutôt que de venir naturellement chez le médecin ou chez le pharmacien. Le climat, pourtant, n’est point, à vrai dire, mauvais, et même nous comptons dans la commune quelques nonagénaires. Le thermomètre (j’en ai fait les observations) descend en hiver jusqu’à quatre degrés, et, dans la forte saison, touche vingt-cinq, trente centigrades tout au plus, ce qui nous donne vingt-quatre Réaumur au maximum, ou autrement cinquante-quatre Fahrenheit (mesure anglaise), pas davantage ! – et, en effet, nous sommes abrités des vents du nord par la forêt d’Argueil d’une part, des vents d’ouest par la côte Saint-Jean de l’autre, et cette chaleur, cependant, qui à cause de la vapeur d’eau dégagée par la rivière et la présence considérable de bestiaux dans les prairies, lesquels exhalent, comme vous savez, beaucoup d’ammoniaque, c’est-à-dire azote, hydrogène et oxygène (non, azote et hydrogène seulement), et qui, pompant à elle l’humus de la terre, confondant toutes ces émanations différentes, les réunissant en un faisceau, pour ainsi dire, et se combinant de soi-même avec l’électricité répandue dans l’atmosphère, lorsqu’il y en a, pourrait à la longue, comme dans les pays tropicaux, engendrer des miasmes insalubres ; – cette chaleur, dis-je, se trouve justement tempérée du côté où elle vient, ou plutôt d’où elle viendrait, c’est-à-dire du côté sud, par les vents de sud-est, lesquels, s’étant rafraîchis d’eux-mêmes en passant sur la Seine, nous arrivent quelquefois tout d’un coup, comme des brises de Russie ! |
 Repérez les procédés qui
trahissent la cuistrerie du personnage. Repérez les procédés qui
trahissent la cuistrerie du personnage.
En quoi le discours d'Homais se dévalorise-t-il lui-même, rendant inutile l'intervention du narrateur (Flaubert souhaitait être « présent partout, visible nulle part  ») ? ») ?
 2 : L'assertion. 2 : L'assertion.
La prise de parole est une prise de pouvoir : désigner le monde par les mots, c'est se l'approprier. Dans la communication, la supériorité est évidente de qui sait manier la langue et imposer son point de vue. Le monde du management et du coaching (existe-t-il des mots français pour dire cela ?) ont eu beau inventer le terme assertivité en prétendant y voir une manière de respecter l'autre tout en manifestant sa conviction personnelle, l'assertion est un énoncé autoritaire que l'on s'efforce de présenter comme vrai. La philosophie n'a pas toujours évité pareil dogmatisme.
 |
Émile-Michel CIORAN
Généalogie du fanatisme
(Précis de décomposition   ,
1949). ,
1949). [Voici pour sa part ce qu'en pense le philosophe solitaire et sceptique E.M. Cioran. Il faut dire que, d'origine roumaine, il a vu de près les horreurs des idéologies érigées en systèmes, tant par les fascistes que par les staliniens. C'est peut-être la raison pour laquelle Cioran n'a partagé aucune des illusions de son temps et s'est gardé des errements idéologiques où sombrait, par exemple, la pensée de Jean-Paul Sartre, Sartre dont on appréciera, entre mille autres, l'assertion : « un anticommuniste est un chien, je ne sors pas de là, je n’en sortirai plus jamais. »
(Situations, IV, Gallimard, 1961] |
|
Lorsqu'on se refuse à admettre le caractère interchangeable des idées, le sang coule... Sous les résolutions fermes se dresse un poignard ; les yeux enflammés présagent le meurtre. Jamais esprit hésitant, atteint d'hamlétisme ne fut pernicieux : le principe du mal réside dans la tension de la volonté, dans l'inaptitude au quiétisme, dans la mégalomanie prométhéenne d'une race qui crève d'idéal, qui éclate sous ses convictions et qui, pour s'être complu à bafouer le doute et la paresse - vices plus nobles que toutes ses vertus - s'est engagée dans une voie de perdition, dans l'histoire, dans ce mélange indécent de banalité et d'apocalypse... Les certitudes y abondent : supprimez-les, supprimez surtout leurs conséquences : vous reconstituez le Paradis. Qu'est-ce que la Chute sinon la poursuite d'une vérité et l'assurance de l'avoir trouvée, la passion pour un dogme, l'établissement dans un dogme ? Le fanatisme en résulte - tare capitale qui donne à l'homme le goût de l'efficacité, de la prophétie, de la terreur -, lèpre lyrique par laquelle il contamine les âmes, les soumet, les broie ou les exalte... N'y échappent que les sceptiques (ou les fainéants et les esthètes), parce qu'ils ne proposent rien, parce que - vrais bienfaiteurs de l'humanité - ils en détruisent les partis pris et en analysent le délire. Je me sens plus en sûreté auprès d'un Pyrrhon que d'un saint Paul, pour la raison qu'une sagesse à boutades est plus douce qu'une sainteté déchaînée. Dans un esprit ardent on retrouve la bête de proie déguisée; on ne saurait trop se défendre des griffes d'un prophète... Que s'il élève la voix, fût-ce au nom du ciel, de la cité ou d'autres prétextes, éloignez-vous-en : satyre de votre solitude, il ne vous pardonne pas de vivre en deçà de ses vérités et de ses emportements; son hystérie, son bien, il veut vous le faire partager, vous l'imposer et vous défigurer. Un être possédé par une croyance et qui ne chercherait pas à la communiquer aux autres, - est un phénomène étranger à la terre, où l'obsession du salut rend la vie irrespirable. Regardez autour de vous : partout des larves qui prêchent; chaque institution traduit une mission; les mairies ont leur absolu comme les temples; l'administration, avec ses règlements, - métaphysique à l'usage des singes... Tous s'efforcent de remédier à la vie de tous : les mendiants, les incurables même y aspirent : les trottoirs du monde et les hôpitaux débordent de réformateurs. L'envie de devenir source d'événements agit sur chacun comme un désordre mental ou comme une malédiction
voulue. La société, - un enfer de sauveurs ! Ce que cherchait Diogène avec sa lanterne, c'était un indifférent...
Il me suffit d'entendre quelqu'un parler sincèrement d'idéal, d'avenir, de philosophie, de l'entendre dire "nous" avec une inflexion d'assurance, d'invoquer les "autres" et s'en estimer l'interprète - pour que je le considère comme mon ennemi. J'y vois un tyran manqué, un bourreau approximatif, aussi haïssable que les tyrans, que les bourreaux de grande classe. C'est que toute foi exerce une forme de terreur, d'autant plus effroyable que les "purs" en sont les agents. On se méfie des finauds, des fripons, des farceurs; pourtant on ne saurait leur imputer aucune des grandes convulsions de l'Histoire; ne croyant en rien, ils ne fouillent pas vos cœurs, ni vos arrière-pensées : ils vous abandonnent à votre nonchalance, à votre désespoir ou à votre inutilité; l'humanité leur doit le peu de moments de prospérité qu'elle connut. Ce sont eux qui sauvent les peuples que les fanatiques torturent et que les "idéalistes" ruinent. Sans doctrine, ils n'ont que des caprices et des intérêts, des vices accommodants, mille fois plus supportables que les ravages provoqués par le despotisme à principes; car tous les maux de la vie viennent d'une "conception de la vie". Un homme politique accompli devrait approfondir les sophistes anciens et prendre des leçons de chant - et de corruption...
Le fanatique, lui, est incorruptible : si pour une idée il tue, il peut tout aussi bien se faire tuer pour elle; dans les deux cas, tyran ou martyr, c'est un monstre. Point d'êtres plus dangereux que ceux qui ont souffert pour une croyance : les grands persécuteurs se recrutent parmi les martyrs auxquels on n’a pas coupé la tête. Loin de diminuer l'appétit de puissance, la souffrance l'exaspère; aussi l'esprit se sent-il plus à l'aise dans la société d'un fanfaron que dans celle d'un martyr; et rien ne lui répugne tant que ce spectacle où l'on meurt pour une idée... Excédé du sublime et du carnage, il rêve d'un ennui de province à l'échelle de l'univers, d'une Histoire dont la stagnation serait telle que le doute s'y dessinerait comme un événement et l'espoir comme une calamité... |
 Partout des larves qui prêchent,
dit Cioran. Apprenons donc à les reconnaître ! Partout des larves qui prêchent,
dit Cioran. Apprenons donc à les reconnaître !
Les
formules assertives tiennent d'abord aux verbes d'opinion, que l'on emploie volontiers sans nuances. En voici quelques exemples selon que le discours veut être...
 ...péremptoire ...péremptoire
affirmer, soutenir, assurer, prétendre, souligner, ajouter, mettre en évidence, certifier, faire apparaître, mettre l'accent sur, noter, revendiquer, démontrer, proclamer ... |
 ...polémique ...polémique
déplorer, contester, nier, critiquer, objecter, réfuter, regretter, stigmatiser, s'inquiéter,
répliquer, rétorquer, s'émouvoir, s'indigner, s'alarmer, s'insurger contre ... |
 ...laudatif ...laudatif
se féliciter, saluer, proposer, conseiller, souhaiter,
espérer, louer,
préconiser, applaudir, recommander, faire l'éloge de, célébrer, prôner ... |
Le degré d'implication de l'émetteur dans son discours tient aussi aux modes ou aux temps (présent de vérité générale), aux pronoms, aux tournures, bref à tout ce qui ressortit à la modalisation de l'opinion dans le texte argumentatif (voir la page dédiée  ). Apprenons donc ainsi à modaliser, à atténuer l'expression de notre opinion de manière à se garder d'une telle intolérance ! Quels mots, quels procédés emploieriez-vous par exemple pour donner au texte suivant un registre moins assertif ? ). Apprenons donc ainsi à modaliser, à atténuer l'expression de notre opinion de manière à se garder d'une telle intolérance ! Quels mots, quels procédés emploieriez-vous par exemple pour donner au texte suivant un registre moins assertif ?
|
Examiner la place du sport dans notre société, c'est faire immanquablement écho aux nombreuses affaires qui, depuis plusieurs décennies, souillent son image. Le sport, en effet, peut-être parce qu'il est le lieu d'une exultation collective, lâche tous nos monstres : monstre du nationalisme et du fanatisme, d'abord, qui peut faire siffler des hymnes et s'affronter dans une tribune des supporters déchaînés ; monstre de l'argent, ensuite, dont la toute-puissance s'offre insolemment dans le salaire des joueurs de football et la concurrence des sponsors ; monstre de la drogue et du dopage, enfin, qu'explique le niveau toujours plus haut des performances exigées par les lois impitoyables du spectacle. A ceci, il faudrait encore ajouter les maladies chroniques d'un public qui sublime sa propre misère dans des rêves de gloire.
Bref, le sport révèle le paradoxe installé au cœur de nos sociétés matérialistes : avides de combler leur soif de spiritualité, des foules plus ou moins exaltées, victimes d'une logique mercantile, placent imprudemment leur quête dans des idoles aux pieds d'argile. Le sport est-il donc la forme de sacré que nous méritons ? |
D'origine roumaine comme Cioran, Eugène Ionesco a consacré lui aussi son
œuvre à traquer la tyrannie du langage. Ainsi dans sa pièce Rhinocéros, dont il dit ceci :
« [c'] est sans doute une pièce antinazie, mais elle est aussi surtout une pièce contre les hystéries collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison et des idées, mais n'en sont pas moins de graves maladies collectives dont les idéologies ne sont que des alibis. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais, lorsque les gens ne partagent plus votre opinion, lorsqu'on ne peut plus s'entendre avec eux, on a l'impression de s'adresser à des monstres...[...] Ils en ont la candeur et la férocité mêlées. Ils vous tueraient en toute bonne conscience si vous ne pensiez pas comme eux. Et l'histoire nous a bien prouvé au cours de ce siècle que les personnes ainsi transformées ne ressemblent pas seulement à des rhinocéros, ils le deviennent véritablement. » [Notes et contre-notes.]

|
Eugène IONESCO
Rhinocéros   (1959), acte II, tableau I.
(1959), acte II, tableau I.
[Une place dans une petite ville de province : la didascalie initiale plante le décor stéréotypé où s'installeront successivement les personnages ordinaires qui lui conviennent. L'apparition incongrue d'un rhinocéros ne perturbera pas notablement leurs échanges, d'autant que, peu à peu, ils cèderont à une contagieuse
"rhinocérite", chargée de représenter symboliquement la lourdeur de leurs préjugés, les conventions sous lesquelles se figent leurs valeurs et leurs mots. « Les gens tout à coup, écrit Ionesco, se laissent envahir par une religion nouvelle, une doctrine, un fanatisme, enfin par ce que les professeurs de philosophie et les journalistes à oripeaux philosophiques appellent "le moment nécessairement historique". On assiste alors à une véritable mutation mentale. » (ibid.)] |
|
BOTARD : Je ne crois pas les journalistes. Les journalistes sont tous des menteurs, je sais à quoi m'en tenir, je ne crois que ce que je vois, de mes propres yeux. En temps qu'ancien
instituteur, j'aime la chose précise, scientifiquement prouvée, je suis un esprit méthodique, exact.
DUDARD : Que vient faire ici l'esprit méthodique ?
DAISY, à Botard : Je trouve, monsieur Botard, que la nouvelle est très précise.
BOTARD : Vous appelez cela de la précision ? Voyons. De quel pachyderme s'agit-il ? Qu'est-ce que le rédacteur de la rubrique des chats écrasés entend-il par un pachyderme ? Il ne nous le dit pas. Et qu'entend-il par chat ?
DUDARD : Tout le monde sait ce qu'est un chat.
BOTARD : Est-ce d'un chat, ou est-ce d'une chatte qu'il s'agit ? Et de quelle couleur ? De quelle race ? Je ne suis pas raciste, je suis même antiraciste.
MONSIEUR PAPILLON : Voyons, monsieur Botard, il ne s'agit pas de cela, que vient faire ici le racisme ?
BOTARD : Monsieur le chef, je vous demande bien pardon. Vous ne pouvez nier que le racisme est une des grandes erreurs du siècle.
DUDARD : Bien sûr, nous sommes tous d'accord, mais il ne s'agit pas là de…
BOTARD : Monsieur Dudard, on ne traite pas cela à la légère. Les événements historiques nous ont bien prouvé que le racisme…
DUDARD : Je vous dis qu'il ne s'agit pas de cela.
BOTARD : On ne le dirait pas.
MONSIEUR PAPILLON : Le racisme n'est pas en question.
BOTARD : On ne doit perdre aucune occasion de le dénoncer.
DAISY : Puisqu'on vous dit que personne n'est raciste. Vous déplacez la question, il s'agit tout
simplement d'un chat écrasé par un pachyderme : un rhinocéros en l'occurrence.
BOTARD : Je ne suis pas du Midi, moi. Les Méridionaux ont trop d'imagination. C'était peut être tout simplement une puce écrasée par une souris. On en fait une montagne.
MONSIEUR PAPILLON, à Dudard : Essayons donc de mettre les choses au point. Vous auriez donc vu, de vos yeux vu, le rhinocéros se promener en flânant dans les rues de la ville ?
DAISY : Il ne flânait pas, il courait.
DUDARD : Personnellement, moi, je ne l’ai pas vu. Cependant, des gens dignes de foi…
BOTARD, l’interrompant : Vous voyez bien que ce sont des racontars, vous vous fiez à des journalistes qui ne savent pas quoi inventer pour faire vendre leurs méprisables journaux, pour servir leurs patrons, dont ils sont les domestiques ! Vous croyez cela, Monsieur Dudard, vous, un juriste, un licencié en droit. Permettez-moi de rire. Ah ! Ah ! Ah !
DAISY : Mais moi, je l’ai vu, j’ai vu le rhinocéros. J’en mets ma main au feu.
BOTARD : Allons donc ! Je vous croyais une fille sérieuse.
DAISY : Monsieur Botard, je n’ai pas la berlue ! Et je n’étais pas seule, il y avait des gens autour de moi qui regardaient.
BOTARD : Pfff ! Ils regardaient sans doute autre chose !… Des flâneurs, des gens qui n’ont rien à faire, qui ne travaillent pas, des oisifs.
DUDARD : C’était hier, c’était dimanche.
BOTARD : Moi, je travaille aussi le dimanche. Je n'écoute pas les curés qui vous font venir à l'église pour vous empêcher de faire votre boulot, et de gagner votre pain à la sueur de votre front.
MONSIEUR PAPILLON, indigné : Oh !
BOTARD : Excusez-moi, je ne voudrais pas vous vexer. Ce n'est pas parce que je méprise les religions qu'on peut dire que je ne les estime pas. (à Daisy.) D’abord, savez-vous ce que c’est qu’un rhinocéros ?
DAISY : C’est un… c’est un très gros animal, vilain !
BOTARD : Et vous vous vantez d’avoir une pensée précise ! Le rhinocéros, Mademoiselle…
MONSIEUR PAPILLON : Vous n'allez pas nous faire un cours sur le rhinocéros, ici. Nous ne sommes pas à l'école. |
 Cette dérive totalitaire, Ionesco montre bien qu'elle est d'abord - et même exclusivement - une affaire de langage. La pièce oppose par exemple à la paresse et au laisser-aller du personnage principal, Bérenger, les propos moralisateurs et stéréotypés des autres protagonistes, notamment Jean dès la première scène Cette dérive totalitaire, Ionesco montre bien qu'elle est d'abord - et même exclusivement - une affaire de langage. La pièce oppose par exemple à la paresse et au laisser-aller du personnage principal, Bérenger, les propos moralisateurs et stéréotypés des autres protagonistes, notamment Jean dès la première scène  de la pièce. Ainsi Bérenger seul échappera à la "rhinocérite", ce qui fait écho aux propos de Cioran : « N'y échappent que les sceptiques (ou les fainéants et les esthètes), parce qu'ils ne proposent rien.» de la pièce. Ainsi Bérenger seul échappera à la "rhinocérite", ce qui fait écho aux propos de Cioran : « N'y échappent que les sceptiques (ou les fainéants et les esthètes), parce qu'ils ne proposent rien.»
Ionesco écrit dans la préface de l'édition américaine de la pièce : « On s'apercevra certainement que les répliques de Botard, de Jean, de Dudard ne sont que des formules clés, les slogans des dogmes divers cachant, sous le masque de la froideur objective, les impulsions les plus irrationnelles et véhémentes. »
En quoi se vérifie ici cette indication ?
 3 : Trouver une langue. 3 : Trouver une langue.
Trouver une langue : c'était déjà le souci d'Arthur Rimbaud, comme il est sans doute celui de tout poète. Comment se satisfaire d'une langue usuelle, dont nous avons souligné le grégarisme et le sournois impérialisme ? André Breton affirme que la vraie poésie « répugne à laisser passer tout ce qui peut être déjà vu, entendu, convenu, à se servir de ce qui a servi, si ce n'est en le détournant de son usage préalable » (Préface au Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire, 1947). C'est à ce souci que correspond l'effort de l'Oulipo comme celui de Francis Ponge :
Francis PONGE
Proêmes   (1948)
(1948)
Le mot-valise proême contient à la fois les mots prose et poème, caractérisant en effet ce mi-chemin dans lequel la poésie de Francis Ponge s'est installée. Ses textes visent à la fois la clarté de l'expression et la charge poétique nouvelle contenue dans les mots les plus simples. Le texte qu'on va lire a été écrit dans les années 1929-1930 et fait figure de préalable et d'avertissement au seuil d'une œuvre décidée à secouer l'usure des mots.
|

|
|
Rhétorique
Je suppose qu'il s'agit de sauver quelques jeunes hommes du suicide et quelques autres de l'entrée aux flics ou aux pompiers. Je pense à ceux qui se suicident par dégoût, parce qu'ils trouvent que « les autres » ont trop de part en eux-mêmes.
On peut leur dire : donnez tout au moins la parole à la minorité de vous-mêmes. Soyez poètes. Ils répondront : mais c'est là surtout, c'est là encore que je sens les autres en moi-même, lorsque je cherche à m'exprimer je n'y parviens pas. Les paroles sont toutes faites et s'expriment: elles ne m'expriment point. Là encore j'étouffe.
C'est alors qu'enseigner l'art de résister aux paroles devient utile, l'art de ne dire que ce que l'on veut dire, l'art de les violenter et de les soumettre. Somme toute fonder une rhétorique, ou plutôt apprendre à chacun l'art de fonder sa propre rhétorique, est une œuvre de salut public.
Cela sauve les seules, les rares personnes qu'il importe de sauver : celles qui ont la conscience et le souci et le dégoût des autres en eux-mêmes.
Celles qui peuvent faire avancer l'esprit, et à proprement parler changer la face des choses.
[...]
Des raisons d'écrire.
I
Qu'on s'en persuade : il nous a bien fallu quelques raisons impérieuses pour devenir ou pour rester poètes. Notre premier mobile fut sans doute le dégoût de ce qu'on nous oblige à penser et à dire, de ce à quoi notre nature d'hommes nous force à prendre part.
Honteux de l'arrangement tel qu'il est des choses, honteux de tous ces grossiers camions qui passent en nous, de ces usines, manufactures, magasins, théâtres, monuments publics qui constituent bien plus que le décor de notre vie, honteux de cette agitation sordide des hommes non seulement autour de nous, nous avons observé que la Nature autrement puissante que les hommes fait dix fois moins de bruit, et que la nature dans l'homme, je veux dire la raison, n'en fait pas du tout.
Eh bien ! Ne serait-ce qu'à nous-mêmes nous voulons faire entendre la voix d'un homme. Dans le silence certes nous l'entendons, mais dans les paroles nous la cherchons : ce n'est plus rien. C'est des paroles. Même pas : paroles sont paroles.
O hommes ! Informes mollusques, foule qui sort dans les rues, millions de fourmis que les pieds du Temps écrasent ! Vous n'avez pour demeure que la vapeur commune de votre véritable sang : les paroles. Votre rumination vous écœure, votre respiration vous étouffe. Votre personnalité et vos expressions se mangent entre elles. Telles paroles, telles mœurs, ô société ! Tout n'est que paroles.
II
N'en déplaise aux paroles elles-mêmes, étant données les habitudes que dans tant de bouches infectes elles ont contractées, il faut un certain courage pour se décider non seulement à écrire mais même à parler. Un tas de vieux chiffons pas à prendre avec des pincettes, voilà ce qu'on nous offre à remuer, à secouer, à changer de place. Dans l'espoir secret que nous nous tairons. Eh bien ! relevons le défi.
Pourquoi, tout bien considéré, un homme de telle sorte doit-il parler ? Pourquoi les meilleurs, quoi qu'on en dise, ne sont pas ceux qui ont décidé de se taire ? Voilà ce que je veux dire.
Je ne parle qu'à ceux qui se taisent (un travail de suscitation), quitte à les juger ensuite sur leurs paroles. Mais si cela même n'avait pas
été dit on aurait pu me croire solidaire d'un pareil ordre de choses.
Cela ne m'importerait guère si je ne savais par expérience que je risquerais ainsi de le devenir.
Qu'il faut à chaque instant se secouer de la suie des paroles et que le silence est aussi dangereux dans cet ordre de valeurs que possible.
Une seule issue : parler contre les paroles. Les entraîner avec soi dans la honte où elles nous conduisent de telle sorte qu'elles s'y défigurent. Il n'y a point d'autre raison d'écrire. Mais aussitôt conçue celle-ci est absolument déterminante et comminatoire. On ne peut plus y échapper que par une lâcheté rabaissante qu'il n'est pas de mon goût de tolérer. |
 Parler contre les paroles ? Que veut dire Francis Ponge ? S'agit-il d'échapper au langage usuel ? Parler contre les paroles ? Que veut dire Francis Ponge ? S'agit-il d'échapper au langage usuel ?
Certaines expériences peuvent en effet traverser notre mémoire. L'écrivain se sent parfois à l'étroit dans les bornes de la langue et use de néologismes : on connaît ceux de Rabelais, de Céline, voire ceux de Frédéric Dard dans ses San Antonio. Dans tous ces cas, le vocable tout neuf ne naît pas ex nihilo : il est enfanté par la fantaisie étymologique, comme chez Rabelais, ou par le téléscopage de sonorités évocatrices voire de mots réels employés de manière incongrue : ainsi, dans les deux exemples suivants, Jean Tardieu et Boris Vian déroutent le vocabulaire usuel par un autre, aisément déchiffrable, mais auquel ils donnent une poésie inattendue :
Jean TARDIEU : Un mot pour un autre   (1951).
(1951).
|
Boris VIAN
: Cantilènes en gelée  
(1949)
|
Au lever du rideau, Madame est seule. Elle est assise sur un sofa et lit un livre.
IRMA, entrant et apportant le courrier.
Madame, la poterne vient d'élimer Le fourrage...
Elle tend le courrier à Madame, puis reste plantée devant elle, dans une attitude renfrognée et boudeuse.
MADAME, prenant le courrier.
C'est tronc!... Sourcil bien!...
(Elle commence à examiner les lettres puis, s'apercevant qu'lrma est toujours là :) Eh bien, ma quille ! Pourquoi serpez-vous là ? (Geste de congédiement.) Vous pouvez vidanger !
IRMA
C'est que, Madame, c'est que...
MADAME
C'est que, c'est que, c'est que quoi-quoi ?
IRMA
C'est que je n'ai plus de « Pull-over » pour la crécelle...
MADAME, prend son grand sac posé à terre à côté d'elle et après une recherche qui parait laborieuse, en tire une
pièce de monnaie qu'elle tend à Irma.
Gloussez ! Voici cinq gaulois ! Loupez chez le petit soutier d'en face: c'est le moins foreur du panier...
IRMA, prenant la pièce comme à regret, la tourne et la retourne entre ses mains, puis :
Madame, c'est pas trou : yaque, yaque...
MADAME
Quoi-quoi : yaque-yaque ?
IRMA, prenant son élan
Y-a que, Madame, ya que j'ai pas de gravats pour mes haridelles, plus de stuc pour le bafouillis de ce soir, plus d'entregent pour friser les mouches... plus rien dans le parloir, plus rien pour émonder, plus rien... plus rien... (Elle fond en larmes.)
MADAME, après avoir vainement exploré son sac de nouveau et l'avoir montré à Irma.
Et moi non plus, Irma ! Ratissez : rien dans ma limande !
IRMA, levant les bras au ciel.
Alors ! Qu'allons-nous mariner, mon Pieu ?
MADAME, éclatant soudain de rire.
Bonne quille, bon beurre! Ne plumez pas! J'arrime le comte d'un croissant à l'autre. (Confidentielle.) Il me doit plus de cinq cents crocus !
IRMA, méfiante.
Tant fieu s'il grogne à la godille, mais tant frit s'il mord au Saupiquet !.. (Reprenant sa litanie :) Et moi qui n'ai plus ni froc ni gel pour la meulière, plus d'arpège pour les...
MADAME, l'interrompant avec agacement.
Salsifis! Je vous le plie et le replie : le Comte me doit des lions d'or ! Pas plus lard que demain. Nous fourrons dans les Grands Argousins : vous aurez tout ce qu'il clôt. Et maintenant, retournez à la basoche ! Laissez-moi saoule ! (Montrant son livre.) Laissez-moi filer ce dormant ! Allez, allez ! Croupissez ! Croupissez !
|
Si les poètes étaient moins bêtes
Si les poètes étaient moins bêtes
Et s’ils étaient moins paresseux
Ils rendraient tout le monde heureux
Pour pouvoir s’occuper en paix
De leurs souffrances littéraires
Ils construiraient des maisons jaunes
Avec des grands jardins devant
Et des arbres pleins de zoizeaux
Des mirliflûtes et des lizeaux
Des mésongres et des feuvertes
Des plumuches, des picassiettes
Et des petits corbeaux tout rouges
Qui diraient la bonne aventure
Il y aurait de grands jets d’eau
Avec des lumières dedans
Il y aurait deux cents poissons
Depuis le crousque au ramusson
De la libelle au pépamule
De l’orphie au rara curule
Et de l’avoile au canisson
Il y aurait de l’air tout neuf
Parfumé de l’odeur des feuilles
On mangerait quand on voudrait
Et l’on travaillerait sans hâte
À construire des escaliers
Des formes encor jamais vues
Avec des bois veinés de mauve
Lisses comme elle sous les doigts
Mais les poètes sont très bêtes
Ils écrivent pour commencer
Au lieu de s’mettre à travailler
Et ça leur donne des remords
Qu’ils conservent jusqu’à la mort
Ravis d’avoir tellement souffert
On leur donne des grands discours
Et on les oublie en un jour
Mais s’ils étaient moins paresseux
On ne les oublierait qu’en deux.
|
L'invention lexicale peut parfois même se passer de toute règle et forger sans contrôle ses propres dénotations. Ainsi la verve de Jean Yanne, insolente et jubilatoire, se déchaîne dans son
Dictionnaire des mots qu'il y a que moi qui les connais   (Plon, 2000) : (Plon, 2000) :
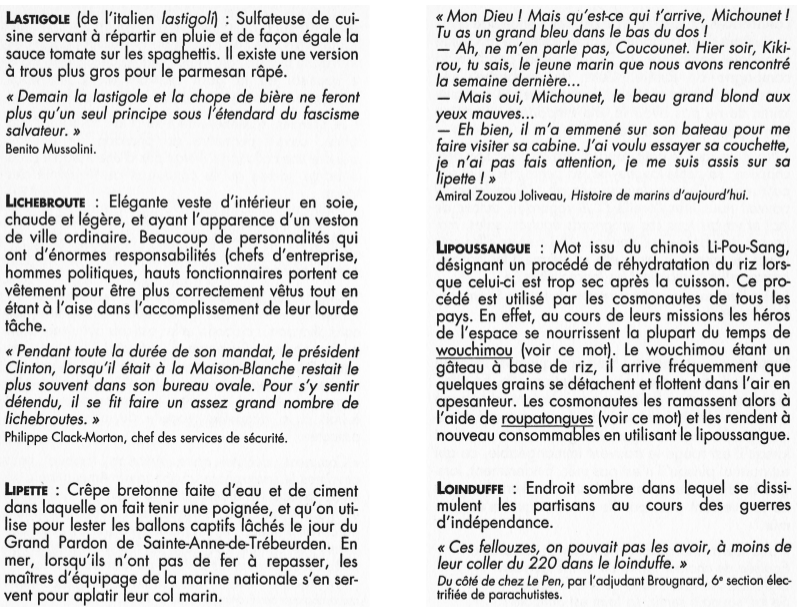
 On pourra en ouvrant le fichier suivant consulter une petite anthologie de néologismes : On pourra en ouvrant le fichier suivant consulter une petite anthologie de néologismes :
 Inventer son vocabulaire Inventer son vocabulaire
 Pour autant, peut-on poursuivre indéfiniment ces licences ? Ces créations ne sont pas sans rappeler le petit récit de Peter Bichsel où le refus du langage conventionnel finit par opérer entre le monde et le héros une fracture définitive : Pour autant, peut-on poursuivre indéfiniment ces licences ? Ces créations ne sont pas sans rappeler le petit récit de Peter Bichsel où le refus du langage conventionnel finit par opérer entre le monde et le héros une fracture définitive :
Peter BICHSEL, Histoires enfantines   (1971)
(1971) |
|
"Toujours la même table, dit l’homme, les mêmes chaises, et le lit, et le portrait. Et la table je l’appelle table, le portrait je l’appelle portrait, le lit se nomme lit et la chaise se nomme chaise. Au fait, pourquoi ? En anglais on appelle le lit « bedde», la table « teïbel », le portrait « pictcheur » et la chaise « tchair ». Et on se comprend. Et les Chinois aussi se comprennent.
Pourquoi le lit ne s’appelle-t-il pas portrait ?" se dit l’homme, et il sourit, puis il se mit à rire, et il rit, il rit, tant et si bien que les voisins tapèrent contre le mur en criant "Silence !".
"Maintenant ça change !" s’écria-t-il, et désormais il appela le lit "portrait". "Je suis fatigué, je vais aller au portrait", disait-il, et souvent, le matin, il restait longtemps au portrait, se demandant comment il appellerait la chaise, et il nomma la chaise "réveil".
Il se levait donc, s’habillait, s’asseyait sur le réveil et posait ses coudes sur la table. Mais la table ne s’appelait plus table, elle s’appelait maintenant tapis.
Le matin donc, notre homme sortait de son portrait, s’habillait, s’asseyait sur le réveil, devant le tapis, et se demandait comment il pourrait bien appeler les choses.
Le lit, il l’appelait portrait.
La table, il l’appelait tapis.
La chaise, il l’appelait réveil.
Le journal, il l’appela lit.
Le miroir, il l’appela chaise.
Le réveil, il l’appela journal.
Le tapis, il l’appela armoire.
Le portrait, il l’appela table.
Et l’album photos, il l’appela miroir.
Alors voilà : le matin, le vieil homme restait longtemps au portrait; à neuf heures l’album sonnait, l’homme se levait et se mettait sur l’armoire pour ne pas prendre froid aux pieds; il prenait ensuite ses vêtements dans le journal, s’habillait, se regardait dans la chaise accroché au mur, puis il s’assayait sur le réveil devant le tapis, feuilletait le miroir et s’arrêtait à la table de sa mère.
L’homme trouvait la chose amusante; toute la journée il s’exerçait à retenir les mots nouveaux. Maintenant il rebaptisait toutes les choses : il n’était plus un homme, mais un pied, et le pied était un matin, et le matin un homme.
Maintenant vous pouvez continuer l’histoire vous-mêmes. Et puis vous pouvez faire la même chose que l’homme, et changer aussi le sens des autres mots :
Sonner se dit poser,
Prendre froid se dit regarder,
Être couché se dit sonner,
Se lever se dit avoir froid,
Poser se dit feuilleter.
Et voici ce que cela donne :
Tous les hommes, le vieux pied restait longtemps sonné dans son portrait; à neuf heures l’album se mettait à poser, le pied prenait froid et se feuilletait sur l’armoire pour ne pas se regarder les matins.
Le vieil homme s’acheta des cahiers d’écolier à couverture bleue, et les remplit de mots nouveaux; cela lui donnait beaucoup de travail et on ne le voyait plus que rarement dans la rue.
Puis, il apprit les nouveaux noms de toutes les choses; en même temps, il oubliait de plus en plus les vrais noms. Il avait maintenant une langue nouvelle qui n’appartenait qu’à lui. [...] |
La suite est facilement imaginable. Que vaut en effet une langue fonctionnant en circuit fermé, esquivant délibérément sa vocation de communication ? Ce n'est donc pas dans l'invention lexicale qu'il faut saisir cet interstice par lequel s'engouffrer pour redonner vie au langage, cette fantaisie fût-elle dépaysante et libératrice. « Tout refus du langage est une mort », dit encore Roland Barthes.
|
 Mais à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet d'entendre la langue hors-pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part : littérature. Mais à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet d'entendre la langue hors-pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part : littérature.
Roland Barthes : Leçon inaugurale   . .  |
Nous y voici. Cette langue nouvelle ne peut s'élaborer en effet qu'à partir des mots eux-mêmes - et des plus ordinaires - que la littérature a le pouvoir d'enrichir et de magnifier, laissant au lecteur, par sa capacité à éveiller des multitudes d'échos, le droit de les entendre à sa guise. Tel est le propos de la page suivante, consacrée aux champs lexicaux.
 
|