|
« Le monde
de la tragédie est toujours le monde antique, l'homme,
la foule, les éléments, la femme, le destin.
Il se réduit à deux personnages, le héros et son sens de
la vie. »
André Malraux, Le Temps du mépris.
|
Objet
d'étude :
Le
théâtre du XVIIème au XXIème siècle.
Parcours
:
Un théâtre de la condition humaine.
|
C'est
en janvier 1937 qu'apparaissent, dans les Carnets
d'Albert Camus les premières notes concernant Caligula
: un plan, une ébauche de dénouement. Selon Camus
lui-même, un premier état est terminé au début de 1939,
repris à la fin de l'année. À intervalles irréguliers,
jusqu'à la fin de 1943, les Carnets témoignent
de la présence du personnage, de la pièce ou de ses thèmes
dans les préoccupations de Camus. Publiée en mai 1944,
créée le 25 septembre 1945 avec Gérard Philipe dans le
rôle-titre, rééditée en 1947, (avec quelques variantes),
reprise en 1950, puis en 1957, dans une mise en scène de
Camus lui-même, la pièce ne connaît son édition définitive
qu'en 1958 : c'est dire que cette pièce de "jeunesse" n'a
jamais cessé d'intéresser son auteur, que dans sa pleine
maturité et au faîte de la gloire, il ne l'a pas reniée.
Il s'agit en effet d'une de ses premières
œuvres, de celles qui appartiennent au premier stade,
pourrait-on dire, d'une pensée qui ne sera jamais une
pensée satisfaite : l'absurde, - Camus n'a cessé de le
rappeler, dès l'avant-propos du Mythe de Sisyphe
- loin d'être le point d'aboutissement d'une philosophie
du désespoir, est un "point de départ" et ne se sépare pas
de la révolte qu'il suscite. Camus est parfaitement
conscient de ce que "le cycle de l'absurde", avec Caligula,
L'Étranger, le Mythe de Sisyphe, est un moment de
sa pensée. Dès 1943, il note : « L'absurde, c'est
l'homme tragique devant un miroir (Caligula). Il n'est
donc pas seul. Il a le germe d'une satisfaction ou d'une
complaisance. Maintenant, il faut supprimer le miroir ».
Ou encore, dans le prière d'insérer de 1944 : « Grâce
à une situation (Le Malentendu) ou à un
personnage (Caligula) impossible, ces pièces
tentent de donner vie aux conflits apparemment
insolubles que toute pensée active doit d'abord
traverser avant de parvenir aux seules solutions
valables ». Sans doute fallait-il la révolte
individuelle et suicidaire de Caligula pour accéder à la
révolte solidaire de La Peste, ou au "Je me
révolte, donc nous sommes" de L'Homme révolté.
Au-delà de ces thèmes philosophiques, et loin
d'être une "pièce à thèse", comme Sartre a pu en assener,
Caligula est une œuvre vibrante et vivante, aussi
pleine de désespoir que d'amour de la vie, riche aussi
d'une exigence d'absolu typiquement adolescente. La sombre
beauté du personnage, tout auréolée de mépris, a ainsi de
quoi retentir encore aujourd'hui dans le cœur d'un jeune
public.
|
|
-Albert
Camus
Préface à l'édition
américaine de Caligula and three other plays
(1958)
|
|
|
 [...]
Caligula a été composé en 1938, après une
lecture des Douze Césars, de Suétone. Je
destinais cette pièce au petit théâtre que j'avais
créé à Alger et mon intention, en toute
simplicité, était de créer le rôle de Caligula.
Les acteurs débutants ont de ces ingénuités. Et
puis j'avais 25 ans, âge où l'on doute de tout,
sauf de soi. La guerre m'a forcé à la modestie et
Caligula a été créé en 1946, au Théâtre
Hébertot, à Paris. [...]
Caligula a été composé en 1938, après une
lecture des Douze Césars, de Suétone. Je
destinais cette pièce au petit théâtre que j'avais
créé à Alger et mon intention, en toute
simplicité, était de créer le rôle de Caligula.
Les acteurs débutants ont de ces ingénuités. Et
puis j'avais 25 ans, âge où l'on doute de tout,
sauf de soi. La guerre m'a forcé à la modestie et
Caligula a été créé en 1946, au Théâtre
Hébertot, à Paris.
Caligula est donc une pièce d'acteur
et de metteur en scène. Mais, bien entendu, elle
s'inspire des préoccupations qui étaient les
miennes à cette époque. La critique française, qui
a très bien accueilli la pièce, a souvent parlé, à
mon grand étonnement, de pièce philosophique.
Qu'en est-il exactement ?
Caligula, prince relativement aimable
jusque là, s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa
sœur et sa maîtresse, que le monde tel qu'il va
n'est pas satisfaisant. Dès lors, obsédé
d'impossible, empoisonné de mépris et d'horreur,
il tente d'exercer, par le meurtre et la
perversion systématique de toutes les valeurs, une
liberté dont il découvrira pour finir qu'elle
n'est pas la bonne. Il récuse l'amitié et l'amour,
la simple solidarité humaine, le bien et le mal.
Il prend au mot ceux qui l'entourent, il les force
à la logique, il nivelle tout autour de lui par la
force de son refus et par la rage de destruction
où l'entraine sa passion de vivre.
Mais, si sa vérité est de se révolter
contre le destin, son erreur est de nier les
hommes. On ne peut tout détruire sans se détruire
soi-même. C'est pourquoi Caligula dépeuple le
monde autour de lui et, fidèle à sa logique, fait
ce qu'il faut pour armer contre lui ceux qui
finiront par le tuer. Caligula est l'histoire d'un
suicide supérieur. C'est l'histoire de la plus
humaine et de la plus tragique des erreurs.
Infidèle à l'homme, par fidélité à lui-même,
Caligula consent à mourir pour avoir compris
qu'aucun être ne peut se sauver tout seul et qu'on
ne peut être libre contre les autres hommes.
Il s'agit donc d'une tragédie de
l'intelligence. D'où l'on a conclu tout
naturellement que ce drame était intellectuel.
Personnellement, je crois bien connaître les
défauts de cette œuvre. Mais je cherche en vain la
philosophie dans ces quatre actes. Ou, si elle
existe, elle se trouve au niveau de cette
affirmation du héros : Les hommes meurent et ils
ne sont pas heureux. Bien modeste idéologie, on le
voit, et que j'ai l'impression de partager avec M.
de La Palice et l'humanité entière. Non, mon
ambition était autre. La passion de l'impossible
est, pour le dramaturge, un objet d'études aussi
valable que la cupidité ou l'adultère. La montrer
dans sa fureur, en illustrer les ravages, en faire
éclater l'échec, voilà quel était mon projet. Et
c'est sur lui qu'il faut juger cette œuvre.
Un mot encore. Certains ont trouvé ma pièce
provocante qui trouvent pourtant naturel qu'Œdipe
tue son père et épouse sa mère et qui admettent le
ménage à trois, dans les limites, il est vrai, des
beaux quartiers. J'ai peu d'estime, cependant,
pour un certain art qui choisit de choquer, faute
de savoir convaincre. Et si je me trouvais être,
par malheur, scandaleux, ce serait seulement à
cause de ce goût démesuré de la vérité qu'un
artiste ne saurait répudier sans renoncer à son
art lui-même.
|
Structure dramatique.
Dès la première critique de Caligula,
le problème de la valeur dramatique du sujet fut posé, et
les réponses furent contradictoires. Jacques Lemarchand
écrit dans L'Arche (n° 10, oct. 1945) : "Le sujet de Caligula
est un raisonnement poussé jusqu'à ses conséquences
extrêmes. […] C'est un excellent sujet dramatique, le
théâtre ayant, pour des raisons personnelles, plus besoin
de logique que tout autre moyen d'expression artistique."
Et J. Lemarchand résume ainsi le raisonnement de Caligula :
"Ce n'est que par le mensonge que l'homme arrive à
croire à un bonheur possible. Or, il faut vivre dans la
vérité. Et puisque j'en ai le pouvoir, je vais ramener
l'homme à sa vérité, savoir : l'arbitraire, l'injustice et
la mort". Pour Albert Ollivier au contraire (Les
Temps Modernes, déc. 1945), le thème central de l'homme
absurde "est, par essence, adramatique", avis que
semble corroborer Robert Kanters qui écrit dans les Cahiers
du Sud (n° 274, 2ème semestre 1945) : "A première vue,
c'est le tableau de la folie de Caligula et d'une folie
qui, posée dès le début, ne progresse plus et communique
donc à la pièce un caractère statique". Que faut-il
en croire ? "Excellent sujet dramatique", thème "par
essence adramatique", "caractère statique"
? En fait, chacun de ces critiques nuance son jugement, et
il semble que la pièce soit à la fois statique et
dramatique : statique, puisqu'il s’agit d'une exploration
systématique de toutes les possibilités d'exercice d'un
"pouvoir délirant", ce qui entraîne une succession
d'épisodes ou de sketches, sans réelle progression, qui
ressortissent à la "morale de la quantité" dont il est
question dans Le Mythe de Sisyphe. Démonstration
pédagogique, la pièce n'offre pas de rebondissement
dramatique, ni d'intrigue au sens traditionnel du terme.
Mais pièce dramatique, cependant, d'une part, parce que
l'accumulation des actes de Caligula suscite la révolte et
le complot; d'autre part, et surtout, parce qu'on ne peut
nier une réelle progression, non pas dans la folie
proprement dite (Caligula n'apparaît pas de plus en plus
fou, puisque dès le premier acte, il est résolu d'aller
jusqu'au bout), mais dans le dénuement de plus en plus grand
du personnage, préfigurant ce que sera sa solitude à la fin
de la pièce. L'acte II - celui des "jeux" de Caligula - est
encore celui du plein exercice du pouvoir sur les hommes; à
l'acte III, il ne s'agit plus que de mimer la divinité, et,
à l'acte IV, Caligula devient en fait le mime de lui-même :
ombre chinoise derrière la toile où il parodie quelque
chorégraphie sacrée, sa dépossession progressive passe par
la désacralisation de l'art, le refus de l'amitié et de
l'amour, pour aboutir à une solitude absolue. Le miroir est
brisé, il sera désormais vain d'y quêter son image ou son
reflet : l'Histoire seule gardera mémoire d'une démesure
dont il lui appartiendra de mesurer l'écho. Caligula a
refusé toute référence en dehors de lui-même ; il n'a plus
de recours, ni auprès des hommes, ni des dieux, ni dans
l'art, et sa vérité va consister à les tourner en dérision
en soulignant leurs mensonges et leur arbitraire. On
constate donc bel et bien une progression dramatique, qui va
de la "récréation d'un fou" à la confrontation solitaire
avec soi-même, jusqu'à l'assomption finale : "Je suis
encore vivant".
Camus définit ainsi son
entreprise en écrivant Caligula : "La passion
de l'impossible est, pour le dramaturge, un objet d'études
aussi valable que la cupidité ou l'adultère. La montrer
dans sa fureur, en illustrer les ravages, en faire éclater
l'échec, voilà quel était mon projet", écrit-il dans
la Préface à l'édition américaine de son théâtre,
fournissant en même temps un bref résumé de l'intrigue : «
Caligula, prince relativement aimable jusque-là,
s'aperçoit à la mort de Drusilla, sa sœur et sa maîtresse,
que "les hommes meurent et ils ne sont pas heureux". Dès
lors, obsédé par la quête de l'absolu, empoisonné de
mépris et d'horreur, il tente d'exercer, par le meurtre et
la perversion systématique de toutes les valeurs, une
liberté dont il découvrira pour finir qu'elle n'est pas la
bonne. Il récuse l'amitié et l'amour, la simple solidarité
humaine, le bien et le mal. Il prend au mot ceux qui
l'entourent, il les force à la logique, il nivelle tout
autour de lui par la force de son refus et par la rage de
destruction où l'entraîne sa passion de vivre." La
dynamique dramatique de la pièce repose sur cette passion de
l'impossible, et sur le personnage qui l'incarne, de plus en
plus seul dans son projet fou de faire étinceler la vérité.
|
Les
personnages.
C'est en effet
en fonction de ce projet que, dès le début, les
personnages se répartissent en adjuvants et en
opposants, mais avec des nuances que Caligula
souligne lui-même. Peu à peu s'installe une
dramaturgie du conflit, avec ses éclats déments ou
ses entretiens pénétrés. L'opposition ne se
manifeste pas uniquement par le complot qui
s'ourdit, dont nous pouvons suivre la préparation et
la réalisation, mais aussi par l'attitude préconisée
par Chéréa : "organisons sa folie". Trois
clans se dessinent bientôt : le groupe indifférencié
de patriciens médiocres et grégaires ; les
personnages plus ou moins fraternels qui éprouvent
de la sympathie pour Caligula mais ont choisi, pour
diverses raisons, de le combattre (Chéréa, Scipion).
Viennent enfin les complices et les comparses de
Caligula, qui lui sont dévoués jusqu'à la mort
(Hélicon, Caesonia). Mais face à ces clans, Caligula
est rejeté dans la solitude, même dans sa relation
avec ceux qui l'aiment. Trop proche de lui pour le
condamner, Scipion, par exemple, ne peut non plus
l'aider. Son départ à la fin de la pièce a une
signification symbolique évidente ; victime de
Caligula, s'il est aussi celui qui le "comprend", il
n'a d'autre issue que l'exil puisque, malgré tout le
sang versé, trop de choses en lui continuent à
l'approuver. Quant à Caesonia et à Hélicon, leur
position de complice et d'instrument de Caligula ne
va pas non plus sans nuance : Caesonia, effarée par
les actes de Caligula, aide à leur accomplissement
par amour, ce qui la place hors de la catégorie des
témoins objectifs.
|
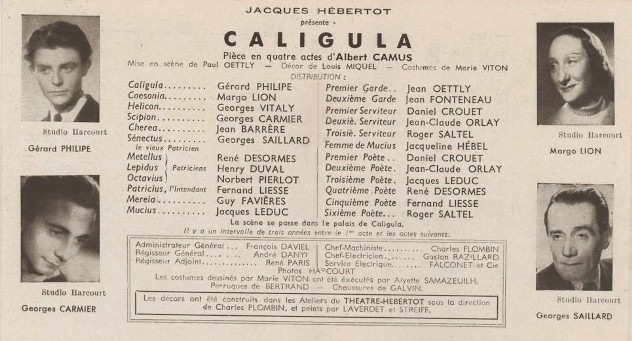 La distribution en 1946.
La distribution en 1946. |
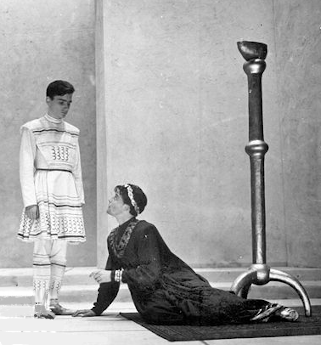 Lors de la création
(1945), Michel Bouquet tenait le rôle de Scipion.
Lors de la création
(1945), Michel Bouquet tenait le rôle de Scipion. |
|
Hélicon
mérite un sort particulier (et dans une version plus
tardive de la pièce, Camus avait notablement
augmenté son rôle) : son dévouement à Caligula est
absolu, il est le seul à mourir pour lui et non par
lui, mais il assume aussi en partie le rôle
traditionnel du bouffon, du moins, quand il n'est
pas seul avec Caligula. En face des autres, il
ne semble jamais concerné par les règles d'un jeu
auquel il apporte cependant son concours ; il paraît
hors de l'action - et pourtant il y participe, ne
serait-ce que par l'aide effective qu'il apporte à
Caligula et par son effort pour entraver la marche
du complot. Quoi qu'il en dise, ce n'est pas tant de
Caligula qu'il est le "spectateur", que des
événements et des autres personnages, vis-à-vis
desquels il garde toujours une certaine distance
ironique. Hélicon évoque souvent le rôle et le ton
du Mendiant de l'Electre de Giraudoux :
"mangeant des oignons" dès sa première entrée en
scène, négligemment préoccupé par l'heure du
déjeuner, se permettant de dire à tous ce qu'ils
sont vraiment sous leur masque social, il jouit de
l'impunité accordée généralement aux bouffons,
auxquels est réservé le privilège de dire la vérité.
Il est en fait doublement le substitut du tyran :
parce qu'il le sert, aidant à ses mises en scène ou
à ses condamnations, récitant pour lui le "petit
traité de l'exécution", ou dirigeant la prière à
Vénus, Hélicon reflète aussi, à sa manière, la
marginalité et la solitude de Caligula. C'est lui
que l'empereur charge, dès le début de la pièce,
d'une mission qui constitue le seul enjeu
dramatique, la seule tâche réellement importante au
milieu d'actions équivalentes dans leur
insignifiance : la quête de la lune. Si Hélicon
cependant n'est qu'en partie le bouffon
traditionnel, c'est que Caligula se réserve souvent
ce rôle, se mettant lui-même en valeur, jouant de
toutes les ressources de ses capacités d'acteur au
service de lui-même et de la vérité qu'il veut
enseigner : la bouffonnerie entre dans la
représentation qu'il donne de sa "folie".
|
La
structure.
Divisée
en quatre actes de longueur un peu inégale, la pièce est
composée selon un schéma parfaitement traditionnel. L'acte I
remplit sa fonction d'acte d'exposition, sur le plan
dramatique et psychologique, contenant en germe tous les
éléments de l'action : la "folie" de Caligula, la
répartition de ceux qui l'entourent en complices ou en
adversaires, la possibilité d'un "coup d'état". Caligula, à
son retour après trois jours de disparition, se découvre au
public dans tout son désordre : par ses confidences ou par
ses actes, il révèle sa découverte de l'absurde, son
désespoir, son "besoin d'impossible" et la volonté d'user de
son pouvoir absolu pour lui "donner ses chances". Il annonce
ainsi, en ordonnateur comme en démiurge, "le plus beau des
spectacles". Les actes suivants vont être la démonstration
rigoureuse de l'exercice d'un pouvoir tendant à réaliser
l'impossible, et une suite de représentations "pédagogiques"
mises en scène par Caligula pour obliger les autres à vivre
sous l'éclat insoutenable de la vérité. Parallèlement, le
complot se prépare (dénoncé à Caligula, celui-ci ne fait
rien pour empêcher sa réussite) et s'achève par le meurtre
de l'empereur. Ainsi la question de la réussite ou de
l'échec de ce complot ne constitue jamais l'enjeu dramatique
: il s'agit en fait d'un véritable suicide. L'enjeu se
trouve ailleurs, dans l'accomplissement d'une liberté qui a
choisi d'être sans compromis, mais qui, pour cela, s'érige
contre les hommes et ne trouve d'autre logique interne que
le sang. Caligula n'aura plus à constater que sa liberté
"n'est pas la bonne" tout en acquiesçant à son exécution,
laissant aux spectateurs, sinon aux acteurs, le soin de se
demander quelle sorte de liberté il est possible d'opposer à
l'absurdité de la condition humaine. Les problèmes posés
dans le premier acte trouvent, quant à eux, leur résolution
dans les dernières scènes : le sort de chacun des
personnages principaux se règle à la fin du dernier acte
(départ de Scipion, assassinat de Caesonia, mort d'Hélicon
quelques secondes avant celle de Caligula, triomphe de
Chéréa et des patriciens). Un schéma dramatique, qui
respecte scrupuleusement les exigences de la dramaturgie la
plus classique, charpente donc fortement la pièce. En même
temps, la démesure du personnage principal commande quelques
temps forts, comiques ou dramatiques, qui maintiennent
l'attrait ambigu que le public ne peut manquer d'éprouver
pour un être hors normes, détestable, certes, à bien des
égards, mais auréolé surtout du prestige des quêteurs
d'absolu.
Nous proposons ci-dessous une lecture suivie des
quatre actes en nous attardant plus particulièrement sur les
scènes qui nous paraissent les plus
significatives du message et de l'esthétique de la pièce.
Acte I :
"Désespoir de Caligula".
|
|
Selon la meilleure
tradition classique, le personnage principal
n'apparaît pas aux toutes premières scènes :
procédé efficace, qui permet qu'à son entrée, le
spectateur sache de qui il s'agit, et, en général,
quels problèmes il pose ou aura à résoudre. Les
deux premières scènes énoncent essentiellement une
absence ; le mot rien n'offre pas moins
de 13 occurrences en deux scènes, dont 6 dans les
cinq premières répliques. On ne sait pas à quoi ni
à qui correspond ce "rien" : absence temporelle ("toujours
rien", "rien le matin, rien le soir", "rien
depuis trois jours"), absence spatiale ("les
courriers partent, les courriers reviennent, ils
secouent la tête et disent : "Rien"), qui
débouchent sur une absence d'action : "il n
'y a rien à faire" ; constat repris par
Scipion et Chéréa : "Que peut-on faire ?
Rien". Ce n'est qu'à la dernière réplique
de la scène 1 : Hélicon : "Notre Caligula est
malheureux", que le nom référentiel de
cette absence sera prononcé ; jusque là, les
paroles des patriciens - à peine différenciées, ce
qui fait d'eux l'équivalent du "chœur" antique -
évoquent un "il" disparu, qui "avait un regard
étrange" ; Hélicon parle de tout, sauf de
l'empereur, avant, précisément, la phrase où il le
nomme ; seul Chéréa, (dont on peut s'étonner que
l'entrée ne marque pas une nouvelle scène : on
peut y voir, peut-être, la preuve que, bien que
fortement individualisé, il rejoint le "chœur" des
patriciens) désigne, au passé, "cet empereur
parfait".
La scène
8 marque la véritable entrée
en action de Caligula : elle est la première
manifestation de l'exercice de son pouvoir. La
rapidité du passage de la décision à l'exécution
retrouve le rythme farcesque de l'Ubu Roi
d’Alfred Jarry : le plan "génial" de Caligula
n’est guère qu'une manière un peu plus abstraite
d'utiliser le "crochet à nobles" ou le "voiturin
à phynances" du "héros", créé par Jarry. Il
s'agit sans doute moins d'influence que de
recours aux mêmes procédés, à des degrés
différents, d'accélération, de schématisation,
et de grossissement.
|
Les mécanismes mis en place
par Caligula, fondés sur l'arbitraire et la tyrannie, sont
à peine moins spectaculaires que les scènes de guignol
représentées par Ubu, et fonctionnent d'une façon
semblable : "Avec ce système, disait Ubu (acte
III, scène 4), j'aurai vite fait fortune, alors je
tuerai tout le monde et je m'en irai". Si les
raisons de Caligula ne sont pas les mêmes que celles
d'Ubu, les résultats ne diffèrent pas beaucoup. Dès cette
scène, qui fait apparaître, successivement - et l'ordre
ici n'est certainement pas arbitraire - le thème de la
condamnation et celui de la culpabilité générale, Caligula
souligne lui-même les prémisses de la démonstration quasi
mathématique que constitueront les actes suivants.
Poussant jusqu'au bout le raisonnement implicite que,
selon lui, contiennent les paroles de l'intendant,
poursuivant sa terrifiante prise des mots au sérieux, il
en conclut à la nullité de la vie humaine. Dès lors, plus
rien n'entravera sa logique, puisque le pouvoir lui donne
les moyens de l'exercer sans limites. Les scènes 9, 10 et
11 continuent et complètent les développements amorcés
dans les scènes 4, 7 et 8.
|
La scène
11 parachève l'exposition, en
ajoutant une dimension nouvelle au personnage : à
l'exposé d'une logique implacable succède la
confession d'un désespoir existentiel, maladie non
seulement de l'âme, mais du corps. Il y a un
étrange divorce entre la clarté, l'éclat
insoutenable de la lucidité, dont Caligula vient
de découvrir quelle arme elle pouvait être, et la
souffrance physique qui l'habite, innommable ("je
sens monter en moi des êtres sans nom"),
obscure ("pour que tout redevienne noir"),
impossible à définir ( "ni sang, ni mort, ni
fièvre, mais tout cela à la fois", "ce
goût. dans la bouche") et surtout
impossible à contrôler. L'empereur au pouvoir
absolu, dont la liberté est sans frontières, est
la proie d'une douleur dont il est d'autant moins
le maître qu'elle est diffuse dans tout son corps
et ne lui permet aucun repos : faut-il y voir les
symptômes cliniques de la "folie" ? En tout cas,
le corps apporte un démenti à l'affirmation du
pouvoir sur les autres et sur soi-même, ce qui se
traduira dans les gestes, les attitudes, le ton de
Caligula. En face de lui, Caesonia, pendant une
partie de la scène, semble rejoindre le chœur des
patriciens et la plaidoirie de Chéréa "pour ce
monde si l'on veut y vivre". Elle retrouve même
les formules traditionnelles des chœurs des
tragédies antiques, mettant en garde contre l'ubris
et l'oubli des limites raisonnables de la
condition humaine : "c'est vouloir s'égaler
aux dieux. Je ne connais pas de pire folie".
Mais elle ne tient pas longtemps ce rôle devant
les appels (ou les ordres) de Caligula : "Tu
m'obéiras. Tu m'aideras toujours. Jure de
m'aider"; elle ne sera plus désormais que
la complice "cruelle", "implacable", mais aussi
"égarée" et remplie "d'effroi". Il faut souligner
aussi dans la fin de cette scène, la remarquable
théâtralisation de l'anecdote du procès rapportée
par Suétone : "Un jour, il fit tuer tous les
inculpés, témoins, avocats d'un procès en criant
: Ils sont tous aussi coupables". Caligula
a déjà affirmé cette culpabilité collective ; ici,
il la met en scène, montrant combien son projet
nécessite la théâtralité. Il réclame l'entrée des
"coupables", des "condamnés à mort", autrement
dit, de tous les hommes, mais il réclame aussi son
public. Cette abolition de la distance entre la
scène et la salle met le spectateur de Caligula,
à chaque représentation, en situation d'acteur, et
ainsi l'implique dans le procès général intenté à
la condition humaine. Un propos de Jacques Copeau
à propos du Paradoxe sur le comédien de
Diderot n'a peut-être pas échappé à Camus : "Voilà
cet homme exposé sur le théâtre, offert en
spectacle, mis en jugement. Il entre dans un
autre monde. Il en assume la responsabilité. Il
lui sacrifie tout un monde réel." Au-delà
du simple rapprochement suggestif des termes,
n'oublions pas que, désormais, Caligula, ne se
contentera pas de distribuer les rôles autour de
lui dans les mises en scène qu'il ne cessera de
monter, mais jouera lui-même, en acteur consommé,
des pièces qui en effet créent "un autre monde",
dont il "assume la responsabilité", et auxquelles
"il sacrifie tout un monde réel".
|
Le vrai
Caligula
La pièce de
Camus n'a rien d'une pièce historique, mais nombre
d'éléments sont empruntés à la Vie des douze
Césars de l'historien latin Suétone dont
Camus venait de terminer la lecture avant de
commencer sa pièce.
Caïus Caesar Augustus Germanicus (Antium 12
- Rome 41) est le fils de Germanicus et
d'Agrippine, et le petit-fils adoptif de Tibère.
Il fut élevé parmi les soldats, auxquels il doit
son surnom (la caliga est une chaussure
militaire).
Successeur de Tibère en 37, il inaugura une
politique de libéralisme, mais devint bientôt fou.
Les trois dernières années de son règne ne furent
qu'une suite d'extravagances et de cruautés. Il
prétendit être adoré comme un dieu et, d'après
Suétone, voulut faire de son cheval Incitatus un
consul. Il exprima un jour le regret que le peuple
romain n'eût pas une tête unique pour pouvoir
l'abattre d'un seul coup. Dans le choix de ce
personnage, Camus a pu être inspiré par la phrase
favorite du jeune empereur : « J'aime le pouvoir
car il donne ses chances à l'impossible. »
Caligula fut assassiné par les prétoriens
commandés par Chaerea, et le sénat décida de le
rayer de la liste des empereurs.
|
Acte
II : "Jeu de Caligula".
L'acte II est le plus long de
la pièce ; il se situe "chez Chéréa", - lieu en fait aussi
peu déterminé que la salle du palais de Caligula. Le
changement de lieu permet d'une part la préparation du
complot, d'autre part prouve que la toute puissance de
Caligula s'exerce au-delà même des limites de son palais.
Cet acte se divise nettement en trois parties distinctes,
reliées l'une à l'autre par le personnage de Caligula,
mais dont la succession n'a pas la nécessité interne
qu'avaient les scènes du premier acte. Les scènes 1, 2 et
4 (la scène 3 n'est qu'une apparition muette de Caligula)
montrent la montée de la révolte chez les patriciens et la
préparation du complot ; les scènes 5 à 10 représentent
les "jeux" de Caligula, d'une manière plus statique que
dramatique ; la brève scène 11 marque un progrès dans
l'action, indiquant que le complot doit se "faire vite" et
sert de transition avec la dernière partie ; enfin les
scènes 12 à 14, avec la présence de Scipion, le seul
personnage "pur dans le bien", sont, elles, dans la suite
directe des scènes d'explication du premier acte, et,
comme elles, permettent une appréhension intérieure de
Caligula.
Les scènes
5 à 11, si elles n'apportent aucun
élément nouveau, donnent au moins d'excellents exemples de
la théâtralité permise par l'excentricité du comportement
de Caligula. Ces scènes sont une suite de sketches dont
toutes les répliques et les didascalies soulignent à quel
point le jeu de Caligula est outré : tour à tour farceur,
l'œil rieur ou épanoui et rêveur, l'empereur peut aussi
donner les signes de la plus vive colère. Pris d'un rire
irrésistible, il peut être aussi mathématique et précis
dans sa logique infaillible. L'accumulation des
didascalies est rendue plus efficace par la rapidité de
leur succession. Ces changements d'expression sont moins
des changements d'humeur que la manifestation la plus
visible du cynisme de Caligula et d'un jeu cruel qui va
jusqu'à l'assassinat. Le jeu scénique crée ici son propre
dynamisme, lui-même créateur d'une théâtralité redoublée.
Le numéro d'acteur devient même un numéro d'auteur : Camus
prend un plaisir évident à faire jouer son personnage, au
point que les didascalies sont écrites sur le même ton
allègre et avec le même goût du jeu que les propos qu'il
prête à son personnage.
Il fallait deux scènes graves pour préparer la
scène 14
où Scipion est l'interlocuteur de Caligula. Dans
l'économie générale de la pièce, on note souvent cette
alternance entre des scènes crispées et gesticulatoires,
où la violence se déchaîne, et d'autres, empreintes de
gravité, vouées le plus souvent au dialogue entre deux
personnages fraternels par-delà leur opposition. Ce rythme
si caractéristique de la pièce exprime quelque chose d'une
cyclothymie pathologique propre aux névroses, et contribue
à présenter Caligula comme un dépressif, au sens clinique
du terme. Pendant toute la première partie de cette scène,
Scipion se défend contre la tentation de "comprendre"
Caligula et surtout d'en être compris. Les didascalies le
montrent, de même qu'elles montrent la difficulté de
Caligula à cesser de jouer le jeu qu'il s'est imposé. Le
dialogue entre les deux jeunes hommes devient plutôt un
monologue à deux voix, signe évident de leur communion
jusqu'au parallèle établi par Caligula : "Tu es pur
dans le bien comme je suis pur dans le mal." Mais
en même temps il refuse la compréhension que Scipion peut
manifester. Encore une fois, Caligula s'exprime alors plus
directement par ses gestes et son attitude que par ses
paroles : l'agressivité avec laquelle il se jette sur
Scipion pour revendiquer sa vraie solitude en dit plus
long que sa tirade par ce qu'elle suppose de souffrances.
A la fin de la scène, Scipion et Caligula sont de nouveau
proches l'un de l'autre, mais Caligula, par son dernier
mot - "le mépris" - signe définitivement l'arrêt
de sa solitude et marque le seuil que ne pourra jamais
franchir Scipion pour partager ce sentiment qui va de pair
avec l'exercice totalitaire du pouvoir.
L'acte II, dans son ensemble, apparaît comme
une suite de "scènes de la vie quotidienne sous le règne
de Caligula" ; tout à la fois acteur et metteur en scène,
Caligula ne cesse de rappeler que la réalité quotidienne
est placée sous le double signe du jeu et de la mort.
Lui-même est au centre du jeu et de la scène, au milieu
des personnages dont il dirige les attitudes ou à qui il
souffle leurs répliques. Solitaire, certes, mais en proie
à une solitude empoisonnée, il est partout encore
environné, dans les représentations qu'il donne, sinon de
partenaires, du moins de comparses et de marionnettes,
alors qu'aux actes III et IV, costumé en Vénus ou en
danseuse, les spectacles qu'il montera seront à un seul
personnage.
Acte III :
"Divinité de Caligula".
|
Le plus court de la
pièce, il s'affirme, dès la première scène, comme
l'acte de la théâtralité la plus ostentatoire.
Mais les scènes 3 à 6 sont essentiellement
centrées sur le complot, sa double dénonciation,
et le refus de Caligula d'empêcher son
accomplissement.
La scène
1, installée dès avant le
lever du rideau sous le signe de la parade
foraine, accomplit la promesse faite à l'acte I de
présenter le plus beau des spectacles.
Grossièrement déguisé en Vénus, Caligula continue
cependant à faire œuvre de pédagogue : les
litanies que l'assistance est invitée à répéter
servilement établissent bien l'absurdité du monde,
l'absence de toute vérité et le rôle mystificateur
des cultes religieux. On comprend que le
dramaturge, en Caligula, se double aisément d'un
apparent thaumaturge : il n'y a pas de miracle à
exaucer des vœux qui ne font que constater la
"cruauté" de la vie de l'homme, le mélange de
"fleurs et de meurtres" qui la constituent.
La dernière réplique de Caligula et les jeux de
scène qui l'accompagnent réactualisent, au milieu
du cérémonial parodique, la menace permanente de
l'assassinat. Familier et goguenard, Caligula n'en
reste pas moins le maître de la vie et de la mort
de ses sujets.
La scène
6 se situe dans le
prolongement de la scène 10 de l'acte I, où
Caligula refusait le dialogue qu'il provoque ici,
et de la scène 2 de l'acte II, où Chéréa donnait
les raisons de sa participation au complot. Pour
la première fois, les deux personnages sont seul à
seul. La rencontre est importante, car elle montre
que la séparation entre le bien et le mal, ou
plutôt entre le normal et le monstrueux n'a rien
d'un manichéisme simpliste : Chéréa "comprend trop
bien" Caligula et sait que celui-ci est un de ses
propres visages, une de ses tentations qu'il
essaie d'étouffer. Caligula sait de son côté
qu'une part de lui-même aurait pu ressembler à
Chéréa. On retrouve dans cette scène un écho du
dénouement que Camus envisageait, dès la première
ébauche qui apparaît dans ses Carnets :
Caligula, revenu sur scène, disait expressément
qu'il représentait un aspect de chacun de ses
spectateurs : "Il est là, et là. Il est en
chacun de vous, ce monstre ou cet ange que vous
portez en vous." D'une manière sans doute
plus habile, c'est encore ce qu'il suggère ici,
par la compréhension qui le lie à Chéréa. C'est
avec lui que reprennent vie et vigueur les vraies
valeurs morales, et non plus les faux semblants
qui en tiennent lieu pour les patriciens. Parce
qu'il s'est révolté, parce qu'il n'a jamais montré
ni peur ni lâcheté, parce qu'il a la pleine
conscience de l'absurdité du monde, Chéréa a
acquis le droit au respect de Caligula, qui le
traitait naguère de "faux témoin". Ce n'est sans
doute pas un hasard si, dans la définition que
Chéréa donne de lui-même, il emploie, en les
inversant, les termes de Caligula dans son constat
de l'absurdité : "j'ai envie de vivre et
d'être heureux". C'est là le désir le plus
humain qui soit : il complète, plus qu'il ne s'y
oppose, la découverte de Caligula : "les
hommes meurent et ne sont pas heureux".
Caligula et Chéréa ont, en fait, le même langage,
donnent la même valeur aux mots, s'appuient sur la
même conscience lucide de la réalité humaine, mais
en tirent des conclusions diamétralement opposées.
Un véritable dialogue est-il alors possible ? Pour
la première fois dans la pièce, Caligula propose
un dialogue dépouillé de toute part de jeu ; mais
les choses ne sont pas si faciles. Au moment même
où Caligula déclare "utilisons nos mensonges",
lui et Chéréa, malgré ses dénégations, semblent
"se parler de tout leur cœur" ; sont-ils sincères
ou jouent-ils "le jeu de la sincérité" ? Le
"naturel" de Caligula témoigne, mieux que toutes
les paroles, en faveur de sa sincérité ; mais on
sait, en fait, qu'il joue, puisqu'il ne dévoile la
tablette, preuve du complot, qu'à la fin de la
scène. Quant à Chéréa, il a, lui aussi, "simulé la
franchise" puisqu'il savait cette tablette en
possession de Caligula. Pourtant, il ne fait aucun
doute que les deux hommes se sont parlé de tout
leur cœur. Ce jeu de la vérité et du mensonge,
autrement subtil que les représentations
théâtrales orchestrées d'ordinaire par Caligula,
est celui-même de la vie ; pas plus qu'entre le
bien et le mal, le normal et le monstrueux, la
dichotomie n'est absolue entre la vérité et le
mensonge. C'est ce que le héros de La Chute,
Clamence, illustrera de manière magistrale. Ici,
Caligula brûle la tablette sous les yeux
stupéfaits de Chéréa, et ce coup de théâtre
signale à nouveau son art consommé de effets
et des gestes symboliques.
|
On
ne nous dit rien sur Sisyphe aux enfers. Les
mythes sont faits pour que l'imagination les
anime. Pour celui-ci on voit seulement tout
l'effort d'un corps tendu pour soulever l'énorme
pierre, la rouler et l'aider à gravir une pente
cent fois recommencée ; on voit le visage
crispé, la joue collée contre la pierre, le
secours d'une épaule qui reçoit la masse
couverte de glaise, d'un pied qui la cale, la
reprise à bout de bras, la sûreté tout humaine
de deux mains pleines de terre. Tout au bout de
ce long effort mesuré par l'espace sans ciel et
le temps sans profondeur, le but est atteint.
Sisyphe regarde alors la pierre dévaler en
quelques instants vers ce monde inférieur d'où
il faudra la remonter vers les sommets. Il
redescend dans la plaine.
C'est pendant ce retour, cette
pause, que Sisyphe m'intéresse. Un visage qui
peine si près des pierres est déjà pierre
lui-même ! Je vois cet homme redescendre d'un
pas lourd mais égal vers le tourment dont il ne
connaîtra pas la fin. Cette heure qui est comme
une respiration et qui revient aussi sûrement
que son malheur, cette heure est celle de la
conscience. À chacun de ces instants, où il
quitte les sommets et s'enfonce peu à peu vers
les tanières des dieux, il est supérieur à son
des-tin. Il est plus fort que son rocher.
Si ce mythe est tragique, c'est que
son héros est conscient. Où serait en effet sa
peine, si à chaque pas l'espoir de réussir le
soutenait ? L'ouvrier d'aujourd'hui travaille,
tous les jours de sa vie, aux mêmes tâches et ce
destin n'est pas moins absurde. Mais il n'est
tragique qu'aux rares moments où il devient
conscient. Sisyphe, prolétaire des dieux,
impuissant et révolté, connaît toute l'étendue
de sa misérable condition : c'est à elle qu'il
pense pendant sa descente. La clairvoyance qui
devait faire son tourment consomme du même coup
sa victoire. Il n'est pas de destin qui ne se
surmonte par le mépris.
Camus, Le mythe de
Sisyphe (1942)
|
Le refus de Caligula d'utiliser la preuve du
complot et de punir les conspirateurs n'est évidemment pas
sans rappeler l'attitude d'Auguste à l'acte V de Cinna.
Mais ce n'est pas par "générosité" qu'agit Caligula
: c'est précisément parce qu'il sait les limites de tout
pouvoir humain, fût-il le pouvoir absolu du tyran, que
Caligula laisse le complot s'exécuter, acceptant ainsi sa
propre mort. L'acte III, commencé par une parade de
cirque, par une démonstration ébouriffée de spectacle dans
le spectacle, s'achève sur une nouvelle méditation sur la
vie et la mort, dans un climat tragique où, précisément,
l'ombre de la mort ne cesse d'être perceptible. Le passage
du burlesque au tragique relève moins d'un refus de la
séparation des genres que de l'illustration de
l'équivalence profonde de toutes les actions des hommes,
et donc de la représentation théâtrale de l'absurdité de
leur condition.
Acte IV :
"Mort de Caligula".
Presque aussi long que l'acte
II, divisé comme lui en 14 scènes, dont la plupart sont
très courtes, cet acte présente une grande diversité dans
le ton et donne l'impression d'une accélération un peu
désordonnée des événements. Si la mention du complot
apparaît à plusieurs reprises et s'il fournit l'essentiel
de la trame événementielle, les représentations données
par Caligula tiennent aussi une place importante et
diversifiée. Les différents procédés employés dans les
actes précédents sont ici réunis : comme à l'acte I,
Caligula apparaît et disparaît, se cache, joue sur scène
ou dans les coulisses ; comme à l'acte III, il donne la
mesure de ses talents dramatiques. Presque toutes les
scènes sont soit un prolongement, soit une répétition,
avec quelques variantes, d'une scène des actes précédents.
On peut s'étonner de la place qu'occupe,
presqu'au dénouement, la scène
12 consacrée au concours de poésie.
Ne vient-elle pas rompre la montée vers le tragique de
l'assassinat de Caesonia, puis de Caligula lui-même ? En
fait, il s'agit, ici encore, de bien autre chose que d'un
simple jeu comique, même si cet aspect existe.
L'entreprise de démystification de l'art n'a pas commencé
avec la danse grotesque de la scène IV ; elle était
prévisible dès la scène 10 de l'acte I, avec le refus de
Caligula de voir Chéréa le littérateur, parce que la
littérature est mensonge. Sans doute était-elle déjà
évoquée indirectement par ce que Scipion, dès la scène VI
de l'acte I, nous apprenait du premier Caligula, celui
d'avant la découverte de l'absurde : "Il me disait
que la vie n'est pas facile, mais qu'il y avait la
religion, l'art, l'amour qu'on nous porte". Après
la désacralisation de la religion, avant le départ de
Scipion, et surtout l'assassinat de Caesonia, deux visages
de "l'amour qu'on nous porte", le concours de
poésie vient à sa place, pour tourner en dérision ce à
quoi Caligula tenait le plus, les fondements de sa foi en
la vie, avant son apostasie, et sa conversion au néant. Il
est évident que c'est à lui-même plus encore qu'aux autres
qu'il inflige cette nouvelle forme de nihilisme. Une fois
encore, un trait emprunté à l'histoire donne lieu à une
remarquable théâtralisation ; et, de nouveau, la scène
devient le lieu d'un spectacle : les rôles sont distribués
entre les acteurs et les spectateurs parmi les
personnages. Mais la liberté de manœuvre des premiers est
plus réduite que jamais, dans la méticuleuse
"organisation" qui régit le déroulement de la
représentation. La brièveté des répliques, dans la presque
totalité de la scène, accentue le caractère mécanique des
évolutions des poètes et de leurs prestations scandées par
les coups de sifflet. Le burlesque est fondé sur le rythme
saccadé des premiers films muets, sur la répétition, sur
l'inadéquation complète de ce qui est en cause : la
poésie, et son expression, dénonce l'univers de l'ordre
totalitaire et de la déshumanisation dont le XXème siècle
offre tant d'exemples. C'est l'univers qu'illustreront et
dénonceront chacun à sa manière, l'État de Siège
et La Chute. Le sujet même du concours est
évidemment significatif : la mort, présente dans toute la
pièce, sous forme d'allusion ou de meurtre effectif,
obsession constante de Caligula, n'a rien d'un motif
ornemental, et devait recevoir la consécration de l'œuvre
d'art. Mais la "composition" de Caligula a suffisamment
prouvé que "l'art" ne se sépare pas de la vie. On sait à
quelles aberrations et à quelles cruautés peut conduire la
logique sans faille d'une conduite en accord avec la
pensée, pour peu que cette pensée soit celle du tyran. A
l'heure du bilan, Caligula, en fait, ne se donne pas de
nouvelles justifications, mais de l'empereur artiste
dont Chéréa disait que cela n'était pas convenable,
dès la scène 2 de l'acte I, il présente l'ultime
incarnation : l'art lui-même perverti dans son essence. La
"composition" de Scipion est en évidente rupture avec
celles des poètes officiels, et avec les faux semblants de
leur langage "poétique". Une fois encore, l'exigence de
pureté, la gravité intransigeante de Scipion rendent aux
mots leur véritable sens et leur véritable grandeur. Il
exprime les thèmes fondamentaux du lyrisme camusien, où le
bonheur et la mort, sous le signe du soleil et de la
pureté, se confondent dans une même affirmation de la
réalité humaine : Noces ne dit pas autre chose.
La scène
14 ne confronte plus Caligula qu'avec
lui-même. Disparu le dernier témoin, Caligula, comme à la
fin de l'acte I, comme à la scène 5 de l'acte III, ne peut
plus se parler qu'à lui-même. Le monologue de la scène
finale reprend, sans ordre, tous les thèmes et même les
mots, du reste de la pièce. Dans chacune de ses phrases,
de ses nombreuses interrogations et exclamations, on peut
entendre l'écho d'une phrase déjà prononcée par Caligula,
ou voir le reflet de l'un de ses actes. La volonté de
"changer l'ordre du monde", le désir de l'impossible, la
lune, l'innocence et la culpabilité, la mort, la peur, la
haine de soi, tout ce qui donnait forme et signification
au personnage, à ses paroles et à ses gestes, est repris
ici. Mais le "tous coupables" est devenu "nous serons
coupables à jamais". L'impossible ne s'est pas
réalisé, Hélicon n'a pas apporté la lune, l'ordre du monde
n'a pas changé et la peur n'est plus celle que
ressentaient les autres. Le miroir ne renvoie Caligula
qu'à lui-même. Au terme de son expérimentation, Caligula
ne rencontre plus que sa propre image. Seule est nouvelle
la découverte de son erreur : "Je n'aboutis à rien.
Ma liberté n'est pas la bonne" (répliques tardives,
comme celle de la scène XIII). Commencée par le "rien",
c'est aussi par lui que s'achève la pièce : "Rien, rien
encore". Le pouvoir délirant du destructeur n'avait
d'autre issue que le néant. Ne pouvant apporter la lune,
Hélicon ne revient qu'au moment de la mort : la sienne
précède de quelques instants celle de Caligula. Les
derniers "jeux de scène" figurent la démesure et la
démence de Caligula : simulacre de son suicide, le bris du
miroir s'accompagne de cris, de hurlements, et d'un "rire
fou". C'est en pleine face que frappe Chéréa, alors que le
vieux patricien frappe Caligula dans le dos : les
personnages gardent leur logique interne, et leur
signification. Les derniers mots de Caligula sont
"historiques". Ici encore, ils sont utilisés de la manière
la plus théâtrale, mais le théâtre ne fait ici que
reproduire la réalité de l'histoire. Cependant, si
Caligula se renvoie lui-même "à l'histoire", son cri
ultime, "je suis encore vivant", résonne plus
loin que le défi individuel de l'empereur à sa propre
mort, au moment même où il est frappé. Comme dans
l'ensemble de la pièce, l'histoire et ses acteurs prennent
valeur et signification de symboles : la survie de
Caligula est à la fois celle d'un personnage historique,
d'une création littéraire, et l'illustration d'une pensée
et d'une attitude qui les dépasse.

|