|
Objet
d'étude :
La littérature d'idées du XVIème au XVIIIème
siècle.
Parcours :
Imagination et pensée au XVIIème siècle.
|
Pertinent dans ces deux objets d'étude (l'un en Seconde,
l'autre en Première), l'apologue est au nombre des
ressources de l'argumentation, bien qu'il tienne avant
tout du récit. Il s'agit en effet d'une courte fiction
destinée à illustrer une vérité morale. Loin de
correspondre, comme on le croit parfois, à la volonté de
déjouer quelque censure, ce procédé mise bien plutôt sur
la sagacité du lecteur auquel on délègue la fonction
essentielle de décrypter la teneur d'un message :
C'est proprement un charme: il rend l'âme attentive,
Ou plutôt il la
tient captive,
Nous attachant à des récits
Qui
mènent à son gré les cœurs et les esprits.
(La
Fontaine, A Madame de Montespan, Fables, VII).
Par
une froide journée d'hiver, un troupeau de
porcs-épics s'était mis en groupe serré pour
se garantir mutuellement contre la gelée par
leur propre chaleur. Mais tout aussitôt ils
ressentirent les atteintes de leurs
piquants, ce qui les fit s'éloigner les uns
des autres. Quand le besoin de se chauffer
les eut rapprochés de nouveau, le même
inconvénient se renouvela, de façon qu'ils
étaient ballottés de çà et de là entre les
deux souffrances, jusqu'à ce qu'ils eussent
fini par trouver une distance moyenne qui
leur rendit la situation supportable. Ainsi,
le besoin de société, né du vide et de la
monotonie de leur propre intérieur, pousse
les hommes les uns vers les autres; mais
leurs nombreuses qualités repoussantes et
leurs insupportables défauts les dispersent
de nouveau. La distance moyenne qu'ils
finissent par découvrir et à laquelle la vie
en commun devient possible, c'est la politesse
et les belles manières. En
Angleterre, on crie à celui qui ne se tient
pas à distance : Keep your distance! -
Par ce moyen, le besoin de chauffage mutuel
n'est, à la vérité, satisfait qu'à moitié,
mais en revanche on ne ressent pas la
blessure des piquants. - Celui-là cependant
qui possède beaucoup de calorique propre
préfère rester en dehors de la société pour
n'éprouver ni ne causer de peine.
Arthur SCHOPENHAUER, Parerga et
Paralipomena (1851)
|
La composition du texte apparaît clairement : à un petit
récit, qui offre tous les caractères exagérément
simplifiés du texte narratif (montrez-le), succède en
quelques lignes un court développement conclusif ("Ainsi")
qui, lui, tient du discours argumentatif (quelles en sont
les formes ?). Ces deux mouvements constituent une seule
et même démarche : les éléments du récit sont déjà assez
signifiants pour que la leçon morale dégagée par la suite
soit presque superflue (comment néanmoins s'y exprime le
pessimisme du philosophe ? qui est, selon vous, celui qui
"possède beaucoup de calorique" ?).
On appelle apologue ce type de narration dont la
visée est philosophique et morale. Le procédé est très
répandu depuis l'Antiquité et s'épanouit particulièrement
aux XVII° et XVIII° siècles (pensez aux Fables
de La Fontaine; on peut aussi évoquer la plupart des
contes de Voltaire et notamment la fin de Candide).
A ces époques, l'apologue semble correspondre à une
stratégie commode qui consiste à laisser s'exprimer seules
par le récit des vérités qui pourraient être dangereuses
pour l'auteur, et ainsi contourne la censure. Mais, en
fait, le genre de l'apologue satisfait bien davantage une
intention pédagogique : « Il y a certaines
vérités qu'il ne suffit pas de persuader, mais qu'il faut
encore faire sentir. Telles sont les vérités de morale.
Peut-être qu'[un] morceau d'histoire touchera plus qu'une
philosophie subtile », écrit Montesquieu au seuil
des Lettres
Persanes (voir à ce sujet la
dissertation que nous proposons à l'issue d'un
corpus de documents). De son côté, dans le chapitre IX du
Taureau Blanc, Voltaire fait dire au personnage
du serpent : « Je voudrais surtout que sous le
voile de la fable, le conte laissât entrevoir aux yeux
exercés quelque vérité fine qui échappe au vulgaire.»
Ainsi l'apologue dissipe les craintes de
Socrate à l'égard de l'écriture, qu'il accusait de réduire
toujours le lecteur, par ses « paroles gelées », à un
apprenant passif : ce type de récit sollicite au contraire
une vigilance sans failles capable de permettre à chacun
de saisir et de s'approprier son enseignement. Car, déjà,
les apologues les plus anciens se gardent bien de conclure
explicitement : le mythe se
cantonne au récit, laissant la leçon s'étendre seule sur
tous les champs du savoir et de la sensibilité; dans ses paraboles,
le Christ laisse souvent ses auditeurs perplexes,
justifiant ainsi le choix de cette forme :
|
Voilà
pourquoi je leur parle en paraboles : parce
qu'ils regardent sans regarder et qu'ils
entendent sans entendre ni comprendre. Car le
cœur de ce peuple s'est épaissi, ils sont
devenus durs d'oreille, ils se sont bouché les
yeux, pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas
entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre
avec leur cœur. Et je les aurai guéris !
(Évangile selon saint Matthieu, 13, 1-23)
|
Le choix de l'apologue, forme légère et parfois vulgaire,
peut enfin correspondre à la volonté de récompenser le
lecteur ou l'auditeur capables de dépasser leur première
impression pour déceler, dans ce qui ne semblait être que
laideur et futilité, les beautés et richesses bien cachées
sous cette écorce. C'est ce que soutiennent ici Erasme et
Rabelais, dans des textes convergents où tous deux
reconnaissent cette vertu à deux « Silènes » exemplaires :
Socrate et le Christ.
|
ERASME
Adages (1515)
On
dit que les Silènes étaient des figurines
fendues d'une manière telle qu'on pouvait
séparer les deux parties et ouvrir la figurine;
fermées elles ne présentaient qu'une apparence
risible et déformée de joueur de flûte, mais
ouvertes elles montraient soudain une divinité,
de telle sorte que la plaisante tromperie
rendait plus agréable l'art du sculpteur. Puis
le sujet des statuettes fut tiré du grotesque
Silène, pédagogue de Bacchus, et bouffon des
divinités poétiques. Car celles-ci ont elles
aussi, à l'imitation des princes de chez nous,
leurs fous de Cour. [...] Telle est à coup sûr
la nature des choses vraiment honnêtes : ce
qu'elles ont de précieux, elles le renferment et
le cachent à l'intérieur, ce qu'elles ont de
plus méprisable elles l'exposent au premier plan
et dissimulent leur trésor comme sous une vile
écorce pour ne pas le montrer aux yeux profanes.
Tout opposée est la manière des choses vulgaires
et inconsistantes : leur aspect extérieur est
séduisant, et ce qu'elles ont de plus beau elles
le montrent du premier coup aux passants; mais
si on jette un regard à l'intérieur elles ne
sont rien moins que ce qu'elles proposaient par
leur titre et leur aspect.
|
RABELAIS
Gargantua (1535)
En lisant les joyeux titres de quelques livres
de notre invention [...], vous pensez trop
facilement qu'on n'y trouve que des moqueries,
folâtreries et joyeux mensonges, puisque
l'enseigne extérieure (le titre) est, sans
chercher plus loin, habituellement reçue comme
moquerie et plaisanterie. Mais il ne faut pas
considérer si légèrement les œuvres des hommes.
Il faut ouvrir le livre et soigneusement peser
ce qui y est traité. Alors vous reconnaîtrez que
la drogue qui y est contenue est d'une tout
autre valeur que ne le promettait la boîte.
[...] Avez-vous jamais vu un chien rencontrant
quelque os à moelle ? Si vous l'avez vu, vous
avez pu noter avec quelle dévotion il guette son
os, avec quel soin il le garde, avec quelle
ferveur il le tient, avec quelle prudence il
l'entame, avec quelle passion il le brise, avec
quel zèle il le suce. Qui le pousse à faire cela
? Quel est l'espoir de sa recherche ? Quel bien
en attend-il ? Rien de plus qu'un peu de moelle.
[...] A son exemple, il vous faut être sages
pour humer, sentir et estimer ces beaux livres
de haute graisse, légers à la poursuite et
hardis à l'attaque. Puis, par une lecture
attentive et une méditation assidue, rompre l'os
et sucer la substantifique moelle.
|
L'apologue
s'adresse donc aussi bien au cœur et à l'imagination qu'à
l'esprit, et c'est au plaisir que l'on prend à écouter des
histoires qu'il faut mesurer tous ses atouts de
persuasion.
2.
Moralités :
Quelle
Morale puis-je inférer de ce fait ?
Sans cela, toute fable est un œuvre imparfait.
(La
Fontaine, Fables, XII, 2)
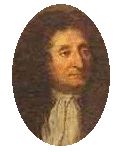
|
La
fable est le plus
caractéristique des apologues par sa composition
généralement partagée entre le récit et le
discours. Celui-ci apparaît sous forme de «
moralité » avant ou après le récit, mais peut
aussi disparaître totalement derrière la
narration, comme chez La Fontaine. Le récit
seul, en effet, comme dans la parabole, fournit
assez d'indices pour éclairer le lecteur. Le
fabuliste justifie ainsi cette prééminence
nécessaire de la narration :
Une morale nue
apporte de l’ennui :
Le conte fait passer
le précepte avec lui.
En ces sortes de
feinte il faut instruire et plaire ;
Et conter pour conter
me semble peu d’affaire. (VI, 1).
|
|
 Voici quelques fables de La Fontaine que
nous avons privées de leur "moralité". A
vous de choisir, parmi
celles que nous proposons ensuite, la
conclusion morale qui appartient à chacun de
ces récits.
Voici quelques fables de La Fontaine que
nous avons privées de leur "moralité". A
vous de choisir, parmi
celles que nous proposons ensuite, la
conclusion morale qui appartient à chacun de
ces récits.
Il vous faudra bien
sûr justifier votre choix par des indices
pertinents.
|
 ②
Le Petit Poisson et le Pêcheur (V, 3) ②
Le Petit Poisson et le Pêcheur (V, 3)
Petit
poisson deviendra grand,
Pourvu que
Dieu lui prête vie.
Mais le
lâcher en attendant,
Je tiens
pour moi que c’est folie ;
Car de le rattraper il n’est pas trop
certain.
Un Carpeau qui n’était encore que fretin,
Fut pris par un Pêcheur au bord d’une
rivière.
Tout fait nombre, dit l’homme en voyant
son butin ;
Voilà commencement de chère et de festin :
Mettons-le
en notre gibecière.
Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière
:
Que ferez-vous de moi ? je ne saurais
fournir
Au plus
qu’une demi bouchée,
Laissez-moi
Carpe devenir :
Je serai
par vous repêchée.
Quelque gros Partisan m’achètera bien
cher,
Au lieu
qu’il vous en faut chercher
Peut-être
encor cent de ma taille
Pour faire un plat. Quel plat ? croyez-moi
; rien qui vaille.
- Rien qui vaille ? Eh bien soit, repartit
le Pêcheur ;
Poisson mon bel ami, qui faites le
Prêcheur,
Vous irez dans la poêle ; et vous avez
beau dire,
Dès ce soir
on vous fera frire. [...]
|

①
La
Grenouille qui veut se faire aussi grosse
que le Bœuf (I, 3).
Une Grenouille vit un Bœuf,
Qui lui
sembla de belle taille.
Elle qui n’était pas grosse en tout comme
un œuf,
Envieuse s’étend, et s’enfle et se
travaille,
Pour égaler
l’animal en grosseur ;
Disant : -
Regardez bien, ma sœur,
Est-ce assez ? Dites-moi ; n’y suis-je
point encore ?
- Nenni. - M’y voici donc ? - Point du
tout. - M’y voilà ?
- Vous n’en approchez point. La chétive
pécore
S’enfla si
bien qu’elle creva.
[...]
|
| |

③
Le Renard et le Bouc (III, 5)
Capitaine
Renard allait de compagnie
Avec son ami Bouc des plus hauts encornés.
Celui-ci ne voyait pas plus loin que son
nez ;
L’autre était passé maître en fait de
tromperie.
La soif les obligea de descendre en un
puits.
Là
chacun d’eux se désaltère.
Après qu’abondamment tous deux en eurent
pris,
Le Renard dit au Bouc : « Que ferons-nous,
compère ?
Ce n’est pas tout de boire, il faut sortir
d’ici.
Lève tes pieds en haut, et tes cornes
aussi ;
Mets-les contre le mur. Le long de ton
échine
Je
grimperai premièrement ;
Puis
sur tes cornes m’élevant,
À l’aide de
cette machine,
De ce
lieu-ci je sortirai,
Après
quoi je t’en tirerai.
– Par ma barbe, dit l’autre, il est bon ;
et je loue
Les
gens bien sensés comme toi.
Je n’aurais
jamais, quant à moi,
Trouvé ce
secret, je l’avoue. »
Le Renard sort du puits, laisse son
compagnon,
Et vous lui
fait un beau sermon
Pour
l’exhorter à patience.
« Si le ciel t’eût, dit-il, donné par
excellence
Autant de jugement que de barbe au menton,
Tu n’aurais
pas, à la légère,
Descendu dans ce puits. Or, adieu, j’en
suis hors.
Tâche de t’en tirer, et fais tous tes
efforts :
Car pour
moi, j’ai certaine affaire
Qui ne me permet pas d’arrêter en chemin.
» [...]
|

④
Les deux Coqs (VII, 12)
Deux Coqs
vivaient en paix : une Poule survint,
Et
voilà la guerre allumée.
Amour, tu perdis Troie ; et c’est de toi
que vint
Cette
querelle envenimée
Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe
teint !
Longtemps entre nos Coqs le combat se
maintint ;
Le bruit s’en répandit par tout le
voisinage :
La gent qui porte crête au spectacle
accourut.
Plus d’une
Hélène au beau plumage
Fut le prix du vainqueur. Le vaincu
disparut :
Il alla se cacher au fond de sa retraite,
Pleura sa
gloire et ses amours,
Ses amours qu’un rival, tout fier de sa
défaite
Possédait à ses yeux. Il voyait tous les
jours
Cet objet rallumer sa haine et son courage
;
Il aiguisait son bec, battait l’air et ses
flancs,
Et,
s’exerçant contre les vents,
S’armait
d’une jalouse rage.
Il n’en eut pas besoin. Son vainqueur sur
les toits
S’alla percher, et chanter sa
victoire.
Un Vautour
entendit sa voix :
Adieu les
amours et la gloire ;
Tout cet orgueil périt sous l’ongle du
Vautour.
Enfin, par
un fatal retour,
Son rival
autour de la Poule
S’en revint
faire le coquet.
Je laisse à
penser quel caquet ;
Car il eut
des femmes en foule.
[...]
|

⑤
Le Rat et l’Huître (VIII, 9)
Un Rat, hôte
d’un champ, rat de peu de cervelle,
Des lares paternels un jour se trouva sou.
Il laisse là le champ, le grain, et la
javelle,
Va courir le pays, abandonne son trou.
Sitôt qu’il
fut hors de la case :
« Que le monde, dit-il, est grand et
spacieux !
Voilà les Apennins, et voici le Caucase. »
La moindre taupinée était mont à ses yeux.
Au bout de quelques jours, le voyageur
arrive
En un certain canton où Thétys sur la rive
Avait laissé mainte huître ; et notre Rat
d’abord
Crut voir, en les voyant, des vaisseaux de
haut bord.
« Certes, dit-il, mon père était un pauvre
sire :
Il n’osait voyager, craintif au dernier
point :
Pour moi, j’ai déjà vu le maritime empire
;
J’ai passé les déserts ; mais nous n’y
bûmes point. »
D’un certain magister le Rat tenait ces
choses,
Et les
disait à travers champs ;
N’étant pas de ces Rats qui, les livres
rongeants,
Se font
savants jusques aux dents.
Parmi tant
d’huîtres toutes closes,
Une s’était ouverte ; et, bâillant au
soleil,
Par un doux
zéphyr réjouie,
Humait l’air, respirait, était épanouie,
Blanche, grasse, et d’un goût, à la voir,
non pareil.
D’aussi loin que le Rat voit cette Huître
qui bâille :
« Qu’aperçois-je ? dit-il, c’est quelque
victuaille ;
Et, si je ne me trompe à la couleur du
mets,
Je dois faire aujourd’hui bonne chère, ou
jamais. »
Là-dessus, maître Rat, plein de belle
espérance,
Approche de l’écaille, allonge un peu le
cou,
Se sent pris comme aux lacs ; car l’huître
tout d’un coup
Se referme. Et voilà ce que fait
l’ignorance. [...]
|

⑥
La Tortue et les deux Canards (X, 2)
Une Tortue
était, à la tête légère,
Qui lasse de son trou voulut voir le pays.
Volontiers on fait cas d’une terre
étrangère :
Volontiers gens boiteux haïssent le logis.
Deux
Canards à qui la Commère
Communiqua
ce beau dessein,
Lui dirent qu’ils avaient de quoi la
satisfaire :
Voyez-vous
ce large chemin ?
Nous vous voiturerons par l’air en
Amérique.
Vous verrez
mainte République,
Maint Royaume, maint peuple ; et vous
profiterez
Des différentes mœurs que vous
remarquerez.
Ulysse en fit autant. On ne s’attendait
guère
De
voir Ulysse en cette affaire.
La Tortue écouta la proposition.
Marché fait, les oiseaux forgent une
machine
Pour
transporter la pèlerine.
Dans la gueule en travers on lui passe un
bâton.
Serrez bien, dirent-ils ; gardez de lâcher
prise.
Puis chaque Canard prend ce bâton par un
bout.
La Tortue enlevée on s’étonne partout
De
voir aller en cette guise
L’animal lent et sa maison,
Justement au milieu de l’un et l’autre
Oison.
Miracle, criait-on ; Venez voir dans les
nues
Passer la Reine des Tortues.
- La Reine : Vraiment oui. Je la suis en
effet ;
Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup
mieux fait
De passer son chemin sans dire aucune
chose ;
Car lâchant le bâton en desserrant les
dents,
Elle tombe, elle crève aux pieds des
regardants.
Son indiscrétion de sa perte fut cause.
[...]
|
Voici
dans le désordre les moralités enlevées à chaque fable.
Pour réattribuer à chacune sa moralité, remplissez le
tableau qui suit, dont vous trouverez une correction :
Ⓐ
La Fortune se
plaît à faire de ces coups :
Tout vainqueur insolent à sa perte travaille.
Défions-nous du Sort, et prenons garde à nous
Après le gain
d’une bataille.
|
fable
n°...
|
Ⓓ
Le monde est plein
de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout Bourgeois veut bâtir comme les grands
Seigneurs,
Tout petit Prince a des
Ambassadeurs,
Tout
Marquis veut avoir des Pages.
|
fable
n°...
|
Ⓑ
Un Tiens vaut, ce
dit-on, mieux que deux Tu l’auras :
L’un est
sûr, l’autre ne l’est pas.
|
fable
n°...
|
Ⓔ
Cette fable
contient plus d’un enseignement :
Nous y voyons
premièrement :
Que ceux qui n’ont du monde aucune expérience
Sont, aux moindres objets, frappés
d’étonnement ;
Et puis nous y
pouvons apprendre
Que tel est
pris qui croyait prendre.
|
fable
n°...
|
Ⓒ
Imprudence, babil,
et sotte vanité,
Et vaine
curiosité
Ont
ensemble étroit parentage ;
Ce sont
enfants tous d’un lignage.
|
fable
n°...
|
Ⓕ
En toute chose il
faut considérer la fin.
|
fable
n°...
|
►
CORRECTION
 BAC :
BAC :
On
pourra, à l'aide des textes présents sur le site, et pour
lesquels nous proposons un commentaire, constituer un
parcours sur l'apologue dans l'esprit de l'objet d'étude «
La littérature d'idées du XVIème au XVIIIème siècle »,
imposé au baccalauréat :
- une
fable : La
Mort et le bûcheron de La Fontaine
- un
récit : La
dent d'or de Fontenelle ou la lettre
XII des Lettres persanes de Montesquieu
- une
pièce de théâtre : L'Île
des esclaves de Marivaux
- un
poème : Le
Crapaud de Tristan Corbière.
-
une
nouvelle : cultivant
l'ellipse et la concision, elle sollicite souvent la
participation du lecteur dans la recherche d'une
vérité morale (irréalisme, litotes, fréquente chute
finale, dépourvue de conclusion explicite). Nous
consacrons à ce genre la séquence ci-dessous :
Dino Buzzati
Les Journées perdues
(I Giorni
perduti, in Centottanta racconti,
1982)
|
 |
Journaliste, romancier et nouvelliste italien
(Belluno, 1906 — Milan, 1972), Buzzati est à
l'origine d'une œuvre
vouée à la recherche de l'insolite caché
derrière la banalité quotidienne (Barnabo
des montagnes, 1933; Le Désert des
Tartares, 1940; Peur à la Scala,
1949; Un amour, 1963; Le K,
1966; Poèmes-Bulles, 1969; Les
Nuits difficiles, 1972; Le Rêve de
l'escalier, 1973). Le recueil dont nous
tirons cette nouvelle est posthume.
|
|
 un incipit in medias res : plongé
d'emblée "au milieu des choses", le lecteur est
capté par une situation énigmatique qui lui
épargne les indices spatio-temporels, les
portraits et les descriptions. Cette
intemporalité du récit signale un enjeu
universel et métaphysique.
un incipit in medias res : plongé
d'emblée "au milieu des choses", le lecteur est
capté par une situation énigmatique qui lui
épargne les indices spatio-temporels, les
portraits et les descriptions. Cette
intemporalité du récit signale un enjeu
universel et métaphysique.
 la caractérisation du personnage : réduit à
l'essentiel, privé de psychologie, il porte ici
un nom énigmatique (consonances saxonnes et
méditerranéennes mêlées) ou n'est désigné que
par l'indéfini.
la caractérisation du personnage : réduit à
l'essentiel, privé de psychologie, il porte ici
un nom énigmatique (consonances saxonnes et
méditerranéennes mêlées) ou n'est désigné que
par l'indéfini.
 la focalisation interne fait partager au lecteur
la perception fragmentaire de Kazirra et
souligne l'étrangeté de la situation.
la focalisation interne fait partager au lecteur
la perception fragmentaire de Kazirra et
souligne l'étrangeté de la situation.
 la simplicité du schéma narratif souligne la
perturbation intervenue dans la vie du
personnage et met en relief la portée morale du
récit.
la simplicité du schéma narratif souligne la
perturbation intervenue dans la vie du
personnage et met en relief la portée morale du
récit.
 le caractère symbolique des caisses condense en
quelques images fugitives la vie de Kazirra :
comment le narrateur suggère-t-il son
indifférence passée ?
le caractère symbolique des caisses condense en
quelques images fugitives la vie de Kazirra :
comment le narrateur suggère-t-il son
indifférence passée ?
 la situation finale souligne l'irréalisme du
récit et laisse le lecteur tirer lui-même son
interprétation.
la situation finale souligne l'irréalisme du
récit et laisse le lecteur tirer lui-même son
interprétation.
|
Quelques
jours
après avoir pris possession de sa somptueuse
villa, Ernst Kazirra, rentrant chez lui, aperçut
de loin un homme qui sortait, une caisse sur le
dos, d’une porte secondaire du mur d’enceinte,
et chargeait la caisse sur un camion.
Il n’eut pas le temps de le rattraper
avant son départ. Alors, il le suivit en auto.
Et le camion roula longtemps, jusqu’à l’extrême
périphérie de la ville, et s’arrêta au bord d’un
vallon.
Kazirra descendit de voiture et alla
voir. L’inconnu déchargea la caisse et, après
quelques pas, la lança dans le ravin, qui était
plein de milliers et de milliers d’autres
caisses identiques.
Il s’approcha de l’homme et lui demanda :
« Je t’ai vu sortir cette caisse de mon parc.
Qu’est-ce qu’il y avait dedans ? Et que sont
toutes ces caisses ? »
L’autre le regarda et sourit : « J’en ai
encore d’autres sur le camion, à jeter. Tu ne
sais pas ? Ce sont les journées.
- Quelles journées ?
- Tes journées.
- Mes journées ?
- Tes journées perdues. Les journées que tu as
perdues. Tu attendais, n’est-ce pas ? Elles sont
venues. Qu’en as-tu fait ? Regarde-les,
intactes, encore pleines. Et maintenant... »
Kazirra regarda. Elles formaient un tas
énorme. Il descendit la pente et en ouvrit une.
A l’intérieur, il y avait une route
d’automne, et au fond Graziella, sa fiancée, qui
s’en allait pour toujours. Et il ne la rappelait
même pas.
Il en ouvrit une autre. C’était une
chambre d’hôpital, et sur le lit son frère
Josué, malade, qui l’attendait. Mais lui était
en voyage d’affaires.
Il en ouvrit une troisième. A la grille
de la vieille maison misérable se tenait Duk,
son mâtin fidèle qui l’attendait depuis deux
ans, réduit à la peau et aux os. Et il ne
songeait pas à revenir.
Il se sentit prendre par quelque chose
qui le serrait à l’entrée de l’estomac. Le
manutentionnaire était debout au bord du vallon,
immobile comme un justicier.
« Monsieur ! cria Kazirra. Écoutez-moi.
Laissez-moi emporter au moins ces trois
journées. Je vous en supplie. Au moins ces
trois. Je suis riche. Je vous donnerai tout ce
que vous voulez. »
Le manutentionnaire eut un geste de la
main droite, comme pour indiquer un point
inaccessible, comme pour dire qu’il était trop
tard et qu’il n’y avait plus rien à faire. Puis
il s’évanouit dans l’air, et au même instant
disparut aussi le gigantesque amas de caisses
mystérieuses. Et l’ombre de la nuit descendait.
|

|
Exercice :
1) La
brièveté, l'irréalisme de la nouvelle
sollicitent une interprétation.. Si vous
deviez résumer ce texte en une maxime, quelle
serait-elle ?
2) Composition
du texte :
Précisez les différentes étapes du schéma
narratif et dites en quoi il met en valeur la
moralité que vous avez dégagée.
3) Les
personnages :
Comment les deux hommes sont-ils caractérisés
? Pourquoi ?
Après avoir étudié les indices de lieux, dites
en quoi ils nous renseignent sur les
personnages.
Quelle image de Kazirra le narrateur nous
donne-t-il ? Sur quoi fondez-vous votre
analyse ?
En quoi le manutentionnaire est-il un homme
étrange ? Quel rôle symbolique pourrait-on lui
attribuer ?
4) Genre et
registre :
Dans quel genre
littéraire rangez-vous cette nouvelle ?
Pourquoi ? Confirmez votre réponse en
caractérisant, à l’aide d’exemples, le
registre de la nouvelle.
|
L'apologue par excellence, c'est le mythe : récit et
discours tout à la fois, il offre en outre de très grandes
possibilités de relecture, dont chacun, à diverses
époques, est libre de réactiver les significations. Dans
le domaine pictural, ces variations sont innombrables.
Ainsi pour le mythe d'Icare dont nous vous proposons
d'examiner la version traditionnellement attribuée à
Bruegel l'Ancien. Vous pourrez d'abord prendre
connaissance de la
tradition mythologique et, sur le site, du poème-éloge
de Philippe Desportes.
 Passez
votre curseur sur l'image pour observer les
lignes de force.
Passez
votre curseur sur l'image pour observer les
lignes de force. |

|
|
Pieter
Bruegel l'Ancien (?), Paysage avec la chute
d'Icare, 1558 (Musées royaux des beaux
arts de Bruxelles).
|
Le titre
de la toile commence par intriguer : nous attendons Icare en
plein ciel et nous l'y cherchons vainement. Notre regard
commence à suivre ( ),
vers la gauche, les sillons du laboureur, imitant en cela le
regard du berger qui tourne résolument le dos à la mer.
Cette première ligne de force nous amène à épouser la
courbure du golfe qui nous fait suivre la ligne d'horizon. A
nouveau, les limites de la baie, à droite, guident notre œil
qui, maintenant, est contraint de descendre vers l'ombre du
tableau où il ne tarde pas à découvrir les deux jambes
d'Icare qui vient de tomber. ),
vers la gauche, les sillons du laboureur, imitant en cela le
regard du berger qui tourne résolument le dos à la mer.
Cette première ligne de force nous amène à épouser la
courbure du golfe qui nous fait suivre la ligne d'horizon. A
nouveau, les limites de la baie, à droite, guident notre œil
qui, maintenant, est contraint de descendre vers l'ombre du
tableau où il ne tarde pas à découvrir les deux jambes
d'Icare qui vient de tomber.
Interprétation :
-
les figures
du travail : laboureur, berger, pêcheur... Le peintre
condense ici les formes du travail humain, et renvoie à
une réalité, une économie toutes terrestres. Commentez
la position de ces trois figures par rapport à celle
d'Icare.
-
réduite à
un détail presque imperceptible (deux jambes près d'être
englouties), la figure d'Icare est présentée dans un
registre burlesque inattendu : les lectures classiques
du mythe en font en effet un parangon de l'aventure
humaine la plus haute et la plus absolue, fût-ce dans la
défaite. Opposez à ce détail la place considérable
occupée dans la toile par le rayonnement du soleil et
par le laboureur. Que veut signifier le peintre, à votre
avis ?
-
Quelle
position personnelle prend le peintre dans cet apologue
? Faut-il lui prêter une morale conservatrice
représentant de manière exemplaire le châtiment de
l'homme qui prétend transgresser ses limites naturelles
? ou au contraire lui faire exprimer une leçon
pathétique sur l'ignorance et la solitude à laquelle
sont condamnées les plus hautes entreprises (« Aucune
charrue ne s'arrête pour un homme qui meurt », dit
un proverbe germanique) ?
 
|