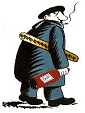 L
E C L I C H É L
E C L I C H É
|
Le cliché est une image usée, qu'il s'agisse d'une
formule lexicalisée ("son sang ne fit qu'un tour") ou
d'une métaphore reproduite à plaisir (Roger Caillois
rappelle la proposition attribuée à Nerval : « Le premier
qui compara la femme à une rose était un poète; le second
était un imbécile »). Signes "d'inattention et de
déchéance" selon Rémy
de Gourmont, les clichés révèlent en effet une
incapacité à créer des formes originales et une véritable
aliénation de soi dans le discours de l'autre. C'est à ce
titre que Flaubert les a recensés, avec les lieux communs,
dans son
Dictionnaire des idées reçues.
Nous utiliserons pourtant le cliché dans un
souci pédagogique : après avoir rappelé les images qui
sont susceptibles de mieux le véhiculer, nous vous
proposerons d'examiner des énoncés qui en font une
utilisation abusive et cultivent artificiellement l'écart
stylistique, puis d'en créer un, à votre tour !
1.
Signe, signifiant, signifié :
Ferdinand de Saussure exposa dans son Cours de
linguistique générale (publié en 1916) sa conception
du signe comme une notion à deux faces : un signifiant
(c'est-à-dire la forme concrète, acoustique ou graphique, du
signe) et un signifié, qui désigne le contenu
sémantique, l'ensemble des réalités à quoi renvoie le
signifiant :
ainsi les
signifiants [chat] (le mot prononcé ou vu),
l'icône  ont pour signifié l'animal
familier.
ont pour signifié l'animal
familier.
|
Le lien entre ces deux faces du
signe est certes nécessaire au sein d'une même collectivité
pour assurer la bonne réception du message. Mais il est en
fait arbitraire (dans d'autres langues, par exemple,
cet animal est désigné par un mot différent). Les poètes se
sont souvent plu à jouer sur le seul signifiant sans se
soucier du signifié (ainsi dans l'allitération ou
l'assonance); la littérature a d'autre part pour ambition de
multiplier les signifiés à partir d'un même signifiant (ce
sont les connotations).
Dans leur souci d'une langue neuve, certains écrivains ont
pu ainsi dissocier le signifiant du signifié en inventant
des mots ou en s'efforçant de vider les mots existants de
leur contenu, par une répétition systématique notamment,
comme peuvent le faire les enfants : |
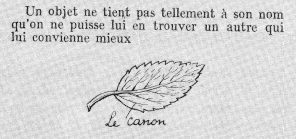
René Magritte, Les mots et les images, 1929.
|
Persienne Persienne Persienne
Persienne
persienne persienne
persienne persienne persienne persienne
persienne persienne persienne persienne
persienne persienne
Persienne
Persienne Persienne
Persienne ?
(Louis Aragon, Le
Mouvement perpétuel, 1926).
C'est ici que la notion de signe
nous intéresse pour réfléchir à celle de cliché.
Lorsqu'à un signifiant invariable est invariablement attaché
un même signifié, on pourra constater en effet cette
sclérose du langage à quoi aboutirait une littérature
confinée dans un langage utilitaire.
De ce langage, au contraire, la publicité est friande
puisqu'elle doit communiquer de manière massive des mots
d'ordre d'autant plus efficaces qu'ils seront automatiques.
Dans un texte célèbre, Roland Barthes a ainsi recensé les
signes à l'œuvre dans une image publicitaire et parfaitement
montré qu'ils n'ont besoin pour être compris que d'un savoir
stéréotypé :
Roland
BARTHES
Rhétorique
de l'image
in Communication, n°4, 1964
repris dans L'obvie et
l'obtus, Points, 1982.
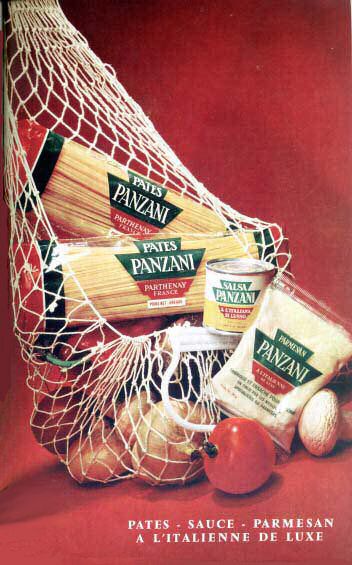
©
Éditions du Seuil
|
Voici une publicité Panzani : des
paquets de pâtes, une boîte, un sachet, des
tomates, des oignons, des poivrons, un
champignon, le tout sortant d'un filet à demi
ouvert, dans des teintes jaunes et vertes sur
fond rouge. Essayons d' « écrémer » les
différents messages qu'elle peut contenir.
L'image livre tout de suite un
premier message, dont la substance est
linguistique; les supports en sont la légende,
marginale, et les étiquettes, qui, elles, sont
insérées dans le naturel de la scène, comme « en
abyme » ; le code dans lequel est prélevé ce
message n'est autre que celui de la langue
française; pour être déchiffré, ce message
n'exige d'autre savoir que la connaissance de
l'écriture et du français. A vrai dire, ce
message lui-même peut encore se décomposer, car
le signe Panzani ne livre pas seulement
le nom de la firme, mais aussi, par son
assonance, un signifié supplémentaire qui est,
si l'on veut, l'«italianité » ; le message
linguistique est donc double ( du moins dans
cette image) : de dénotation et de connotation;
toutefois, comme il n'y a ici qu'un seul signe
typique, à savoir celui du langage articulé
(écrit), on ne comptera qu'un seul message.
Le message linguistique mis de côté, il
reste l'image pure (même si les étiquettes en
font partie à titre anecdotique). Cette image
livre aussitôt une série de signes discontinus.
Voici d'abord ( cet ordre est indifférent, car
ces signes ne sont pas linéaires ), l'idée qu'il
s'agit, dans la scène représentée, d'un retour
du marché ; ce signifié implique lui-même deux
valeurs euphoriques : celle de la fraîcheur des
produits et celle de la préparation purement
ménagère à laquelle ils sont destinés; son
signifiant est le filet entrouvert qui laisse
s'épandre les provisions sur la table, comme «
au déballé ». Pour lire ce premier signe, il
suffit d'un savoir en quelque sorte implanté
dans les usages d'une civilisation très large,
où « faire soi-même son marché » s'oppose à
l'approvisionnement expéditif (conserves,
frigidaires) d'une civilisation plus « mécanique
». Un second signe est à peu près aussi évident;
son signifiant est la réunion de la tomate, du
poivron et de la teinte tricolore (jaune, vert,
rouge) de l'affiche; son signifié est l'Italie,
ou plutôt l'italianité, ce signe est
dans un rapport de redondance avec le
signe connoté du message linguistique
(l'assonance italienne du nom Panzani) ;
le savoir mobilisé par ce signe est déjà plus
particulier : c'est un savoir proprement «
français » (les Italiens ne pourraient guère
percevoir la connotation du nom propre, non plus
probablement que l'italianité de la tomate et du
poivron), fondé sur une connaissance de certains
stéréotypes touristiques. Continuant d'explorer
l'image (ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit
entièrement claire du premier coup ), on y
découvre sans peine au moins deux autres signes;
dans l'un, le rassemblement serré d'objets
différents transmet l'idée d'un service
culinaire total, comme si d'une part Panzani
fournissait tout ce qui est nécessaire à un
plat composé, et comme si d'autre part le
concentré de la boîte égalait les produits
naturels qui l'entourent, la scène faisant le
pont en quelque sorte entre l'origine des
produits et leur dernier état; dans l'autre
signe, la composition, évoquant le souvenir de
tant de peintures alimentaires, renvoie à un
signifié esthétique : c'est la « nature morte »,
ou comme il est mieux dit dans d'autres langues,
le « still living » ; le savoir
nécessaire est ici fortement culturel. On
pourrait suggérer qu'à ces quatre signes,
s'ajoute une dernière information: celle-là même
qui nous dit qu'il s'agit ici d'une publicité,
et qui provient à la fois de la place de l'image
dans la revue et de l'insistance des étiquettes
Panzani (sans parler de la légende).
|
 Reprenez
un à un les signifiés repérés dans l'image et précisez
quels sont leurs signifiants. Exercez-vous à la même
analyse dans une image publicitaire de votre choix (voir
un autre exemple sur nos pages BTS).
Reprenez
un à un les signifiés repérés dans l'image et précisez
quels sont leurs signifiants. Exercez-vous à la même
analyse dans une image publicitaire de votre choix (voir
un autre exemple sur nos pages BTS).
2.
Repérage et dénonciation du cliché :
Dans les classifications rhétoriques, l'image appartient
aux figures de l'analogie. Celle-ci est une opération
fondamentale de l'esprit humain : définir un mot, évoquer
une représentation rendent souvent nécessaire le recours à
une autre réalité. Si je parle par exemple de couleur
chaude, j'établis une analogie entre le domaine de la vue
et celui du toucher pour justifier son intensité et sa
lumière; le rouge, le jaune ont eux-mêmes suggéré le sang,
le soleil... Parce qu'elle est une manière habituelle du
langage, et qu'elle fait partie des structures répétitives
propres à ce que nous avons appelé la
tyrannie de la langue, l'image est susceptible de se
fossiliser rapidement en cliché. Observons de plus près ce
phénomène.
On a l'habitude de recenser les images
suivantes :
 LA
COMPARAISON manifeste explicitement
le rapport analogique : le comparé
est lié au comparant
par un terme de
comparaison (comme, pareil à,
ressemble à...). LA
COMPARAISON manifeste explicitement
le rapport analogique : le comparé
est lié au comparant
par un terme de
comparaison (comme, pareil à,
ressemble à...).
Ex
: "La musique
souvent me prend comme
une mer."
(Baudelaire)
La
comparaison semble ancrée dans le réel,
s'efforçant de valider l'analogie par une
approximation cohérente, un point commun
manifeste.
C'est pourquoi les comparaisons sont le
plus souvent encombrées de clichés. Pourtant le
proverbe dit bien "Comparaison n'est pas
raison", et on se souviendra que les
surréalistes se sont plu à déranger ce
rationalisme apparent :
"Plus les rapports des deux réalités
rapprochées seront lointains et justes, plus
l'image sera forte - plus elle aura de
puissance émotive et de réalité poétique."
(Pierre Reverdy)
Ex : "Beau comme la rencontre
fortuite sur une table de dissection d'une
machine à coudre et d'un parapluie."
(Lautréamont)
|
 LA
MÉTAPHORE annule le terme de
comparaison et établit pour cela un rapport
fulgurant, évident, entre deux représentations
qui, pourtant, pourraient s'exclure. LA
MÉTAPHORE annule le terme de
comparaison et établit pour cela un rapport
fulgurant, évident, entre deux représentations
qui, pourtant, pourraient s'exclure.
Ex : comparaison
: "Dans la nuit, ta chevelure a l'air d'une
flamme"
métaphore
: "Ta chevelure incendie la nuit."
Cultivant l'implicite, la métaphore sollicite
l'imagination du lecteur, libre désormais
d'apercevoir la réalité suggérée derrière les
mots sans qu'une opération de "traduction"
rationnelle soit nécessaire.
Ex : "Lendemain de chenille en tenue de bal."
(Saint-Pol Roux)
| «
Il s'est trouvé quelqu'un d'assez
malhonnête pour dresser un jour,
dans une notice d'anthologie, la
table de quelques-unes des images
que nous présente l'œuvre d'un des
plus grands poètes vivants ; on y
lisait : Lendemain de chenille en
tenue de bal veut dire papillon.
Mamelles de cristal veut dire : une
carafe, etc. Non, monsieur, ne veut
pas dire. Rentrez votre papillon
dans votre carafe. Ce que
Saint-Pol-Roux a voulu dire, soyez
certain qu'il l'a dit. » André
Breton (Introduction au discours
sur le peu de réalité). |
Mais, ici encore, la métaphore n'est pas
réservée à la langue poétique : elle fait partie
des opérations fondamentales du langage (on
parle coutumièrement, par exemple, des "lumières
de l'esprit" ou du "cocon familial") et, à ce
titre, les métaphores sont tôt gagnées par le
cliché.
Installée sur toute une partie du texte,
la métaphore est dite "filée". Oubliant sa
cohérence, elle est dite "brisée" :
Ex : "Le char de l'État navigue sur un volcan".
|
 LA
MÉTONYMIE consiste à désigner un
objet par un autre terme que celui qui est
habituellement employé, et qui lui est associé par
contiguïté. LA
MÉTONYMIE consiste à désigner un
objet par un autre terme que celui qui est
habituellement employé, et qui lui est associé par
contiguïté.
C'est, par exemple, prendre une partie
pour le tout et dire « une voile » pour évoquer
un bateau; c'est aussi prendre la matière pour
l'objet et dire « croiser le fer » pour décrire
un combat à l'épée. C'est enfin prendre le
contenant pour le contenu et dire «boire un
verre» pour exprimer le fait de prendre une
consommation dans un café (certains parleront
alors de synecdoque, mais celle-ci est
souvent difficile à distinguer). Le mouvement de
la métonymie est donc toujours le même : il
consiste à réduire un ensemble à un détail,
l'important à l'anodin, le primordial à
l'accessoire.
|
 LA
PERSONNIFICATION attribue des
comportements ou des sentiments humains à un
objet, un être inanimé ou un animal. Elle peut
exprimer ainsi une conviction panthéiste,
élaborer un univers merveilleux
ou fantastique. LA
PERSONNIFICATION attribue des
comportements ou des sentiments humains à un
objet, un être inanimé ou un animal. Elle peut
exprimer ainsi une conviction panthéiste,
élaborer un univers merveilleux
ou fantastique.
Ex : "L'alambic, avec ses récipients de forme
étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux,
gardait une mine sombre." (Zola).
|
 L'ALLÉGORIE
désigne tout récit porteur d'une signification
symbolique. L'allégorie peut aussi incarner une
idée abstraite par une représentation concrète : L'ALLÉGORIE
désigne tout récit porteur d'une signification
symbolique. L'allégorie peut aussi incarner une
idée abstraite par une représentation concrète :
Ex: "Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans
merci" (Baudelaire).
Certaines allégories sont devenues des
clichés (la Paix sous la forme d'une colombe, le
Temps sous celle d'un squelette armé d'une faux
etc.).
|
 Examinez le texte suivant et le
tableau de synthèse que nous vous proposons ensuite :
Examinez le texte suivant et le
tableau de synthèse que nous vous proposons ensuite :
|
Dans Madame Bovary
(1857), Flaubert manifeste une entreprise de
dérision à l'égard de tous les discours
stéréotypés. Au chapitre VIII de la deuxième
partie du roman, il fait parler ainsi un
conseiller de préfecture chargé de remettre les
prix d'un concours de Comices agricoles :
|
|
Messieurs,
Qu'il me soit permis d'abord (avant de
vous entretenir de l'objet de cette réunion
d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis
sûr, sera partagé par vous tous), qu'il me
soit permis, dis-je, de rendre justice à
l'administration supérieure, au gouvernement, au
monarque, messieurs, à notre souverain, à ce roi
bien-aimé à qui aucune branche de la prospérité
publique ou particulière n'est indifférente, et
qui dirige à la fois d'une main si ferme et si
sage le char de l'État parmi les périls
incessants d'une mer orageuse, sachant
d'ailleurs faire respecter la paix comme la
guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture
et les beaux-arts. Le temps n'est plus,
messieurs, où la discorde civile ensanglantait
nos places publiques, où le propriétaire, le
négociant, l'ouvrier lui-même, en s'endormant le
soir d'un sommeil paisible, tremblaient de se
voir réveillés tout à coup au bruit des tocsins
incendiaires. [...] Mais, messieurs, que si,
écartant de mon souvenir ces sombres tableaux,
je reporte mes yeux sur la situation actuelle de
notre belle patrie, qu'y vois-je ? Partout
fleurissent le commerce et les arts; partout des
voies nouvelles de communication, comme autant
d'artères nouvelles dans le corps de l'État, y
établissent des rapports nouveaux; nos grands
centres manufacturiers ont repris leur activité;
la religion, plus affermie, sourit à tous les
cœurs; nos ports sont pleins, la confiance
renaît, et enfin la France respire !
|
Une
simple lecture de ce texte révèle quelques emplois
fossilisés des images, qui autorisent qu'on le considère
comme un tissu de clichés. Entreprenons d'en recenser
quelques-unes :
| IMAGES |
RELEVÉ |
COMMENTAIRE |
| Comparaison |
des
voies nouvelles de communication, comme autant
d'artères nouvelles dans le corps de l'État.
|
Comparaison
éculée, au point que le champ sémantique du mot
"artères" comprend aujourd'hui ce sens de voie
de communication.
|
|
Métaphore |
fleurissent
le commerce et les arts - qui dirige le char
de l'État parmi les périls incessants d'une
mer orageuse - s'endormant le soir
d'un sommeil paisible, tremblaient de se voir
réveillés.
|
Deux
métaphores brisées : on voit mal un char
naviguer ! Peut-on, d'autre part, s'endormir
paisiblement en tremblant ?
|
| Métonymie |
au
bruit des tocsins incendiaires.
|
Si le
tocsin est habituel pour signifier une alerte à
l'incendie, que dire de l'adjectif qui lui est
bizarrement accolé ?
|
| Personnification |
la
religion plus affermie, sourit à tous les
cœurs.
|
Ici
encore, la personnification oublie sa cohérence
: n'y a-t-il pas contradiction entre "affermie"
et "sourit" ?
|
| Allégorie |
où
la discorde civile ensanglantait nos places
publiques.
|
Image
habituelle, là encore, de la discorde, assimilée
à un personnage générique.
|
Ces
quelques remarques suffisent sans doute à caractériser le
ridicule de ce discours, qu'il tient aussi pourtant d'un
usage excessif des figures, c'est-à-dire d'un souci
artificiel de créer un écart par rapport à la
langue simple et directe qu'il devrait employer.
3.
Variation : l'écart stylistique
:
On appelle écart stylistique le travail de création -
notamment celui des figures de rhétorique - qui sépare un
énoncé de la langue usuelle. Cet écart est, au vrai, tout
virtuel : quel est le "degré zéro" qui permettrait de
mesurer, à la manière d'un sismographe, les plus ou moins
grandes variations du style ? La langue usuelle,
elle-même, ne méconnaît pas les figures. Mais il peut
sembler légitime de constater les écarts les plus
manifestes entre une langue simplement "informative" et
une autre, "littéraire". Si au simple énoncé "Le ciel est
bleu", je préfère celui-ci : "Tudieu ! De quel azur les
cieux ne nous gratifient-ils pas aujourd'hui !", je
manifeste une intention et opère une transformation du
réel, que mon destinataire appréciera diversement selon le
contexte.
Cet écart peut garantir la création littéraire la
plus originale, mais, cultivé pour lui-même, dans le seul
souci de l'esbroufe stylistique, il aboutit au galimatias
:
 Dans ses Exercices de style, Raymond
Queneau raconte une centaine de fois la même anodine
histoire, et donne ainsi un exemple particulièrement
éloquent d'écart stylistique. Observez la production
suivante baptisée "Ampoulé" : elle vous est présentée
après un simple récit, qui vous servira de "niveau 0".
Recensez dans le tableau de synthèse les figures-clichés
que nous venons de présenter et efforcez-vous, dans les
lignes réservées au commentaire, de dire en quoi le texte
manifeste aussi une emphase ridicule - artificiellement écartée
- qui justifie son titre.
Dans ses Exercices de style, Raymond
Queneau raconte une centaine de fois la même anodine
histoire, et donne ainsi un exemple particulièrement
éloquent d'écart stylistique. Observez la production
suivante baptisée "Ampoulé" : elle vous est présentée
après un simple récit, qui vous servira de "niveau 0".
Recensez dans le tableau de synthèse les figures-clichés
que nous venons de présenter et efforcez-vous, dans les
lignes réservées au commentaire, de dire en quoi le texte
manifeste aussi une emphase ridicule - artificiellement écartée
- qui justifie son titre.
| RÉCIT
(« niveau 0 ») |
|
Un jour vers midi du côté du parc Monceau, sur
la plate-forme arrière d'un autobus à peu près
complet de la ligne S (aujourd'hui 84),
j'aperçus un personnage au cou fort long qui
portait un feutre mou entouré d'un galon
tressé au lieu de ruban. Cet individu
interpella tout à coup son voisin en
prétendant que celui-ci faisait exprès de lui
marcher sur les pieds chaque fois qu'il
montait ou descendait des voyageurs. Il
abandonna d'ailleurs rapidement la discussion
pour se jeter sur une place devenue libre.
Deux heures plus tard, je le revis
devant la gare Saint-Lazare en grande
conversation avec un ami qui lui conseillait
de diminuer l'échancrure de son pardessus en
en faisant remonter le bouton supérieur par
quelque tailleur compétent.
|
| NIVEAU
"AMPOULÉ" |
|
A l'heure où commencent à se gercer les doigts
roses de l'aurore, je montai tel un dard
rapide dans un autobus à la puissante stature
et aux yeux de vache de la ligne S au trajet
sinueux. Je remarquai, avec la précision et
l'acuité de l'Indien sur le sentier de la
guerre, la présence d'un jeune homme dont le
col était plus long que celui de la girafe au
pied rapide, et dont le chapeau de feutre mou
fendu s'ornait d'une tresse, tel le héros d'un
exercice de style. La funeste Discorde aux
seins de suie vint de sa bouche empestée par
un néant de dentifrice, la Discorde, dis-je,
vint souffler son virus malin entre ce jeune
homme au col de girafe et à la tresse autour
du chapeau, et un voyageur à la mine indécise
et farineuse. Celui-là s'adressa en ces termes
à celui-ci : "Dites moi, méchant homme, on
dirait que vous faites exprès de me marcher
sur les pieds!" Ayant dit ces mots, le jeune
homme au col de girafe et à la tresse autour
du chapeau s'alla vite asseoir.
Plus tard, dans la Cour de Rome aux
majestueuses proportions, j'aperçus de nouveau
le jeune homme au cou de girafe et à la tresse
autour du chapeau, accompagné d'un camarade
arbitre des élégances qui proférait cette
critique que je pus entendre de mon oreille
agile, critique adressée au vêtement le plus
extérieur du jeune homme au col de girafe et à
la tresse autour du chapeau : "Tu devrais en
diminuer l'échancrure par l'addition ou
l'exhaussement d'un bouton à la périphérie
circulaire."
© Gallimard, 1947.
|
| IMAGES |
RELEVÉ |
COMMENTAIRE |
| Comparaisons |
|
|
| Métaphores |
|
|
| Personnification |
|
|
| Allégorie |
|
|
 CRÉATION :
CRÉATION :
A partir de cet extrait de La Chute
d'Albert Camus, essayez à votre tour de produire un texte
du même registre "ampoulé" en cultivant, avec les mêmes
images, l'écart le plus manifeste possible :
|
Une
motocyclette conduite par un petit homme sec,
portant lorgnon et pantalon de golf, m'avait
doublé et s'était installée devant moi, au feu
rouge. En stoppant, le petit homme avait calé
son moteur et s'évertuait en vain à lui
redonner souffle. Au feu vert, je lui
demandai, avec mon habituelle politesse, de
ranger sa motocyclette pour que je puisse
passer. Le petit homme s'énervait encore sur
son moteur poussif. Il me répondit donc, selon
les règles de la courtoisie parisienne,
d'aller me rhabiller. [...] Avec plus de
fermeté, je priai mon interlocuteur d'être
poli et de considérer qu'il entravait la
circulation. L'irascible personnage, exaspéré
sans doute par la mauvaise volonté, devenue
évidente, de son moteur, m'informa que si je
désirais ce qu'il appelait une dérouillée, il
me l'offrirait de grand cœur. Tant de cynisme
me remplit d'une bonne fureur et je sortis de
ma voiture dans l'intention de frotter les
oreilles de ce mal embouché. [...] Mais
j'étais à peine sur la chaussée, que, de la
foule qui commençait à s'assembler, un homme
sortit, se précipita sur moi, vint m'assurer
que j'étais le dernier des derniers et qu'il
ne me permettrait pas de frapper un homme qui
avait une motocyclette entre les jambes et
s'en trouvait, par conséquent, désavantagé. Je
fis face à ce mousquetaire et, en vérité, ne
le vis même pas. A peine, en effet, avais-je
la tête tournée que, presque en même temps,
j'entendis la motocyclette pétarader de
nouveau et je reçus un violent coup sur
l'oreille. Avant que j'aie eu le temps
d'enregistrer ce qui s'était passé, la
motocyclette s'éloigna.
© Gallimard, 1956.
|
 Efforcez-vous en même temps de réécrire ce texte en
puisant le plus possible dans les clichés suivants :
Efforcez-vous en même temps de réécrire ce texte en
puisant le plus possible dans les clichés suivants :
colère bleue - impérieuse nécessité - savoir
pertinemment - refuser catégoriquement - attendre de
pied ferme - fort comme un Turc - fier comme Artaban -
blanc comme un linge - en moins de temps qu'il n'en faut
pour le dire - prendre son courage à deux mains - comme
par enchantement - monter sur ses grands chevaux - de
vives remontrances -
4.
Raviver les clichés :
Si la langue s'use, et avec elle le regard que nous
portons sur les choses, le vrai travail de l'écrivain
doit porter sur la manière dont il débarrassera
l'expression de ses conventions routinières. Francis
Ponge a, plus que d'autres, montré comment la tâche
première d'un écrivain est de secouer la tyrannie
de la langue. Cela semble être d'abord le
privilège de la poésie, dont Jean Cocteau affirme ici le
pouvoir de dévoilement :
« Elle montre nues, sous une lumière qui secoue la
torpeur, les choses surprenantes qui nous environnent et
que nos sens enregistraient machinalement. [...] Car,
s'il est vrai que la multitude des regards patine les
statues, les lieux communs, chefs-d'œuvre éternels, sont
recouverts d'une épaisse patine qui les rend invisibles
et cache leur beauté.
Mettez un lieu commun en place, nettoyez-le,
frottez-le, éclairez-le de telle sorte qu'il frappe avec
sa jeunesse et avec la même fraîcheur, le même jet qu'il
avait à sa source, vous ferez œuvre de poète. »
(Le Secret professionnel, 1922).
André Breton de son côté montre que la
poésie « répugne à laisser passer tout ce qui peut
être déjà vu, entendu, convenu, à se servir de ce qui a
servi, si ce n'est en le détournant de son usage
préalable. » (Préface au Cahier d'un retour au
pays natal d'Aimé Césaire, 1947).
 Éviter les clichés donc, mais aussi les raviver, et ce
de deux manières :
Éviter les clichés donc, mais aussi les raviver, et ce
de deux manières :
Je
vois le portier de l'hôtel; je lui dis:
- Je voudrais voir la mer.
- Elle est démontée.
- Vous la remontez quand ?
- Question de temps.
Le sketch bien connu de Raymond Devos illustre ce souci
qu'ont eu bien des artistes de partir des poncifs du
langage pour créer un univers tout neuf. Ainsi Boris
Vian mit en scène dans L'Écume des jours
ce pharmacien qui, pour exécuter une ordonnance, utilisait
une guillotine de bureau, ou évoqua cet escalier usé
toutes les trois marches parce qu'on le gravissait quatre
à quatre.
A
votre tour, écrivez un petit texte où vous prendrez au
mot (c'est bien le cas !) les clichés suivants :
"avoir un chat dans la gorge" - "prendre une vessie
pour une lanterne".
Qu'un mot inattendu s'immisce dans l'expression toute faite,
et c'est du même coup un nouvel univers qui s'ouvre à nous.
Cela aussi, les artistes l'ont bien compris, notamment dans
les titres qu'ils ont donnés à leurs œuvres : par exemple Clair
de Terre, Mont de Piété (sans traits
d'union) pour André Breton, titres auxquels on pourrait
ajouter d'innombrables : Délit de justice - Chérie
noire - Deuil pour deuil - L'étroit mousquetaire
- Attention, chien léchant ! - Sévices compris...
C'est à ce travail que se livre Robert Desnos, notamment
dans Langage cuit où anagrammes, contrepèteries,
bribes de phrases toutes faites, dictons, fragments de
textes publicitaires contribuent à épousseter les
représentations inertes véhiculées par les conversations
courantes.
Ce
vieillard encore violet ou orangé ou rose porte un
pantalon en trompe d'éléphant.
Mon amour jette-moi ce regard chaud où se lisent de
blancs desseins !
Portrait au rallongé de nos âmes
Parlerons-nous à cœur fermé
et ce cœur sur le pied ?
Où jouerons-nous toute la nuit à la main froide ?
Robert Desnos, Corps et
biens (1930).
|
«
Sur le modèle d'élire domicile,
Laforgue décrit des oiseaux qui ont élu
volière dans les frondaisons; sur prise
de voile, Hugo fait de la mort des
héros, de leur entrée dans l'éternité, une
prise de suaires; Gide, épiant Claudel,
l'entend du coin de l'oreille
proclamer son admiration pour Baudelaire. »
Michel Rifaterre (Le cliché dans la prose
littéraire).
|
Essayez
de pervertir selon ce système des expressions toutes
faites et imaginez quelle histoire elles pourraient
coiffer de leur titre. Au besoin, écrivez-la !
 PUBLICITÉ ET DÉTOURNEMENT :
PUBLICITÉ ET DÉTOURNEMENT :
La
publicité est coutumière du détournement des œuvres d'art.
Elle en use afin d'ennoblir les produits en les chargeant de
connotations mélioratives (tradition, qualité...) et aussi
pour établir avec le lecteur une complicité d'ordre
culturel. Si elle peut être agitatrice en réactivant les
clichés, elle fait preuve ici le plus souvent d'un
aplatissement considérable des valeurs esthétiques qui, dès
lors, ne se prêtent plus avec elle qu'à des intentions
mercantiles.
Examinez
les deux images ci-dessous et dites en quoi les techniques
employées par Petrus Christus (XVème siècle) sont
détournées au service d'une intention vulgaire :
(voir
notre étude sur les pages BTS.)
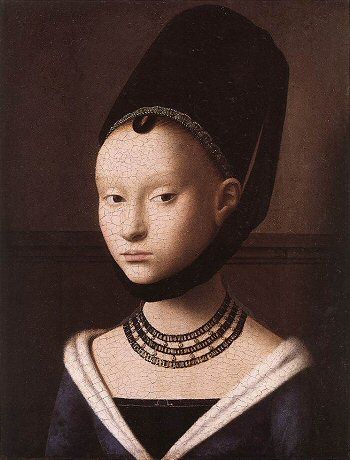
Petrus Christus,
Portrait de jeune femme, vers 1470.
|
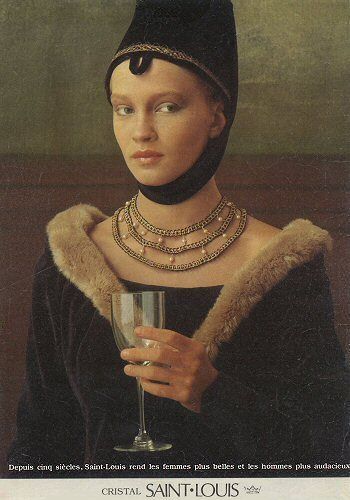 |
 Consulter
Consulter
|
|
(Antoine
Compagnon).
(David Blonde).
(Laurent Jenny).
(Laurent Perrin).
(Dailymotion).
|
|
|
 
|