 |
JULES
LAFORGUE
HÉRITAGE ET MODERNITÉ
ANALYSES ET COMMENTAIRES 2
|
| |
Triste,
triste (Le Sanglot de la
terre, 1901)
|

|
5
10
|
Je contemple
mon feu. J'étouffe un bâillement.
Le vent pleure. La pluie à ma vitre ruisselle.
Un piano voisin joue une ritournelle.
Comme la vie est triste et coule lentement.
Je songe à
notre Terre, atome d'un moment,
Dans l'infini criblé d'étoiles éternelles,
Au peu qu'ont déchiffré nos débiles prunelles,
Au Tout qui nous est clos inexorablement.
Et notre sort
! toujours la même comédie,
Des vices, des chagrins, le spleen, la maladie,
Puis nous allons fleurir les beaux pissenlits
d'or.
L'Univers
nous reprend, rien de nous ne subsiste,
Cependant qu'ici-bas tout continue encor.
Comme nous sommes seuls ! Comme la vie est
triste !
|
Le Sanglot de la Terre
correspond à une époque où Laforgue considère la poésie comme
un défouloir pour "métaphysicien adolescent". La
plupart de ces poèmes manifestent en effet une conscience
aiguë de l'éphémère qui trahit l'influence de Pascal et fait
de Laforgue, avec Schopenhauer, l'un des grands représentants
du pessimisme de son temps. De ce recueil, il dira : "Un
volume de vers que j'appelle philosophiques. Sans
prétention. Naïvement. Je croyais. Puis, brusque
déchirement. Deux ans de solitude dans les bibliothèques,
sans amour, sans amis, la peur de la mort. Des nuits à
méditer dans une atmosphère de Sinaï. Alors je m'étonne que
les philosophes qui exécutent quotidiennement l'idée de la
justice, les idoles religieuses, et métaphysiques, et
morales soient si peu émus, à croire qu'ils ne sont pas
persuadés de l'existence de ces choses." (Pensées
et paradoxes)
Ces propos ont guidé notre lecture de Triste,
triste : le tableau ci-dessous organise nos remarques
en deux axes de commentaire composé, qu'ont appelés
l'énonciation philosophique du texte et le registre lyrique
qui lui ajoute l'émotion vraie, voire la dérision annoncée par
le titre.
| AXE
DE LECTURE 1 : UN POÈME PHILOSOPHIQUE |
| Idées
directrices |
Procédés
relevés |
Interprétation |
| Un
songe métaphysique |
les
verbes "je songe", "je contemple" |
les
quatrains manifestent une progression de la
rêverie à la méditation |
| le
passage du "je" au "nous" |
le poème
prend vite l'allure d'une réflexion sur l'humanité
tout entière |
| le
vocabulaire scientifique et philosophique |
peu à
peu, le poète élève sa méditation jusqu'au
macrocosme et les termes matérialistes excluent
toute présence divine. |
| Disproportion
de l'homme dans l'univers |
les
majuscules ("Terre, Tout, Infini, Univers") |
la place
de l'homme dans l'Univers paraît dérisoire |
| l'antithèse
("atome d'un moment /étoiles éternelles") |
toute
entreprise humaine est frappée de vanité face à
l'immensité du mystère cosmique |
| Fatalité
de sa condition |
la place
privilégiée des adverbes "inexorablement,
toujours" |
la
conscience d'une limite naturelle empreint le
poème d'un pessimisme radical |
| le
présent de vérité générale |
les
formes sentencieuses accroissent encore
l'expression d'une condamnation irréversible |
| AXE
DE LECTURE 2 : UN POÈME LYRIQUE |
| Idées
directrices |
Procédés
relevés |
Interprétation |
| Le
rôle du décor |
les
termes descriptifs du premier quatrain |
un cadre
quotidien et banal qui favorise l'ennui |
| la
liquidité des consonnes |
la
sensation de l'écoulement, de la fluidité, prépare
la méditation métaphysique sur l'éphémère |
| Misère
de l'homme |
le champ
lexical de la fragilité : "peu, débiles, rien,
seuls" |
une vue
intégralement tragique de l'existence humaine
multiplie les indices de sa misère |
| les
discordances du premier tercet |
le
rythme, ample et lent le plus souvent, s'accélère
ici pour exprimer un cortège de misères |
| les
exclamatives |
la
tristesse est le lot obligé de la condition
humaine et inspire une émotion amère |
| La
dérision |
les
termes péjoratifs "débiles, comédie, vices,
chagrins" |
ironie
sarcastique à l'égard des prétentions humaines
(notamment en ce qui concerne la science) |
| le
cliché ravivé "nous allons fleurir les beaux
pissenlits d'or" |
la
valorisation poétique des pissenlits contraste
avec le cliché attendu |
|

|
|
Albums
(Des fleurs de bonne volonté, 1890)
|
5
10
15
20
25
30
|
On m'a dit la
vie au Far-West et les Prairies,
Et mon sang a gémi : « Que voilà ma patrie !...
»
Déclassé du vieux monde, être sans foi ni loi,
Desperado ! là-bas ; là-bas, je serais
roi !.... .
Oh là-bas, m'y scalper de mon cerveau d’Europe !
Piaffer, redevenir une vierge antilope,
Sans littérature, un gars de proie, citoyen
Du hasard et sifflant l'argot californien !
Un colon vague et pur, éleveur, architecte,
Chasseur, pêcheur, joueur, au-dessus des
Pandectes !
Entre la mer et les États Mormons ! Des
venaisons
Et du whisky ! vêtu de cuir, et le gazon
Des Prairies pour lit, et des ciels des premiers
âges
Riches comme des corbeilles de mariage !....
Et puis quoi ? De bivouac en bivouac, et la Loi
De Lynch ; et aujourd'hui des diamants bruts aux
doigts
Et ce soir nuit de jeu, et demain la refuite
Par la Prairie et vers la folie des pépites
!....
Et, devenu vieux, la ferme au soleil-levant,
Une vache laitière et des petits-enfants....
Et, comme je dessine au besoin, à l'entrée
Je mettrais : « Tatoueur des bras de la contrée
! »
Et voilà. Et puis, si mon grand cœur de Paris
Me revenait, chantant : « Oh ! pas encor guéri !
« Et ta postérité, pas pour longtemps coureuse
!.... »
Et si ton vol, Condor des Montagnes-Rocheuses,
Me montrait l'Infini ennemi du comfort , ,
Eh bien, j'inventerais un culte d'Âge d'or,
Un code social, empirique et mystique
Pour des Peuples Pasteurs, modernes et védiques
!....
Oh ! qu'ils sont beaux les feux de paille !
qu'ils sont fous,
Les albums ! et non incassables, mes joujoux
!....
|
Le titre Des fleurs de bonne
volonté (1890) fait explicitement acte d'allégeance
aux Fleurs du Mal dans le registre très laforguien
de l'humilité et de la parodie. Les poèmes qui composent
le recueil se sont dégagés de la métaphysique au profit d'une
expression plus resserrée et aussi plus concrète, comme en
témoigne une inspiration sensuelle que Laforgue doit peut-être
à la rencontre de Leah Lee.
Au vu de cette forme de plus en plus libérée, comme en
témoigne "Albums", on est en droit de se poser une question
qui commandera notre projet de lecture pour l'étude du poème :
son allure libre et enjouée, ses formes parfois dysharmoniques
cachent-elles une transformation des formes et des thèmes
laforguiens ? Peut-on croire qu'avec ce poème de la
"maturité", s'affirment un art poétique nouveau et une
inspiration plus optimiste ?
Comme pour les précédentes, notre lecture suivra les
étapes de la fiche
pratique  consacrée à l'étude du texte poétique.
consacrée à l'étude du texte poétique.
|
OBSERVATION |
INTERPRÉTATION |
1)
Situation de communication :
- qui parle ? un "je" omniprésent.
- à qui ? les indices du récepteur sont absents, mais
un discours rapporté apparaît au vers 25 qui
transforme le "je" en "tu". Il s'agit du discours
aigre et désenchanteur de "l'autre poète", celui du
spleen.
- de quoi ? de l'appétit de nouveauté, de l'aventure
et de la liberté qu'incarne le Far-West : toute une
mythologie se déverse de manière informelle (le
cow-boy et la Prairie; les cités des "outlaws", les
religions nouvelles). |
- une poésie
lyrique où s'expriment de manière sentimentale le rêve
et sa désillusion.
- ainsi l'élan vers le rêve américain semble conscient
de son illusion : la dissociation du moi trahit un
conflit où s'annule l'euphorie du rêve d'aventure et
de nouveauté.
- on constate à quel point les thèmes sont des clichés
déjà installés, des topoï, ce qui peut
expliquer qu'après la cascade de ces rêves, le poète
soit conscient de leur fragilité. |
| Bilan
: l'univers de ce poème est nouveau en
poésie, et le poète semble avoir rafraîchi sa
thématique. On constate aussi un élan, une envie de
vivre peu laforguiens. Mais si le rêve se dénonce en
cliché, si l'intuition de l'échec court dans tout le
poème, peut-on parler longtemps d'inspiration nouvelle
? |
2)
Versification :
- type de poème et de vers : il paraît
difficile d'observer quelque cohérence dans la
progression des thèmes. Dans une forme libre, les
alexandrins (hormis le vers 11) présentent un rythme
torturé. La césure s'y trouve rarement à l'hémistiche.
- type de rime : elles sont suivies. Deux rimes
féminines alternent avec deux rimes masculines. Les
rimes sont souvent riches, aux sonorités parfois
curieuses ("ecte"). |
-
l'assaut des motifs du rêve crée une dynamique
particulière : dans une sorte de chaos ou d'ivresse
s'entassent des images stéréotypées; l'envie de croire
à ces portes qui s'ouvrent sur l'ailleurs est trop
contrariée par la voix ricaneuse en coulisse pour ne
pas expliquer ce rythme précipité par la volonté de la
faire taire.
- un schéma très régulier, appliqué, presque
litanique. Rarement la dissonance exprime l'ailleurs,
la bizarrerie exotique tant convoitée. |
| Bilan
: La forme confirme les deux caractères
signalés. L'élan qui désarticule le rythme et exprime
les rêves frénétiques se présente comme une ribambelle
incontrôlée de clichés où se perçoit la tentation
laforguienne de l'"à-quoi-bon". |
3)
Structure grammaticale et versification :
- structure thématique : essayons d'y
discerner quelque ordre. Une introduction (1-4)
annonce rumeurs et stéréotypes venus du "monde de
l'On"; successivement défilent le thème de la Prairie
(5-14), de la cité (15-22), des religions nouvelles
(23-30), chaque étape introduite par une pause rapide
("et puis quoi, et voilà"). Deux vers expriment enfin
la retombée des rêves (31-32).
- rapport entre phrase et vers : de nombreux rejets
(vers 11, 15, 31) et un contre-rejet (vers 7); de très
nombreux enjambements. |
- la
progression de la rêverie fait l'inventaire désordonné
des thèmes porteurs et dénonce peu à peu leur
mensonge. Une certaine crispation du désir donne
l'impression d'une recherche hâtive d'issues
envisageables, et toutes condamnées par
l'inauthenticité de la rêverie.
- ces enjambements
traduisent le dynamisme du rêve et donnent tout leur
pouvoir de choc à certains mots. Cette forme très
fluide, qui nous happe d'un motif à l'autre, fait
aussi penser aux flux d'images incontrôlées et déjà
toutes prêtes.
|
| Bilan
: Nous observons certes une très grande
liberté dans l'ampleur dévastatrice que prend la
phrase dans le poème, où le rêve s'exprime sans
contrôle. Mais, en même temps, la phrase et le
structure du poème font penser à une certaine
crispation progressive qui ne culminera qu'avec l'aveu
d'un échec. La nervosité du poème tient beaucoup sans
doute de cette conscience progressive de la naïveté de
rêves fous. |
4)
Jeux sur le signifié :
- champs lexicaux : ils sont tous gouvernés
par la thématique du monde nouveau et de
l'ailleurs : liberté (aventure, évasion), sauvagerie,
rêve des origines et d'une certaine anarchie. C'est
pourquoi la métaphore "me scalper de mon cerveau
d'Europe" en dit l'essentiel.
- figures de rhétorique : il s'agit d'ailleurs de la
seule image vraiment neuve d'un poème par ailleurs
envahi de représentations naïves ("la vache laitière")
ou hyperboliques ("la vierge antilope"). |
Le titre
"Albums" fait songer à ces cahiers cartonnés que les
enfants remplissent d'images glanées çà et là. Cette
imagerie naïve, ce désordre s'expriment ici sans
contrôle, avec une distance de plus en plus visible.
Le projet que génère l'Ennui trouve, comme chez
Baudelaire, ses formes exotiques. Mais, chez Laforgue,
il est lui-même dénoncé par cette distance désabusée
que le poète observe à l'égard d'une rêverie qui se
découvre et s'annule peu à peu en tant que pur
stéréotype. |
| Bilan
: Le poème offre donc une imagerie marquée
par la soif de nouveauté, d'aventure et d'évasion,
mais l'excès, la naïveté et les formes convenues de la
rêverie manifestent plutôt une auto dérision qui
souligne l'impuissance du désir propre au spleen.
Ainsi la modernité du poème est à la fois dans sa
forme, dont les irrégularités disent le jaillissement
continu des tropismes, et dans cette
fascination morbide pour le vide. Laforgue passa à ce
titre pour le chef de file du mouvement décadent, que
Paul Bourget, plus heureusement, s'avisa de rebaptiser
"symboliste". |
| L’Hiver
qui vient (Derniers vers, extrait)
[...]
Allons, allons, et hallali !
C'est l'Hiver bien connu qui s'amène ;
Oh ! les tournants des grandes routes,
Et sans petit Chaperon Rouge qui chemine !...
Oh ! leurs ornières des chars de l'autre mois,
Montant en don quichottesques rails
Vers les patrouilles des nuées en déroute
Que le vent malmène vers les transatlantiques
bercails !...
Accélérons, accélérons, c'est la saison bien
connue, cette fois.
Et le vent,
cette nuit, il en a fait de belles !
Ô dégâts, ô nids, ô modestes jardinets !
Mon cœur et mon sommeil : ô échos des cognées
!...
Tous ces
rameaux avaient encor leurs feuilles vertes,
Les sous-bois ne sont plus qu'un fumier de
feuilles mortes ;
Feuilles, folioles, qu'un bon vent vous emporte
Vers les étangs par ribambelles,
Ou pour le feu du garde-chasse,
Ou les sommiers des ambulances
Pour les soldats loin de la France.
C'est la
saison, c'est la saison, la rouille envahit les
masses,
La rouille ronge en leurs spleens kilométriques
Les fils télégraphiques des grandes routes où
nul ne passe.
Les cors, les
cors, les cors - mélancoliques !...
Mélancoliques !...
S'en vont, changeant de ton,
Changeant de ton et de musique,
Ton ton, ton taine, ton ton !...
Les cors, les cors, les cors !...
S'en sont allés au vent du Nord.
Je ne puis
quitter ce ton : que d'échos !...
C'est la saison, c'est la saison, adieu
vendanges !...
Voici venir les pluies d'une patience d'ange,
Adieu vendanges, et adieu tous les paniers,
Tous les paniers Watteau des bourrées sous les
marronniers,
C'est la toux dans les dortoirs du lycée qui
rentre,
C'est la tisane sans le foyer,
La phtisie pulmonaire attristant le quartier,
Et toute la misère des grands centres.
Mais,
lainages, caoutchoucs, pharmacie, rêve,
Rideaux écartés du haut des balcons des grèves
Devant l'océan de toitures des faubourgs,
Lampes, estampes, thé, petits-fours,
Serez-vous pas mes seules amours !
(Oh ! et puis, est-ce que tu connais, outre les
pianos,
Le sobre et vespéral mystère hebdomadaire
Des statistiques sanitaires
Dans les journaux ?)
Non, non !
C'est la saison et la planète falote !
Que l'autan, que l'autan
Effiloche les savates que le Temps se tricote !
C'est la saison. Oh déchirements ! c'est la
saison !
Tous les ans, tous les ans,
J'essaierai en chœur d'en donner la note.
|
|
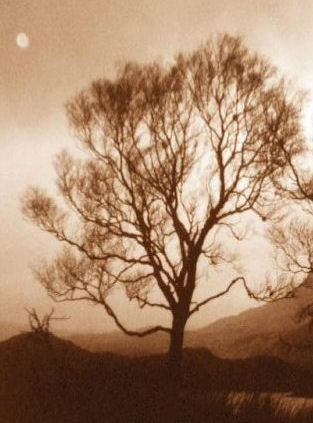

|
J'aime l'hiver, qui
vient purger mon cœur du vice,
Comme de peste l'air, la terre de serpents.
Agrippa d'Aubigné
 Projet de lecture : la modernité - le vers libre
Projet de lecture : la modernité - le vers libre
Les progrès techniques du XIX° siècle
ont vite remodelé le décor urbain : machines, chemins de fer,
usines... Ces nouveaux motifs, beaucoup d'artistes s'en sont
effrayé. D'autres ont au contraire voulu saisir cette beauté
nouvelle ("Il faut être résolument moderne", clame
Rimbaud). Le concept de modernité est lié à ce refus de
perpétuer des formes surannées et à cette volonté d'aller à la
recherche de l'esprit du temps. Le mot modernité est
introduit par Chateaubriand, mais c'est Baudelaire qui en a
donné la définition : "Il est beaucoup plus commode de
déclarer que tout est absolument laid dans l'habit d'une
époque, que de s'appliquer à en extraire la beauté
mystérieuse qui y peut être contenue, si minime ou si légère
qu'elle soit. La modernité, c'est le transitoire, le
fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre
moitié est l'éternel et l'immuable. [...] Cet
élément transitoire, fugitif, dont les métamorphoses sont si
fréquentes, vous n'avez pas le droit de le mépriser ou de
vous en passer. En le supprimant, vous tombez forcément dans
le vide d'une beauté abstraite et indéfinissable, comme
celle de l'unique femme avant le premier péché."
(Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne in
Curiosités esthétiques).
Ainsi la modernité se trouve au centre de cette
problématique dont Laforgue est familier : être moderne, c'est
ouvrir son regard à la nouveauté et chercher les formes les
mieux capables de l'exprimer; c'est aussi en extraire la part
d'universel et d'immuable, pour ne pas dire l'âme,
comme Baudelaire tire de la boue parisienne l'or
des Fleurs du Mal. Ces formes, à vrai dire,
Baudelaire les avait lui-même moins bousculées que d'autres,
fidèle, par exemple, au sonnet comme au vers régulier. Dans
"L'Hiver qui vient", Laforgue évolue au contraire vers un
bouleversement radical qui tient moins à la thématique qu'au
décor et à la volonté de transcrire une sorte de monologue
parlé. Stéphane Mallarmé saluera ainsi chez Laforgue « une mutinerie en la vacance du vieux moule fatigué, [initiant] au charme certain du vers faux » (Crise de vers, 1897).
"L'Hiver qui vient" parut dans
le numéro du 16-25 août 1886 de La Vogue,
revue que dirigeait Gustave Kahn. Ce dernier passe souvent
pour l'inventeur du vers libre. Mais les poèmes en prose
"Marine" et "Mouvement" des Illuminations de
Rimbaud peuvent à juste titre figurer comme les premières
expériences en la matière. On sait que ce recueil bouleversa
Laforgue, qui écrivit alors à Kahn : "Ce Rimbaud fut bien
un cas, c'est un des rares qui m'étonnent. Comme
il est entier! presque sans rhétorique et sans attaches".
Par ailleurs, la traduction par Laforgue de Leaves of
grass de Walt Whitman n'a pu manquer de lui suggérer la
possibilité de créer un vers affranchi des règles et souvent
très long.
Laforgue s'engagea dans cette voie nouvelle avec
enthousiasme ("J'oublie de rimer, j'oublie le nombre des
syllabes, j'oublie la distribution des strophes, mes lignes
commencent à la marge comme de la prose. L'ancienne strophe
régulière ne reparaît que lorsqu'elle peut être un quatrain
populaire"), conscient d'avoir trouvé là un moyen
d'exprimer "la naissance simultanée de l'idée et de son
expression" (Viélé-Griffin).
Nous consacrons la lecture dirigée de "L'Hiver qui
vient" aux thèmes et aux formes de la modernité transportés
par ce vers libre :
 modernité
des termes : "transatlantiques,
télégraphiques, caoutchoucs, kilométriques, phtisie,
statistiques". Ces termes, qui sont encore à l'époque
de Laforgue des néologismes, ont en outre des sonorités
agressives (les dentales, les palatales) qui contribuent à
créer un univers discordant. Ils donnent l'image d'un monde
que redessine la science, avec ses mesures et ses normes.
Tissées dans la nature hivernale, ces lignes géométriques en
accentuent l'âpre nudité et en font ce désert "où nul ne
passe". modernité
des termes : "transatlantiques,
télégraphiques, caoutchoucs, kilométriques, phtisie,
statistiques". Ces termes, qui sont encore à l'époque
de Laforgue des néologismes, ont en outre des sonorités
agressives (les dentales, les palatales) qui contribuent à
créer un univers discordant. Ils donnent l'image d'un monde
que redessine la science, avec ses mesures et ses normes.
Tissées dans la nature hivernale, ces lignes géométriques en
accentuent l'âpre nudité et en font ce désert "où nul ne
passe".
 modernité
des
lieux : "les fils télégraphiques des
grandes routes, la toux dans les dortoirs du lycée qui
rentre, la misère des grands centres,
l'océan de toitures des faubourgs, des statistiques
sanitaires dans les journaux". Ce sont les hauts lieux
du spleen, dont ils disent la complexité arachnéenne, la
noirceur, la solitude et la pathologie. Ils s'opposent ainsi
aux décors de l'automne passé. Mais la structure du poème
traduit ce sursaut soudain du poète décidé à chanter néanmoins
l'ingrate saison, à en découvrir même la volupté ("Mais,
lainages, caoutchoucs, pharmacie, rêve, [...] Serez-vous
pas mes seules amours !"). Intention toute moderne, ici
encore, de découvrir la beauté secrète de lieux condamnés à la
laideur au nom de critères dépassés. modernité
des
lieux : "les fils télégraphiques des
grandes routes, la toux dans les dortoirs du lycée qui
rentre, la misère des grands centres,
l'océan de toitures des faubourgs, des statistiques
sanitaires dans les journaux". Ce sont les hauts lieux
du spleen, dont ils disent la complexité arachnéenne, la
noirceur, la solitude et la pathologie. Ils s'opposent ainsi
aux décors de l'automne passé. Mais la structure du poème
traduit ce sursaut soudain du poète décidé à chanter néanmoins
l'ingrate saison, à en découvrir même la volupté ("Mais,
lainages, caoutchoucs, pharmacie, rêve, [...] Serez-vous
pas mes seules amours !"). Intention toute moderne, ici
encore, de découvrir la beauté secrète de lieux condamnés à la
laideur au nom de critères dépassés.
 raccourcis,
ellipses,
invention verbale : l'aspect le plus
radical de la révolution poétique - et romanesque - du XX°
siècle est d'avoir capté les sources du langage à l'endroit où
il n'est pas encore articulé et se présente comme un
jaillissement de tropismes ("que d'échos !").
Ce discours, auquel les surréalistes laisseront l'articulation
syntaxique, se présente ici sous la forme de raccourcis dont
"Albums" donnait déjà une idée. Ainsi l'expression "Tous
les paniers Watteau des bourrées sous les marronniers"
condense les représentations galantes appelées par les
tableaux de Watteau et les connotations nostalgiques des rites
automnaux. Un semblable souci de l'ellipse commande une
invention verbale systématique chez le
poète et plus rare ici (don quichottesques,
dont le premier emploi revient à Laforgue). raccourcis,
ellipses,
invention verbale : l'aspect le plus
radical de la révolution poétique - et romanesque - du XX°
siècle est d'avoir capté les sources du langage à l'endroit où
il n'est pas encore articulé et se présente comme un
jaillissement de tropismes ("que d'échos !").
Ce discours, auquel les surréalistes laisseront l'articulation
syntaxique, se présente ici sous la forme de raccourcis dont
"Albums" donnait déjà une idée. Ainsi l'expression "Tous
les paniers Watteau des bourrées sous les marronniers"
condense les représentations galantes appelées par les
tableaux de Watteau et les connotations nostalgiques des rites
automnaux. Un semblable souci de l'ellipse commande une
invention verbale systématique chez le
poète et plus rare ici (don quichottesques,
dont le premier emploi revient à Laforgue).
 monologue
parlé : la poésie de Laforgue en est
coutumière. Les poèmes que nous avons précédemment étudiés
offrent tous des exemples du relâchement syntaxique propre à
une oralité familière. Ici les nombreuses interjections, les
exclamatives, les invocations, les apostrophes accentuent la
tonalité lyrique mais, par les nombreux changements de
registre, modèrent aussi le pathétique : accablé par l'hiver,
le poète figure ses tempêtes par celles de l'expression. monologue
parlé : la poésie de Laforgue en est
coutumière. Les poèmes que nous avons précédemment étudiés
offrent tous des exemples du relâchement syntaxique propre à
une oralité familière. Ici les nombreuses interjections, les
exclamatives, les invocations, les apostrophes accentuent la
tonalité lyrique mais, par les nombreux changements de
registre, modèrent aussi le pathétique : accablé par l'hiver,
le poète figure ses tempêtes par celles de l'expression.
 versification
:
l'inégalité du vers contribue la première
à saisir cette disparité de l'inspiration. Renonçant à la
métrique classique (même si de nombreux alexandrins,
octosyllabes etc. se décèlent encore dans le poème), Laforgue
veille à ce qu'une large amplitude épouse le souffle du
narrateur. Il manifeste ici une prédilection pour le vers
impair (9, 13, 15 syllabes) dans les formulations les plus
âpres de la déroute hivernale, cependant que le vers plus
court est préféré lorsqu'une petite chanson populaire semble
éclore ("Les cors, les cors, les cors !... / S'en sont
allés au vent du Nord"). La rime reste, elle, bien
présente, ce qui limite notablement l'acception de vers libre,
mais sa distribution est généralement capricieuse et certains
mots restent sans écho. versification
:
l'inégalité du vers contribue la première
à saisir cette disparité de l'inspiration. Renonçant à la
métrique classique (même si de nombreux alexandrins,
octosyllabes etc. se décèlent encore dans le poème), Laforgue
veille à ce qu'une large amplitude épouse le souffle du
narrateur. Il manifeste ici une prédilection pour le vers
impair (9, 13, 15 syllabes) dans les formulations les plus
âpres de la déroute hivernale, cependant que le vers plus
court est préféré lorsqu'une petite chanson populaire semble
éclore ("Les cors, les cors, les cors !... / S'en sont
allés au vent du Nord"). La rime reste, elle, bien
présente, ce qui limite notablement l'acception de vers libre,
mais sa distribution est généralement capricieuse et certains
mots restent sans écho.
 sonorités
: c'est par elles que le poème fait le
mieux résonner tous les échos de l'hiver et justifie qu'il
soit défini comme la volonté d'en "donner la note" : aux
allitérations agressives soulignées plus haut, s'ajoutent
ainsi les consonnes liquides ("Allons, allons, et hallali
!"). sonorités
: c'est par elles que le poème fait le
mieux résonner tous les échos de l'hiver et justifie qu'il
soit défini comme la volonté d'en "donner la note" : aux
allitérations agressives soulignées plus haut, s'ajoutent
ainsi les consonnes liquides ("Allons, allons, et hallali
!").
Ainsi
l'évolution
de Laforgue vers le vers libre n'est pas une révolution
inattendue dans son parcours. Bien des caractères de ses
poèmes de jeunesse l'annoncent déjà. Le terme de modernité
peut en ce sens convenir à l'œuvre tout entière : marqué
par le transitoire et le fugitif, Laforgue n'a eu de cesse
d'en peindre les formes autour de lui afin d'en tirer
l'essence non périssable de son émotion et de son art.
 
|