|
UTILISER UN CORPUS DE DOCUMENTS
|
|
Objets
d'étude :
La littérature d'idées et la presse du XIXème au XXIème
siècle
Le roman et le récit du
XVIIIème au XXIème siècle.
Œuvre
concernée : Montesquieu,
Lettres
persanes.
|
|
Les
pages qui suivent vous proposent des exercices
progressifs qui décomposent la démarche
classique de la dissertation et précisent les
différents types de plans.
L'ensemble des sujets porte aujourd'hui sur une
des œuvres au choix parmi celles que le
programme a imposées. Il s'agit donc d'une
dissertation littéraire et l'on peut craindre
qu'elle soit l'occasion d'une fourre-tout où le
candidat peut être tenté de régurgiter des
fiches plus ou moins apprises. C'est l'écueil
majeur qu'il vous faut éviter. Votre
dissertation aura surtout à profiter de la
documentation personnelle que vous aurez su
rassembler devant le sujet posé : votre
connaissance de l'œuvre en question, bien sûr,
mais aussi vos lectures annexes et personnelles,
ceci constituant un corpus véritablement
original.
C'est pourquoi nous ouvrons cette section
consacrée à la dissertation par un exemple de
corpus et quelques pistes d'utilisation dans
l'optique d'un sujet qui concernerait la peine
de mort et l'efficacité de certains discours
dans la mobilisation du récepteur.
|
Voir sur Amazon :
|
|
 Prenez
d'abord connaissance des cinq documents suivants : Prenez
d'abord connaissance des cinq documents suivants :
 |
DOCUMENT
1
Victor HUGO Lettre à Lord
Palmerston (Actes et paroles II, 1875).
[Fortement
impressionné, enfant, par la vision d’un condamné
conduit à l’échafaud sur une place de Burgos puis,
à l’adolescence, par les préparatifs du bourreau
dressant la guillotine en place de Grève, Victor
Hugo fut toute sa vie un adversaire résolu de la
peine de mort. En exil à Guernesey, il assiste en
1854 à l'exécution de John-Charles Tapner,
condamné à mort pour assassinat, et fait part
aussitôt de son indignation à Lord Palmerston,
alors secrétaire à l'Intérieur.]
Marine-Terrace,
11 février 1854
|
|
Dès
le point du jour une multitude immense fourmillait
aux abords de la geôle. Un jardin était attenant à
la prison. On y avait dressé l'échafaud. Une brèche
avait été faite au mur pour que le condamné passât.
A huit heures du matin, la foule encombrant les rues
voisines, deux cents spectateurs « privilégiés »
étant dans le jardin, l'homme a paru à la brèche. Il
avait le front haut et le pas ferme ; il était pâle
; le cercle rouge de l'insomnie entourait ses yeux.
Le mois qui venait de s'écouler venait de le
vieillir de vingt années. Cet homme de trente ans en
paraissait cinquante. « Un bonnet de coton blanc
profondément enfoncé sur la tête et relevé sur le
front, - dit un témoin oculaire, - vêtu de la
redingote brune qu'il portait aux débats, et chaussé
de vieilles pantoufles », il a fait le tour d'une
partie du jardin dans une allée exprès. Les
bordiers, le shérif, le lieutenant-shérif, le
procureur de la reine, le greffier et le sergent de
la reine l'entouraient. Il avait les mains liées ;
mal, comme vous allez voir. Pourtant, selon l'usage
anglais, pendant que les mains étaient croisées par
les liens sur la poitrine, une corde rattachait les
coudes derrière le dos. Il marchait l'œil fixé sur
le gibet. Tout en marchant il disait à voix haute :
Ah mes pauvres enfants ! A côté de lui, le chapelain
Bouwerie, qui avait refusé de signer la demande en
grâce, pleurait.
L'allée sablée menait à l'échelle. Le nœud
pendait. Tapner a monté. Le bourreau d'en bas
tremblait ; les bourreaux d'en bas sont quelquefois
émus. Tapner s'est mis lui-même sous le nœud coulant
et y a passé son cou, et, comme il avait les mains
peu attachées, voyant que le bourreau, tout égaré,
s'y prenait mal, il l'a aidé. Puis, « comme s'il
pressentait ce qui allait suivre, » - dit le même
témoin, - il a dit : « Liez-moi donc mieux les
mains. - C'est inutile, a répondu le bourreau. »
Tapner étant ainsi debout dans le nœud coulant, les
pieds sur la trappe, le bourreau a rabattu le bonnet
sur son visage, et l'on n'a plus vu de cette face
pâle qu'une bouche qui priait. La trappe, prête à
s'ouvrir sous lui, avait environ deux pieds carrés.
Après quelques secondes, le temps de se retourner,
l'homme des « hautes œuvres » a pressé le ressort de
la trappe. Un trou s'est fait sous le condamné, il y
est tombé brusquement, la corde s'est tendue, le
corps a tourné, on a cru l'homme mort. « On pensa,
dit le témoin, que Tapner avait été tué raide par la
rupture de la moelle épinière. » Il était tombé de
quatre pieds de haut, et de tout son poids, et
c'était un homme de haute taille ; et le témoin
ajoute : « Ce soulagement des cœurs oppressés ne
dura pas deux minutes. »
Tout à coup, l'homme, pas encore cadavre et
déjà spectre, a remué ; les jambes se sont élevées
et abaissées l'une après l'autre comme si elles
essayaient de monter des marches dans le vide, ce
qu'on entrevoyait de la face est devenu horrible,
les mains, presque déliées, s'éloignaient et se
rapprochaient « comme pour demander assistance, »
dit le témoin. Le lien des coudes s'était rompu à la
secousse de la chute. Dans ces convulsions, la corde
s'est mise à osciller, les coudes du misérable ont
heurté le bord de la trappe, les mains s'y sont
cramponnées, le genou droit s'y est appuyé, le corps
s'est soulevé, et le pendu s'est penché sur la
foule. Il est retombé, puis a recommencé. Deux fois,
dit le témoin. La seconde fois il s'est dressé à un
pied de hauteur ; la corde a été à un moment lâche.
Puis il a relevé son bonnet et la foule a vu ce
visage. Cela durait trop, à ce qu'il paraît. Il a
fallu finir. Le bourreau, qui était descendu, est
remonté, et a fait, je cite toujours le témoin
oculaire, « lâcher prise au patient. » La corde
avait dévié ; elle était sous le menton ; le
bourreau l'a remise sous l'oreille : après quoi il a
« pressé les épaules. » Le bourreau et le spectre
ont lutté un moment ; le bourreau a vaincu. Puis cet
infortuné, condamné lui-même, s'est précipité dans
le trou où pendait Tapner, lui a étreint les deux
genoux et s'est suspendu à ses pieds. La corde s'est
balancée à un moment, portant le patient et le
bourreau, le crime et la loi. Enfin, le bourreau a
lui-même « lâché prise ». C'était fait.
L'homme était mort.
Vous le voyez, monsieur, les choses se sont
bien passées. Cela a été complet. Si c'est un cri
d'horreur qu 'on a voulu, on l'a.
La ville étant bâtie en amphithéâtre, on
voyait cela de toutes les fenêtres. Les regards
plongeaient dans le jardin.
La foule criait : shame ! shame ! shame
! Des femmes sont tombées évanouies. Pendant
ce temps-là, Fouquet, le gracié de 1851, se repent.
Le bourreau a fait de Tapner un cadavre; la clémence
a refait de Fouquet un homme. Dernier détail. Entre
le moment où Tapner est tombé dans le trou de la
trappe et l’instant où le bourreau, ne sentant plus
de frémissement, lui a lâché les pieds, il s’est
écoulé douze minutes. Douze minutes ! Qu’on calcule
combien cela fait de temps, si quelqu’un sait à
quelle horloge se comptent les minutes de l’agonie !
Voilà donc, monsieur, de quelle façon Tapner est
mort. Cette exécution a coûté cinquante mille
francs. C’est un beau luxe. Quelques amis de la
peine de mort disent qu’on aurait pu avoir cette
strangulation pour « vingt-cinq livres sterling ».
Pourquoi lésiner ? Cinquante mille francs ! quand on
y pense, ce n’est pas trop cher ; il y a beaucoup de
détails dans cette chose-là. On voit l’hiver, à
Londres, dans de certains quartiers, des groupes
d’êtres pelotonnés dans les angles des rues, au coin
de portes, passant ainsi les jours et les nuits,
mouillés, affamés, glacés, sans abri, sans vêtements
et sans chaussures, sous le givre et sous la pluie.
Ces êtres sont des vieillards, des enfants et des
femmes ; presque tous irlandais ; comme vous,
monsieur. Contre l’hiver ils ont la rue, contre la
neige ils ont la nudité, contre la faim ils ont le
tas d’ordures voisin. C’est sur ces indigences-là
que le budget prélève les cinquante mille francs
donnés au bourreau Rooks. Avec ces cinquante mille
francs, on ferait vivre pendant un an cent de ces
familles. Il vaut mieux tuer un homme. Ceux qui
croient que le bourreau Rooks a commis quelque
maladresse paraissent être dans l’erreur.
L’exécution de Tapner n’a rien que de simple. C’est
ainsi que cela doit se passer. Un nommé Tawel a été
pendu récemment par le bourreau de Londres, qu’une
relation que j’ai sous les yeux qualifie ainsi : «
Le maître des exécuteurs, celui qui s’est acquis une
célébrité sans rivale dans sa peu enviable
profession. » Eh bien, ce qui est arrivé à Tapner
était arrivé à Tawel. On aurait tort de dire
qu’aucune précaution n’avait été prise pour Tapner.
Le jeudi 9, quelques zélés de la peine capitale
avaient visité la potence déjà toute prête dans le
jardin. S’y connaissant, ils avaient remarqué que «
la corde était grosse comme le pouce et le nœud
coulant gros comme le poing ». Avis avait été donné
au procureur royal, lequel avait fait remplacer la
grosse corde par une corde fine. De quoi se
plaindrait-on ? Tapner est resté une heure au gibet.
L’heure écoulée, on l’a détaché ; et le soir, à huit
heures, on l’a enterré dans le cimetière dit des
étrangers, à côté du supplicié de 1830, Béasse. Il y
a encore un autre être condamné. C’est la femme de
Tapner. Elle s’est évanouie, deux fois en lui disant
adieu ; le second évanouissement a duré une
demi-heure ; on l’a crue morte. Voilà, monsieur, j’y
insiste, de quelle façon est mort Tapner. Un fait
que je ne puis vous taire, c’est l’unanimité de la
presse locale sur ce point : — Il n’y aura plus
d’exécution à mort dans ce pays, l’échafaud n’y sera
plus toléré. La Chronique de Jersey du 11 février
ajoute : « Le supplice a été plus atroce que le
crime. » J’ai peur que, sans le vouloir, vous n’ayez
aboli la peine de mort à Guernesey. Je livre en
outre à vos réflexions ce passage d’une lettre que
m’écrit un des principaux habitants de l’île : «
L’indignation était au comble, et si tous avaient pu
voir ce qui se passait sous le gibet, quelque chose
de sérieux serait arrivé, on aurait tâché de sauver
celui qu’on torturait. » […]
Prenez garde. L’avenir approche. Vous croyez
vivant ce qui est mort et vous croyez mort ce qui
est vivant. La vieille société est debout, mais
morte, vous dis-je. Vous vous êtes trompés. Vous
avez mis la main dans les ténèbres sur le spectre et
vous en avez fait votre fiancée. Vous tournez le dos
à la vie ; elle va tout à l’heure se lever derrière
vous. Quand nous prononçons ces mots, progrès,
révolution, liberté, humanité, vous souriez, homme
malheureux, et vous nous montrez la nuit où nous
sommes et où vous êtes. Vraiment, savez-vous ce
qu’est que cette nuit ? Apprenez-le, avant peu les
idées en sortiront énormes et rayonnantes. La
démocratie, c’était hier la France ; ce sera demain
l’Europe. L’éclipse actuelle masque le mystérieux
agrandissement de l’astre.
Je suis, monsieur, votre serviteur,
Victor Hugo.
|
|
 Complément : Le texte le plus célèbre de Hugo
concernant la peine de mort est Le
Dernier jour d'un condamné. Vous
trouverez ce document en deux parties (extrait
1 - extrait
2) dans les pages relatives à la
réfutation et au réquisitoire.
Complément : Le texte le plus célèbre de Hugo
concernant la peine de mort est Le
Dernier jour d'un condamné. Vous
trouverez ce document en deux parties (extrait
1 - extrait
2) dans les pages relatives à la
réfutation et au réquisitoire.
|
|
DOCUMENT
2
Auguste VILLIERS DE
L'ISLE-ADAM Le réalisme dans la
peine de mort (1885)
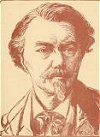 Or, cette
guillotine tombée, sournoise, oblique, dépourvue
de l'indispensable mesure de solennité qui est
inhérente à ce qu'elle ose, a simplement l'air
d'une embûche placée sur un chemin. Je n'y
reconnais que le talion social de la mort,
c'est-à-dire l'équivalent de l'instrument du
crime.
Or, cette
guillotine tombée, sournoise, oblique, dépourvue
de l'indispensable mesure de solennité qui est
inhérente à ce qu'elle ose, a simplement l'air
d'une embûche placée sur un chemin. Je n'y
reconnais que le talion social de la mort,
c'est-à-dire l'équivalent de l'instrument du
crime.
Bref, on va se venger ici,
c'est-à-dire équilibrer le meurtre par le
meurtre, - voilà tout, c'est-à-dire commettre un
nouveau meurtre sur le prisonnier ligoté qui va
sortir et que nous guettons pour l'égorger à
son tour. Cela va se passer en famille.
Mais, encore une fois, c'est méconnaître ce qui
peut seul conférer le droit de tuer dans cet
esprit-là, de cette façon-là.
L'ombre que projette cette lame terne sur
nos pâleurs nous donne à tous des airs de
complices : pour peu qu'on y touche encore d'une
ligne, cela va sentir l'assassinat ! Au nom de
tout sens commun, il faut exhausser, à hauteur acceptable,
notre billot national. Le devoir de l'État est
d'exiger que l'acte suprême de sa justice se
manifeste sous des dehors mieux séants. Et puis,
s'il faut tout avouer, la Loi, pour sa dignité
même, qui résume celle de tous, n'a pas à
traiter avec tant de révoltant dédain cette
forme humaine qui nous est commune avec le
condamné et en France, définitivement, on ne
peut saigner ainsi, à ras de terre, que les
pourceaux ! La justice a l'air de parler argot,
devant les dalles ; elle ne dit pas : Ici l'on
tue ; mais : Ici l'on rogne. Que
signifient ces deux cyniques ressorts à boudins
qui amortissent sottement le bruit grave du
couteau ? Pourquoi sembler craindre qu'on
l'entende ? - Ah ! mieux vaudrait abolir tout à
fait cette vieille loi que d'en travestir ainsi
la manifestation ! Ou restituons à la Justice
l'Échafaud dans toute son horreur salubre et
sacrée, ou reléguons à l'abattoir, sans autres
atermoiements homicides, cette guillotine déchue
et mauvaise, qui humilie la nation, écœure et
scandalise tous les esprits et ne fait
grand'peur à personne.
Rapprochons-nous. C'est pour... dans
quelques instants.
Me voici tout auprès du sombre instrument
: j'ai pris place dans une sorte d'éclaircie de
l'allée vivante dont il a été parlé. Il faut
examiner jusqu'à la fin tout cet
accomplissement.
Quatre heures et demie sonnent. Les
formalités du réveil et de la hideuse toilette
sont terminées. A travers la petite porte,
scindée dans le portail même de la prison, je
vois qu'on lève la grille de l'intérieur : le
condamné est en marche vers nous, déjà, sous les
galeries - et... avant un instant... Ah ! les
deux vastes battants du noir portail
s'entr'ouvrent et roulent silencieusement sur
leurs gonds huilés.
Les voici tout grands ouverts. A ce
signal, vu aux lointains, de tous côtés, on se
tait ; les cœurs se serrent ; j'entends le
bruissement des sabres ; je me découvre.
L'exécuteur apparaît, - le premier, cette
fois ! - puis, un homme, en bras de chemise, les
mains liées au dos, - près de lui, le prêtre : -
Derrière eux, les aides, le chef de la sûreté
publique et le directeur de la prison. C'est
tout. - Ah ! le malheureux !... - Oui, voilà
bien une face terrible. La tête haute, blafard,
le cou très nu, les orbites agrandis, le regard
errant sur nous une seconde, puis fixe à
l'aspect de ce qu'il aperçoit en face de lui. De
très courtes mèches de cheveux noirs, inégales,
se hérissent par place sur cette tête résolue et
farouche. Son pas ralenti par des entraves, est
ferme, car il ne veut pas chanceler. -
Le pauvre prêtre, qui, pour lui cacher la vue du
couteau et lui montrer l'au-delà du ciel, élève
son crucifix qui tremble, est aussi blanc que
lui.
A moitié route, l'infortuné toise la
mécanique :
- Ça... ? C'est là-dessus ?...dit-il
d'une voix inoubliable.
Il aperçoit la grande manne en treillis,
béante, au couvercle soutenu par une pioche.
Mais le prêtre s'interpose et, sur la licence
que lui en octroie celui qui va périr, lui donne
le dernier embrassement de l'Humanité.
Ah ! lorsque sa mère, autrefois, le
berçait, tout enfant, le soir, et, souriante,
l'embrassait, heureuse et toute fière, - qui lui
eût montré, à cette mère, cet embrassement-ci au
fond de l'avenir !
Le voici, debout, en face de la planche.
Soudain - pendant qu'il jette un coup
d’œil presque furtif sur le couteau - la pesée
d'un aide fait basculer le condamné sur cette
passerelle de l'abîme ; l'autre moitié de la
cangue s'abaisse : l'exécuteur touche le
déclic... un éclair glisse... plouff ! - Pouah !
quel éclaboussis ! Deux ou trois grosses gouttes
rouges sautent autour de moi. Mais déjà le tronc
gît, précipité, dans le panier funèbre.
L'exécuteur, s'inclinant très vite, prend quelque
chose dans une espèce de baignoire
d'enfant, placée en dehors, sous la
guillotine...
La tête que tient, maintenant, par
l'oreille gauche, - le bourreau de France - et
qu'il nous montre - est immobile, très pâle - et
les yeux sont hermétiquement fermés.
Détournant les regards vers le sol, que
vois-je, à quelques pouces de ma semelle !...
La pointe du Couteau-glaive de notre
Justice Nationale effleurer piteusement la
sanglante boue du matin !
|
 |
DOCUMENT
3
Dessin
(L’Assiette au beurre, 9 mars 1907)
«
IL FAUT GUILLOTINER, PARCE QUE...
les
robes des Procureurs
ont besoin de temps en temps d'être
reteintes en rouge.»
|
| DOCUMENT
4
Albert CAMUS L'Étranger,
II, V (1942)
 J'ai
cru longtemps - et je ne sais pas pourquoi - que
pour aller à la guillotine, il fallait monter
sur un échafaud, gravir des marches. Je crois
que c'était à cause de la Révolution de 1789, je
veux dire à cause de tout ce qu'on m'avait
appris ou fait voir sur ces questions. Mais un
matin, je me suis souvenu d'une photographie
publiée par les journaux à l'occasion d'une
exécution retentissante. En réalité, la machine
était posée à même le sol, le plus simplement du
monde. Elle était beaucoup plus étroite que je
ne le pensais. C'était assez drôle que je ne
m'en fusse pas avisé plus tôt. Cette machine sur
le cliché m'avait frappé par son aspect
d'ouvrage de précision, fini et étincelant. On
se fait toujours des idées exagérées de ce qu'on
ne connaît pas. Je devais constater au contraire
que tout était simple : la machine est au même
niveau que l'homme qui marche vers elle. Il la
rejoint comme on marche à la rencontre d'une
personne. Cela aussi était ennuyeux. La montée
vers l'échafaud, l'ascension en plein ciel,
l'imagination pouvait s'y raccrocher. Tandis
que, là encore, la mécanique écrasait tout : on
était tué discrètement, avec un peu de honte, et
beaucoup de précision.
J'ai
cru longtemps - et je ne sais pas pourquoi - que
pour aller à la guillotine, il fallait monter
sur un échafaud, gravir des marches. Je crois
que c'était à cause de la Révolution de 1789, je
veux dire à cause de tout ce qu'on m'avait
appris ou fait voir sur ces questions. Mais un
matin, je me suis souvenu d'une photographie
publiée par les journaux à l'occasion d'une
exécution retentissante. En réalité, la machine
était posée à même le sol, le plus simplement du
monde. Elle était beaucoup plus étroite que je
ne le pensais. C'était assez drôle que je ne
m'en fusse pas avisé plus tôt. Cette machine sur
le cliché m'avait frappé par son aspect
d'ouvrage de précision, fini et étincelant. On
se fait toujours des idées exagérées de ce qu'on
ne connaît pas. Je devais constater au contraire
que tout était simple : la machine est au même
niveau que l'homme qui marche vers elle. Il la
rejoint comme on marche à la rencontre d'une
personne. Cela aussi était ennuyeux. La montée
vers l'échafaud, l'ascension en plein ciel,
l'imagination pouvait s'y raccrocher. Tandis
que, là encore, la mécanique écrasait tout : on
était tué discrètement, avec un peu de honte, et
beaucoup de précision.
Il y avait aussi deux choses à quoi je
réfléchissais tout le temps : l'aube et mon
pourvoi.[...] C'est à l'aube qu'ils venaient, je
le savais. En somme, j'ai occupé mes nuits à
attendre cette aube. Je n'ai jamais aimé être
surpris. Quand il m'arrive quelque chose, je
préfère être là. C'est pourquoi j'ai fini par ne
plus dormir qu'un peu dans mes journées et, tout
le long de mes nuits, j'ai attendu patiemment
que la lumière naisse sur la vitre du ciel. Le
plus difficile, c'était l'heure douteuse où je
savais qu'ils opéraient d'habitude. Passé
minuit, j'attendais et je guettais. Jamais mon
oreille n'avait perçu tant de bruits, distingué
de sons si ténus. Je peux dire, d'ailleurs, que
d'une certaine façon j'ai eu de la chance
pendant toute cette période, puisque je n'ai
jamais entendu de pas. Maman disait souvent
qu'on n'est jamais tout à fait malheureux. Je
l'approuvais dans ma prison, quand le ciel se
colorait et qu'un nouveau jour glissait dans ma
cellule, parce qu'aussi bien, j'aurais pu
entendre des pas et mon cœur aurait pu éclater.
Même si le moindre glissement me jetait à la
porte, même si, l'oreille collée au bois,
j'attendais éperdument jusqu'à ce que j'entende
ma propre respiration, effrayé de la trouver
rauque et si pareille au râle d'un chien, au
bout du compte, mon cœur n'éclatait pas et
j'avais encore gagné vingt-quatre heures.
|
| DOCUMENT
5
Robert
BADINTER Discours à
l’Assemblée Nationale - 17 septembre 1981
 En
vérité, la question de la peine de mort est simple
pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se
pose pas en termes de dissuasion, ni même de
technique répressive, mais en termes de choix
politique ou de choix moral.
En
vérité, la question de la peine de mort est simple
pour qui veut l'analyser avec lucidité. Elle ne se
pose pas en termes de dissuasion, ni même de
technique répressive, mais en termes de choix
politique ou de choix moral.
Je l'ai déjà dit, mais je le répète
volontiers au regard du grand silence antérieur :
le seul résultat auquel ont conduit toutes les
recherches menées par les criminologues est la
constatation de l'absence de lien entre la peine
de mort et l'évolution de la criminalité
sanglante. […]
Il n'est pas difficile d'ailleurs, pour qui
veut s'interroger loyalement, de comprendre
pourquoi il n'y a pas entre la peine de mort et
l'évolution de la criminalité sanglante ce rapport
dissuasif que l'on s'est si souvent appliqué à
chercher sans trouver sa source ailleurs, et j'y
reviendrai dans un instant. Si vous y réfléchissez
simplement, les crimes les plus terribles, ceux
qui saisissent le plus la sensibilité publique -
et on le comprend - ceux qu'on appelle les crimes
atroces sont commis le plus souvent par des hommes
emportés par une pulsion de violence et de mort
qui abolit jusqu'aux défenses de la raison. A cet
instant de folie, à cet instant de passion
meurtrière, l'évocation de la peine, qu'elle soit
de mort ou qu'elle soit perpétuelle, ne trouve pas
sa place chez l'homme qui tue. […]
En fait, ceux qui croient à la valeur
dissuasive de la peine de mort méconnaissent la
vérité humaine. La passion criminelle n'est pas
plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres
passions ne le sont qui, celles-là, sont nobles.
Et si la peur de la mort arrêtait les
hommes, vous n'auriez ni grands soldats, ni grands
sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent
pas devant la mort. D'autres, emportés par
d'autres passions, n'hésitent pas non plus. C'est
seulement pour la peine de mort qu'on invente
l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans
ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. […]
Pour les partisans de la peine de mort,
justice ne serait pas faite si à la mort de la
victime ne répondait pas, en écho, la mort du
coupable.
Soyons clairs. Cela signifie simplement que
la loi du talion demeurerait, à travers les
millénaires, la loi nécessaire, unique de la
justice humaine.
Du malheur et de la souffrance des victimes,
j'ai, beaucoup plus que ceux qui s'en réclament,
souvent mesuré dans ma vie l'étendue. Que le crime
soit le point de rencontre, le lieu géométrique du
malheur humain, je le sais mieux que
personne.[...]. Mais ressentir, au profond de
soi-même, le malheur et la douleur des victimes,
mais lutter de toutes les manières pour que la
violence et le crime reculent dans notre société,
cette sensibilité et ce combat ne sauraient
impliquer la nécessaire mise à mort du coupable.
Que les parents et les proches de la victime
souhaitent cette mort, par réaction naturelle de
l'être humain blessé, je le comprends, je le
conçois. Mais c'est une réaction humaine,
naturelle. Or tout le progrès historique de la
justice a été de dépasser la vengeance privée. Et
comment la dépasser, sinon d'abord en refusant la
loi du talion?
[...] Le choix qui s'offre à vos consciences
est donc clair : ou notre société refuse une
justice qui tue et accepte d'assumer, au nom de
ses valeurs fondamentales - celles qui l'ont faite
grande et respectée entre toutes - la vie de ceux
qui font horreur, déments ou criminels ou les deux
à la fois, et c'est le choix de l'abolition ; ou
cette société croit, en dépit de l'expérience des
siècles, faire disparaître le crime avec le
criminel, et c'est l'élimination.
Cette justice d'élimination, cette justice
d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de
hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce
qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce
qu'elle est la passion et la peur triomphant de la
raison et de l'humanité.
|
|
I.
Examen du corpus.
Au baccalauréat, la dissertation ou l'essai sont
proposés à partir d'un corpus global qui est
l'œuvre concernée par le sujet et les documents
dont vous
avez pu bénéficier pendant l'année :
«
La dissertation consiste à conduire une
réflexion personnelle organisée sur une
question littéraire portant sur l'une des
œuvres et sur le parcours associé
figurant dans le programme d'œuvres. [...]
Le sujet de l'essai porte sur le thème
ou la question que le texte partage avec
l'œuvre et le parcours étudiés durant l'année
dans le cadre de l'objet d'étude La
littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle.
Pour développer son argumentation, le candidat
s'appuie sur sa connaissance de l'œuvre et
des textes étudiés pendant l'année ; il
peut en outre faire appel à ses lectures et à
sa culture personnelles.»
(B.O.
n° 17 du 25 avril 2019)).
Tout
travail d'écriture doit donc être précédé de
cette phase d'examen des données du sujet : dans
notre cas, je dispose de cinq documents et de ma
connaissance des Lettres persanes.
 Consulter
une fiche méthode : la question sur le
corpus.
Consulter
une fiche méthode : la question sur le
corpus. 
1.
Identifier la nature du document :
Un corpus est
constitué de documents variés. Quelles que soient
les questions posées, il convient d'abord
d'identifier nettement leur type
de discours et leur registre
(les questions peuvent d'ailleurs porter sur ces
points). Pour cela, aidez-vous du paratexte, des
informations livrées par le contenu même, de votre
culture personnelle...
2.
Relever les arguments présents
dans chaque document de manière implicite ou
explicite, et classez-les par affinités. Vous
devriez dans le cas de ce dossier aboutir à trois
arguments majeurs. Quels sont-ils ?
 collecte des arguments qui, à travers le
corpus, permettraient d'étayer l'hostilité des
auteurs à l'égard de la peine de mort :
collecte des arguments qui, à travers le
corpus, permettraient d'étayer l'hostilité des
auteurs à l'égard de la peine de mort :
[Dans
l'examen du corpus, et après, bien sûr,
lecture complète, choisissez le document qui
vous paraît le plus nettement argumentatif :
c'est lui, en effet, qui vous permettra le
mieux de repérer les arguments et qui vous
servira de base pour aligner ceux des autres
documents.]
Dans ce corpus, le document 5 (texte de Robert
Badinter) fait parfaitement l'affaire.
L'auteur y développe quatre arguments
nettement articulés :
- la peine
de mort n'a aucune valeur d'exemple
- le
supplice est plus atroce que le crime
- la
société bafoue son devoir d'humanité en
appliquant la loi du talion
- la
pratique de la peine capitale, par sa
quasi-clandestinité, révèle la honte et la
culpabilité des bourreaux.
Vous pourrez sans mal retrouver ces arguments
dans les autres documents et rédiger votre
réponse et votre réquisitoire.
|
 Seconde : La littérature d’idées et la presse du XIXe
siècle au XXIe siècle. Seconde : La littérature d’idées et la presse du XIXe
siècle au XXIe siècle.
Sur le site Lettres de l'Académie de Rouen,
Danielle Girard propose une séquence sur
la peine de mort en débat (textes de
Victor Hugo et d'autres auteurs; recensement des
arguments de Hugo contre la peine de mort; la
peine de mort dans la presse française;
exercices, images). |
|
II.
Dissertation :
« Il y a certaines vérités qu'il ne suffit
pas de persuader, mais qu'il faut encore faire
sentir. Telles sont les vérités de morale.
Peut-être qu'[un] morceau d'histoire touchera plus
qu'une philosophie subtile.»
Vous réfléchirez à cette affirmation de
Montesquieu (Lettres
Persanes) en vous appuyant sur les
atouts respectifs des documents du corpus.
 collecte des arguments qui, à travers le corpus,
permettraient d'étayer cette thèse :
collecte des arguments qui, à travers le corpus,
permettraient d'étayer cette thèse :
[Il
s'agit ici d'une tâche plus complexe, puisque les
arguments destinés à étayer la thèse de
Montesquieu ne sont pas développés explicitement.
C'est votre réponse à la première question (types
de discours et registres) qui vous sera la plus
utile, ainsi que, bien sûr, votre connaissance des
Lettres
persanes.]
La thèse proposée affirme la supériorité de l'apologue,
du récit concret, de l'image - donc de la fonction
persuasive - sur l'argument pour communiquer des
vérités morales. L'examen des divers documents sur
la peine de mort montre cette importance des
fonctions expressive et impressive. Il faut dire
que le sujet est enclin à déchaîner les passions.
Si l'on prend garde au caractère oratoire des
discours, à leur vigueur polémique, à la force des
images et du vocabulaire dans le récit, on doit
convenir qu'en effet c'est par ces moyens-là et
non par la clarté de la raison que l'on entreprend
de nous persuader.
Pour étayer la thèse, on pourra ainsi
retenir comme arguments essentiels :
- le caractère
concret du récit : les Lettres persanes
sont émaillées de nombreux apologues. Le corpus
offre par ailleurs plusieurs exemples de récits
: le témoignage (document 2), l'exemple
authentique (document 1), la description de
l'horreur (documents 1, 2 et 3).
- le rôle du "je" :
l'intériorisation du récit nous met à la place
du condamné (document 4), nous rend donc plus
enclins à la pitié (documents 1 et 2) ou plus
coupables (document 1). Dans les Persanes,
la personnalité d'Usbek et de Rica participe au
pouvoir de persuasion de l'ensemble de l'œuvre.
- Le choix de
l'apologue, forme légère et parfois vulgaire,
peut enfin correspondre à la volonté de
récompenser le lecteur ou l'auditeur capables de
dépasser leur première impression pour déceler,
dans ce qui ne semblait être que laideur et
futilité, les beautés et richesses bien cachées
sous cette écorce. L'apologue s'adresse donc
aussi bien au cœur et à l'imagination qu'à
l'esprit, et c'est au plaisir que l'on prend à
écouter des histoires qu'il faut mesurer tous
ses atouts de persuasion.
 collecte des arguments qui, à travers le corpus,
permettraient de réfuter cette thèse :
collecte des arguments qui, à travers le corpus,
permettraient de réfuter cette thèse :
- c'est précisément
la place de l'imagination qui prêterait le flanc
à la critique : elle s'enflamme vite dans le
récit et celui-ci, favorisant la représentation
sensible, peut faire perdre le contact avec la
réalité. Comment, dès lors, peut-il faire
accéder à la vérité ?
- le récit
entreprend de persuader plus que de convaincre :
seule la raison peut au contraire fortifier en
nous les vérités morales et entraîner la
conviction. D'ailleurs, dans les Lettres
persanes, Montesquieu fait habilement
alterner les apologues avec des lettres plus
réflexives qui viennent conforter une
compréhension qui risquerait de rester
parcellaire avec les seuls apologues.
- Enfin, c'est
peut-être se fier un peu trop à la compréhension
du lecteur ou de l'auditeur que de ne leur
livrer que des histoires. Ne court-on pas ici le
risque de favoriser le contre-sens ou de se
contenter de vérités superficielles, soumises à
d'autres influences ?
 éléments de synthèse :
éléments de synthèse :
- dans « Le Pouvoir
des fables » (VIII, 4), La Fontaine se fait
l'écho de cette crainte : une assemblée de
citoyens dont la ville est menacée ne se met à
écouter l'orateur qui veut la mobiliser que
lorsqu'il entreprend de leur raconter une
histoire. Et le fabuliste, conclut un peu
amèrement : Le monde est vieux, dit-on : je
le crois, cependant / Il le faut
amuser encor comme un enfant.
- pourtant La
Fontaine établit auparavant la simple loi du
plaisir d'écouter des histoires, à laquelle on
pourrait ajouter l'émotion dont l'étymologie dit
bien le pouvoir de mobilisation :
Au moment
que je fais cette moralité,
Si Peau
d'âne m'était conté,
J'y prendrais un plaisir extrême.
- faut-il donc
regretter que la vérité passe par le cœur et ne
reste pas un principe abstrait ?
|


|