
Mythes
littéraires
|
Objet
d'étude :
Le
roman et le récit du Moyen Âge au XXIème
siècle.
Parcours
: Individu,
morale et société
Le
personnage de roman.
|
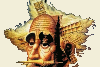
Don
Quichotte est un personnage qui, bien qu'issu d'un seul
roman, a pénétré l'imaginaire universel de manière
durable. Le héros de Cervantes condense, il est vrai, un
certain nombre de postulations humaines fondamentales et
s'inscrit de manière significative dans son temps. Il
satisfait donc aux deux conditions de la vie mythique,
exploitant à la fois le contenu manifeste de son époque et
son contenu latent. Manifeste est tout d'abord le refus
des valeurs mercantiles que cet être passionné d'idéal
constate partout autour de lui. Don Quichotte, vieux
lecteur à la cervelle fêlée, incarne le millénarisme,
cette nostalgie de l'Âge d'or au cœur de l'âge de fer :
Rousseau, puis les Romantiques, pour ne pas dire les
hippies, s'en souviendront. Mais le Chevalier à la Triste
Figure exprime aussi cette foi en l'homme qui court sous
la trame des temps : si c'est être fou que de croire à
l'Amour, à la Fidélité, à l'Honneur, alors Don Quichotte
est fou, d'une démence choisie qui sait à l'occasion
trouver quels accents de raison ! L'excès du personnage,
le registre burlesque de ses aventures, génèrent même la
contestation du mythe héroïque de la Quête par un autre
motif, étonnamment moderne, qu'on pourrait identifier -
idiot, rêveur, "clochard céleste" - à celui de l'homme
perdu dans son temps. A tous ces titres, les variations
sur le thème quichottesque sont innombrables.
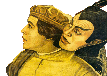
On
pourrait rapprocher le docteur Faust, mythe germanique,
d'un nombre important de fables universelles concernant le
péché de connaissance : Faust, qui vend son âme au Diable
moyennant la jeunesse et le pouvoir, n'est-ce pas Adam,
n'est-ce pas Prométhée ? Il incarne en effet le caractère
coupable de la libido sciendi, quand ce désir
affirme l'Homme contre son Créateur. En Faust peuvent se
reconnaître tous les hommes de recherche que tentent, tôt
ou tard, des secrets défendus. La Renaissance s'est
largement emparée de ce mythe dont elle a fait le parangon
de l'aventure humaine. Mais le Romantisme devait
contribuer à approfondir et élargir à la fois le
personnage faustien : avec Goethe, il devient exemplaire
d'une quête idéale d'accomplissement de l'esprit et du
corps où se déploie la double postulation des hommes vers
le Bien et le Mal. Les modernes, à travers le symbole du
pacte diabolique, ont choisi de valoriser à travers Faust
le problème d'une liberté engagée dans ce choix
fondamental.

Anonyme
: Volksbush (1587)
Christopher Marlowe : La
Tragique histoire du Dr Faust (1594)
(1594)
Pedro Calderòn : Le
Magicien prodigieux (1637)
(1637)
Friedrich Maximilian Klinger : Vie,
exploits, et descente aux enfers de Faust (1792)
(1792)
Johann Wolfgang von Goethe : Faust
I et II (1808 -1832)
(1808 -1832)
Christian Dietrich Grabbe : Don
Juan und Faust (1828)
(1828)
Honoré de Balzac : Melmoth
réconcilié (1835)
(1835)
Nikolaus Lenau : Faust,
ein Gedicht (1836)
(1836)
Michel de Ghelderode : La
mort du docteur Faust (1925)
(1925)
Paul Valéry : Mon
Faust (1941-1945)
(1941-1945)
Thomas Mann : Docteur
Faustus (1947)
(1947)
Jean Giono : Faust
au village (1947)
(1947)
Mikhaïl Boulgakov : Le
Maître et Marguerite (1966)
(1966)
Fernando Pessoa : Faust (1988)
(1988)
Hélène Cixous : Révolutions
pour plus d'un Faust (1975)
Michael Swanwick : Jack
Faust (1997).
(1997).
 Cliquez ici pour un exemple de séquence.
Cliquez ici pour un exemple de séquence.
|
FAUST,
seul — Philosophie, hélas !
jurisprudence, médecine, et toi aussi, triste
théologie !... je vous ai donc étudiées à fond
avec ardeur et patience : et maintenant me voici
là, pauvre fou, tout aussi sage que devant. Je
m'intitule, il est vrai, maître, docteur,
et, depuis dix ans, je promène çà et là mes élèves
par le nez — et je vois bien que nous ne pouvons
rien connaître !... Voilà ce qui me brûle le sang
! J'en sais plus, il est vrai, que tout ce qu'il y
a de sots, de docteurs, de maîtres, d'écrivains et
de moines au monde ! Ni scrupule ni doute ne me
tourmentent plus ! Je ne crains rien du diable, ni
de l'enfer ; mais aussi toute joie m'est enlevée.
Je ne crois pas savoir rien de bon en effet, ni
pouvoir rien enseigner aux hommes pour les
améliorer et les convertir. Aussi n'ai-je ni bien,
ni argent, ni honneur, ni domination dans le monde
: un chien ne voudrait pas de la vie à ce prix !
Il ne me reste désormais qu'à me jeter dans la
magie. Oh ! si la force de l'esprit et de la
parole me dévoilait les secrets que j'ignore, et
si je n'étais plus obligé de dire péniblement ce
que je ne sais pas ; si enfin je pouvais connaître
tout ce que le monde cache en lui-même, et, sans
m'attacher davantage à des mots inutiles, voir ce
que la nature contient de secrète énergie et de
semences éternelles ! Astre à la lumière argentée,
lune silencieuse, daigne pour la dernière fois
jeter un regard sur ma peine !... j'ai si souvent,
la nuit, veillé près de ce pupitre ! C'est alors
que tu m'apparaissais sur un amas de livres et de
papiers, mélancolique amie ! Ah ! que ne puis-je,
à ta douce clarté, gravir les hautes montagnes,
errer dans les cavernes avec les esprits, danser
sur le gazon pâle des prairies, oublier toutes les
misères de la science, et me baigner rajeuni dans
la fraîcheur de ta rosée !
Hélas ! et je languis encore dans mon
cachot ! Misérable trou de muraille, où la douce
lumière du ciel ne peut pénétrer qu'avec peine à
travers ces vitrages peints, à travers cet amas de
livres poudreux et vermoulus, et de papiers
entassés jusqu'à la voûte. Je n'aperçois autour de
moi que verres, boîtes, instruments, meubles
pourris, héritage de mes ancêtres... Et c'est là
ton monde, et cela s'appelle un monde !
Et tu demandes encore pourquoi ton cœur se
serre dans ta poitrine avec inquiétude, pourquoi
une douleur secrète entrave en toi tous les
mouvements de la vie ! Tu le demandes !... Et au
lieu de la nature vivante dans laquelle Dieu t'a
créé, tu n'es environné que de fumée et de
moisissure, dépouilles d'animaux et ossements de
morts !
Délivre-toi ! Lance-toi dans l'espace ! Ce
livre mystérieux, tout écrit de la main de
Nostradamus, ne suffit-il pas pour te conduire ?
Tu pourras connaître alors le cours des astres ;
alors, si la nature daigne t'instruire, l'énergie
de l'âme te sera communiquée comme un esprit à un
autre esprit. C'est en vain que, par un sens
aride, tu voudrais ici t'expliquer les signes
divins... Esprits qui nagez près de moi,
répondez-moi, si vous m'entendez ! (Il frappe
le livre, et considère le signe du macrocosme.)
Ah ! quelle extase à cette vue s'empare de tout
mon être ! Je crois sentir une vie nouvelle,
sainte et bouillante, circuler dans mes nerfs et
dans mes veines.
J.W. von GOETHE, Faust (1808)
traduction
de Gérard de Nerval.
|
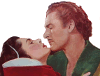
Le
sens commun retient surtout l'aspect sensuel de ce
séducteur impénitent, et pourtant c'est d'intellect et de
volonté de savoir qu'il est plutôt constitué : devant les
mystères sacrés, la comédie sociale, Don Juan exerce le
pouvoir décapant de l'insolence et de la raison. Si peu
sensuel d'ailleurs qu'on a pu arguer de son impuissance,
tant il butine et court sans jamais consommer ! Don Juan,
c'est la mobilité, l'impermanence de l'instant contre tout
ce qui le fige, dogmes et institutions, jusqu'à ce que,
précisément, il bute contre un Commandeur de pierre.
Chaque époque a pu revendiquer son Don Juan : libertin ou
"grand seigneur méchant homme" à l'aube des Lumières, il
incarne davantage avec les Romantiques la solitude et
l'inquiétude métaphysique avant de figurer plutôt pour
nous l'artisan d'une liberté conquise à la barbe des
Dieux.
 |
|
Tirso de Molina
: El
Burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630)
(1630)
Anonyme : L'Ateista
fulminato (début XVIIe)
(début XVIIe)
Giacinta Andrea Cicognini : Il
Convitato di pietra (1640)
(1640)
Anonyme : Il
Convitato di Pietra (canevas de Naples), milieu XVIIe
(canevas de Naples), milieu XVIIe
Domenico Biancolelli : Le convive de pierre
(canevas),1658
Jean Deschamps, sieur de Villiers : Le
Festin de Pierre ou Le Fils Criminel (1659)
(1659)
Nicolas Drouin Dorimon : Le Festin de Pierre
ou le Fis criminel (1665)
Molière
: Dom Juan ou le Festin de Pierre
(1665)
Claude La Roze Rosimond : Le
Nouveau festin de Pierre, ou l'Athée
foudroyé (1670)
(1670)
Thomas Shadwell : The
Libertine (1676)
(1676)
Thomas Corneille : Le
Festin de pierre (1677)
(1677)
Andrea Perrucci (Preudarca), Il
Convitato di pietra (1690)
(1690)
Antonio de Zamora : Le Comte de pierre
(1714)
Carlo Goldoni : Don
Juan (1730)
(1730)
Lorenzo Da Ponte : Don
Giovanni (livret, 1787)
Friedrich Schiller : « Don Juan » (1797)
E.T.A. Hoffmann : Don
Juan (in Fantaisies selon Callot, 1814)
(in Fantaisies selon Callot, 1814)
Heiberg : Don Juan, 1814
Lord Byron : Don
Juan (1819-1824)
(1819-1824)
Christian Dietrich Grabbe : Don
Juan und Faust (1828)
(1828)
Alexandre Pouchkine : Le
convive de pierre (1830)
(1830)
Honoré de Balzac : L'Élixir
de longue vie (1830)
(1830)
Musset : Namouna (1832)
(1832)
Mérimée : Les
Âmes du purgatoire (1834)
(1834)
Alexandre Dumas : Don
Juan de Marana, ou La chute d'un ange (1836)
(1836)
José de Espronceda : Don Juan de Marana
(1837)
Théophile Gautier : La
Comédie de la mort (1838)
(1838)
Nikolaus Lenau : Don
Juan (1844)
(1844)
Arthur de Gobineau : Les
Adieux de Don Juan (1844)
(1844)
Jose Zorrilla
y Moral : Don
Juan Tenorio (1844)
(1844)
Gustave Flaubert : Une
nuit de Don Juan (1849)
(1849)
George Sand : Le
Château des Désertes (1851)
(1851)
Charles Baudelaire : « Don Juan aux enfers » (in
Les
Fleurs du Mal , 1857)
, 1857)
Alexis Tolstoï : Don
Juan (1862)
(1862)
Jules Barbey d’Aurevilly : Le plus bel amour
de Don Juan
(in Les
Diaboliques ,
1864) ,
1864)
|
A. M. Guerra
Junqueiro : La Mort de Don Juan (1874)
Juan de von Heyse : La Fin de Don Juan
(1884)
Paul Verlaine : « Don
Juan pipé » (1891)
Léon Bloy : La Fin de Don Juan (1893)
Edmond Haraucourt : Don
Juan de Mañara (1898)
(1898)
George Bernard Shaw : L'Homme
et le surhomme (1903)
(1903)
Oscar-Vladislas de Lubicz-Milosz : Don
Juan (1906)
(1906)
Edmond Rostand : La dernière nuit de Don Juan (1911)
Lesja Ukrainka : L'Invité de pierre (1913)
Guillaume Apollinaire : Les
exploits d un jeune don Juan (1911)
(1911)
Michel Zévaco : Don
Juan (1918)
(1918)
Azorín : Don
Juan (1922)
(1922)
Michel de Ghelderode : Don
Juan ou Les Amants chimériques (1926)
(1926)
Joseph Delteil : Saint
Don Juan (1930-1961)
(1930-1961)
Vitaliano Brancati : Don
Juan en Sicile, 1940
André Suarès : A l'Ombre de matines,
1943
Charles Bertin : Don
Juan ,
1947 ,
1947
Bertolt Brecht : Don
Juan (1952-54)
(1952-54)
Manuel de Diéguez : Le Chevalier du mépris
(1955)
Marie Noël : Le
Jugement de Don Juan (1955)
Roger Vailland : Monsieur
Jean (1959)
(1959)
Ellery Queen : La
mort de Don Juan (1958)
Henry de Montherlant : La
Mort qui fait le trottoir (1958)
(1958)
Max Frisch : Don
Juan ou L'Amour de la géométrie (1962)
(1962)
Gonzalo Torrente Ballester : Don
Juan (1963)
Milan Kundera : La pomme d'or de l'éternel
désir
Le docteur Havel vingt
ans plus tard in Risibles
amours (1970)
(1970)
Michel Butor : Triptyques pour Don Juan
(1975-1977)
Gilbert Cesbron : Don
Juan en automne (1975)
(1975)
Pierre-Jean Rémy : Don
Juan (1982)
(1982)
Beatrix Beck : Don
Juan des forêts (1983)
(1983)
Nicole Avril : Jeanne (1984)
(1984)
Eric-Emmanuel Schmitt : La
Nuit de Valognes (1991)
(1991)
Jean-Marie Laclavetine : Don
Juan (1998)
(1998)
Denis Tillinac : Don
Juan (1998)
(1998)
Serge Behar : Don
Juan 99 (1999)
Cécile Philippe : Don
Juan, père et fils (1999)
(1999)
Frédérick Tristan : Don
Juan le révolté (2009).
(2009).
|
|
 Cliquez
ici pour un exemple de séquence. Cliquez
ici pour un exemple de séquence.
|
 voir
notre étude consacrée au Dom
Juan de Molière. voir
notre étude consacrée au Dom
Juan de Molière.
|
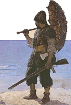
|
Le
marin écossais Alexander Selkirk fut abandonné par
son équipage en 1704 sur un îlot désert de
l'archipel Juan Fernandez, au large du Chili
: il y vécut seul quatre ans et demi. Le romancier
irlandais Daniel Defoe s'empara du sujet pour en
faire un des plus grands succès de la littérature
universelle (le seul roman que Rousseau tolérât
dans un but pédagogique !). Dans l'esprit des
Lumières, Robinson incarne le triomphe de
l'industrie humaine sur la sauvagerie naturelle.
Devant son esclave Vendredi, il est l'Occidental
convaincu de l'universalité de ses valeurs. Mais
on sait quel retournement Michel Tournier fit
subir au mythe à la lumière de la mauvaise
conscience du colonisateur : la fable manifesta sa
souplesse en adoptant le point de vue du colonisé,
fustigeant dès lors l'ethnocentrisme. Mais
l'histoire de Robinson, c'est aussi une aventure
qui fédère tous les thèmes du voyage et de
l'ailleurs : à ce titre, toute littérature
insulaire alliant exotisme et mystère peut s'en
réclamer, et
la liste pourrait être longue.
|
|

Daniel Defoe : Robinson
Crusoé (1719)
(1719)
Robert-Louis Stevenson : L'Île
au trésor (1883)
(1883)
Johann David Wyss : Le
Robinson suisse (1812)
(1812)
James Fenimore Cooper : Le
Cratère ou le Robinson américain (1835)
(1835)
Jacques Offenbach : Robinson
Crusoé , opéra comique en trois actes (1867)
, opéra comique en trois actes (1867)
Jules Verne : L'Île
mystérieuse (1874)
(1874)
Jules Verne : L'École
des Robinsons (1882)
(1882)
Jules Verne : Deux
ans de vacances (1888)
(1888)
Saint-John Perse : Images à Crusoé (1904)
Jean Giraudoux : Suzanne
et le Pacifique (1921)
(1921)
Jules Supervielle : Robinson,
comédie en 3 actes (1948)
(1948)
William Golding : Sa
Majesté des mouches (1954)
(1954)
Michel Tournier : Vendredi
ou les Limbes du Pacifique (1967)
(1967)
Michel Tournier : Vendredi
ou la Vie sauvage (1971)
(1971)
J.M.G. Le Clézio : Le
Chercheur d'or (1985)
(1985)
Umberto Eco : L'Île
du jour d'avant (1994).
(1994). |
| |
|
|
|
On voit ce qui fait le prestige de Robinson :
cette solitude dont nous souffrons, même et
surtout au milieu de la foule anonyme et
oppressante, il a su merveilleusement, lui,
l'aménager et l'élever au niveau d'un art de
vivre. C'est ainsi du moins qu'on imagine
communément le héros de Daniel Defoe, et cela nous
permet de mieux mettre au jour le mécanisme du
mythe. Car le héros mythologique, s'il prend pied
au cœur de chaque individu modeste et prosaïque se
hausse en même temps au niveau d'une réussite
admirable. Il est paradoxalement à la fois le
double fraternel de chaque homme et une statue
surhumaine qui le met de plain-pied avec l'Olympe
éternel. De telle sorte que chaque héros
mythologique — et non seulement Robinson, mais
Tristan, don Juan, Faust — nous engage dans un
processus d'autohagiographie. Comme je suis
grand, fort, mélancolique ! s'écrie le lecteur en
levant les yeux du livre vers un miroir. Vraiment,
il ne se savait pas si beau !
Pourtant les années de solitude de Robinson
— le seul aspect de l'aventure que connut
Alexandre Selkirk — le cèdent en importance à
l'autre grand thème du roman dont elles ne sont
finalement que la préparation nécessaire, je veux
parler de la survenue de Vendredi. Sans doute
Robinson devait-il demeurer le seul personnage du
roman de Daniel Defoe à posséder une dimension
mythologique avant l'époque contemporaine
caractérisée par l'épanouissement des disciplines
ethnographiques et le démantèlement des empires
coloniaux. Or qu'était Vendredi pour Daniel Defoe
? Rien, une bête, un être en tout cas qui attend
de recevoir son humanité de Robinson, l'homme
occidental, seul détenteur de tout savoir, de
toute sagesse. Et quand il aura été dûment
morigéné par Robinson, il deviendra tout au plus
un bon serviteur. L'idée que Robinson eût de son
côté quelque chose à apprendre de Vendredi ne
pouvait effleurer personne avant l'ère de
l'ethnographie. C'est sur ce point que la vertu
proprement mythologique de cette histoire se
manifeste le plus crûment. Car il est évident que
la rencontre Robinson-Vendredi a pris depuis
quelques décennies une signification que le cher
Daniel Defoe était à cent mille lieues de pouvoir
soupçonner.
Relisant son roman, je ne pouvais en effet
oublier mes années d'études au musée de l'Homme.
Là j'avais appris qu'il n'y a pas de « sauvages »,
mais seulement des hommes relevant d'une
civilisation différente de la nôtre et que nous
avions grand intérêt à étudier. L'attitude de
Robinson à l'égard de Vendredi manifestait le
racisme le plus ingénu et une méconnaissance de
son propre intérêt. Car pour vivre sur une île du
Pacifique ne vaut-il pas mieux se mettre à l'école
d'un indigène rompu à toutes les techniques
adaptées à ce milieu particulier que de s'acharner
à plaquer sur elle un mode de vie purement anglais
?
Michel Tournier, Le vent Paraclet (1977).
|

Le
caractère invraisemblable de sa destinée (« Quel roman que
ma vie ! » se serait-il exclamé à Sainte-Hélène) aurait
suffi sans doute à élever Napoléon à la hauteur d'un
mythe. Mais le bruit de ses campagnes et leur
orchestration savante auprès d'une population mal informée
ont commencé très tôt à sculpter le personnage dans
l'imaginaire européen. Plus tard, sous la Restauration, la
jeunesse romantique élevée au son de cette gloire et
contemporaine de la médiocrité louis-philipparde achève en
réaction d'installer le mythe. Pour ces adolescents
désenchantés, les récits nostalgiques des pères font de
Napoléon le modèle de la libre construction de soi et de
l'énergie héroïque, valeurs que vivifient en effet la
fulgurance de son ascension et l'exemplarité de sa chute.
Quand la littérature s'en empare, c'est essentiellement
dans un but politique, le destin de Napoléon devant
représenter aux pouvoirs en place leur insuffisance et
leur platitude. Le genre épique est donc constamment
mobilisé dans les formes poétiques les plus adéquates pour
suggérer la grandeur héroïque. Dans le roman, au
contraire, le personnage de Napoléon se trouve davantage
confronté aux faits, ce qui peut nourrir une mise en cause
des thèmes épiques, déjà initiée par Stendhal.
Nous recensons ci-dessous les œuvres du XIXème
siècle qui ont le mieux contribué à la constitution du
mythe.
 |
F.R. de
Chateaubriand, De
Buonaparte et des Bourbons (1814)
(1814)
Emmanuel de Las Cases, Le
Mémorial de Sainte-Hélène (1823)
(1823)
Lord Byron, Ode
à Napoléon Bonaparte (1814)
(1814)
The
death of Napoleon Buonaparte (1821)
(1821)
Heinrich Heine, De
l'Allemagne (1813)
(1813)
Germaine de Staël, Dix
années d'exil (1820)
(1820)
Benjamin Constant, De
l’esprit de conquête et de l’usurpation dans
leur rapports avec la civilisation européenne
(1814)
Alphonse de Lamartine, Nouvelles
méditations poétiques (1823)
(1823)
G. W. Hegel,
Leçons sur la philosophie de l'histoire
(1822-1823)
Walter Scott, Vie
de Napoléon Bonaparte (1827)
(1827)
Victor Hugo,
Les Orientales
(1829)
Les
Feuilles d'automne (1831)
(1831)
Les
Chants du crépuscule (1835)
(1835)
Les
Châtiments (1852)
(1852)
Les
Misérables (1862)
(1862)
Gérard de Nerval, Napoléon
et la France guerrière, élégies nationales (1826)
(1826)
Alexandre Pouchkine, Eugène
Onéguine (1833)
(1833)
La
Dame de pique (1834)
(1834)
Alfred de Vigny, Servitude
et grandeur militaires (1835)
(1835)
Honoré de Balzac, Une
ténébreuse affaire (1841)
(1841)
Une
conversation entre onze heures et minuit (1832)
(1832)
Le
Colonel Chabert (1832)
(1832)
Le
Médecin de campagne (1833)
(1833)
Johann Wolfgang von Goethe, Conversations
avec Eckermann (1836)
(1836)
Louis Geoffroy, Napoléon
et la Conquête du monde (1836)
Alfred de Musset, La
Confession d'un enfant du siècle (1836)
(1836)
Stendhal, Le
Rouge et le noir (1830)
(1830)
La
Chartreuse de Parme (1839)
(1839)
Alexandre Dumas, Napoléon
Bonaparte ou Trente ans de l'histoire de
France (1831)
(1831)
Les
Compagnons de Jéhu (1857)
(1857)
Le
chevalier de Sainte-Hermine (1869)
(1869)
Léon Tolstoï, La
Guerre et la Paix (1865)
(1865)
Mikhaïl Lermontov, Le
bateau volant (1840)
(1840)
Fedor Dostoïevski, Crime
et châtiment (1866)
(1866)
L'Idiot (1869)
(1869)
Les
Frères Karamazov (1879)
(1879)
Thomas Hardy, Le
trompette-major (1882)
(1882)
Arthur Conan
Doyle, La
grande ombre (1893)
(1893)
Les exploits du brigadier Gérard (1894-1895).
|

Au vu des multiples adaptations du roman de Flaubert et de son influence sur la littérature moderne, il n'est pas étonnant d'apercevoir le personnage d'Emma Bovary solidement ancré dans notre imaginaire. Figure de la bêtise, ou de l'Ennui, ou encore héroïne d'une quête de l'Absolu, perdue, comme don Quichotte, dans un siècle matérialiste, Emma Bovary est aussi facilement investie par le discours féministe, tant elle est abusée et déçue par les hommes qui gravitent autour d'elle. L'évolution du personnage tout au long du roman révèle encore d'autres facettes, jusqu'à doter cette figure, d'abord passive et sotte, d'une énergie toute masculine que Baudelaire avait particulièrement perçue. Le substantif de bovarysme est enfin venu parachever cette vie mythique pour installer ce personnage avide d'être autre que lui-même dans les dictionnaires de la psychologie moderne. Enfin le roman de Flaubert est responsable, lui aussi bien sûr, de cette richesse par l'audace de ses techniques narratives et on verra dans la liste qui suit comment les romanciers ont durablement manifesté leur fascination en s'inspirant également de ses personnages secondaires.
 |
Gustave Flaubert, Madame Bovary (1857)
Francis Carco, Les Incarnations de Madame Bovary (1933)
Willem Brakman, Le noir sortant de la bouche de Madame Bovary (1974)
Patrick Menney, Madame Bovary sort ses griffes (1988)
Claude-Henri Buffard, La Fille d'Emma (1988)
Sylvère Monod, Madame Homais (1988)
Laura Grimaldi Monsieur Bovary (1991)
Jacques Cellard, Emma, oh ! Emma ! (1992)
Raymond Jean, Mademoiselle Bovary (1993)
Antoine Billot Monsieur Bovary (2006)
Philippe Doumencq, Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary (2007)
Ambroise Perrin, Madame Bovary dans l'ordre (2013)
Aurélie Gasrel, Madame Bovary, c'est moi (2014)
Posy Simmons, Gemma Bovary (2019)
Karen Russell, Le lévrier de Madame Bovary et autres histoires (2022)
|
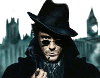
Sous
les formes diverses qu'il peut prendre dans la
littérature, le mythe du détective semble être l'un des
plus anciens, peut-être parce qu'il correspond à l'enquête
que l'homme ne cesse de mener pour éclaircir l'affaire qui
lui importe le plus : « D'où
venons nous ? Que sommes nous ? Où allons nous ? » C'est
sans doute pour cela qu'on s'accorde en général à
reconnaître dans le personnage d'Œdipe le prototype du
détective, d'autant que ce personnage est au centre d'un
scénario que l'on s'est inlassablement réapproprié,
celui de l'enquête menée par le criminel sur son propre
crime. Mais le détective est aussi le fils du
rationalisme et du scientisme, et s'épanouit pour cela
dans la deuxième moitié du XIXe siècle et la première
moitié du XXe : il coïncide avec une époque où l'on
entend manifester la toute-puissance de l'intelligence
humaine sur les déterminations de la nature et du
hasard. Les avatars du détective sont trop nombreux pour
que l'on tente dans ce cadre d'en établir une liste
exhaustive. On trouvera ci-dessous quelques exemples de
personnages, suivis de la mention de leur première
apparition dans l'œuvre de certains auteurs familiers du
genre policier. Pour se limiter à la littérature
française, on peut peut-être établir l'origine de cette
figure du détective dans celle de François-Eugène Vidocq
qui inspira, entre autres, Balzac, Hugo, Dumas, Eugène
Sue, tous grands romanciers de la ville et de ses
mystères. A partir du XIXème siècle, l'urbanisation
grandissante et les fantasmes dont elle est responsable
contribuent d'ailleurs à donner au détective son auréole
mythologique et expliquent son empreinte poétique dans
beaucoup de romans et de films.
 |
Edgar Poe :
Chevalier Auguste Dupin (Double
assassinat dans la rue Morgue ,
1841) ,
1841)
Wilkie Collins : Sergeant Richard Cuff (La
dame en blanc ,
1860) ,
1860)
Émile Gaboriau : Monsieur Lecoq (Monsieur
Lecoq ,
1869) ,
1869)
Arthur Conan Doyle : Sherlock Holmes (Une
étude en rouge ,
1887) ,
1887)
Gaston Leroux : Joseph Rouletabille (Le
Mystère de la chambre jaune ,
1907) ,
1907)
Pierre Souvestre et Marcel Allain : commissaire
Juve - Jérôme Fandor (Fantômas ,
1911) ,
1911)
Agatha Christie : Hercule Poirot (La
Mystérieuse affaire de Styles ,
1920) - Miss Marple (L'Affaire
Protheroe ,
1920) - Miss Marple (L'Affaire
Protheroe , 1930)
, 1930)
Dorothy L. Sayers : Lord Peter Wimsey (Lord
Peter et l'inconnu , 1923)
, 1923)
S.S. Van Dine : Philo Vance (La
Mystérieuse affaire Benson ,
1926) ,
1926)
Stanislas-André Steeman : M. Wens (Six
hommes morts ,
1930) ,
1930)
Georges Simenon : Jules Maigret (Pietr
le letton ,
1931) ,
1931)
Boileau-Narcejac : André Brunel (Deux
hommes sur une piste ,
1932) ,
1932)
Pierre Véry : Prosper Lepicq (Meurtre
au quai des Orfèvres, 1934)
Raymond Chandler : Philip Marlowe (Finger
Man, 1934)
Léo Malet : Nestor Burma (120,
rue de la Gare ,
1943) ,
1943)
Frédéric Dard : commissaire San Antonio (Réglez-lui
son compte ,
1949) ,
1949)
Jean-François Parot : Nicolas Le Floch (L'énigme
des Blancs-Manteaux, 2000).
|
 A propos de Sherlock Holmes, la comparaison des deux
textes suivants pourra mettre en évidence la parodie
à laquelle se livre le second et faire utilement réfléchir
à la notion de mythe littéraire : voué à être incessamment
réutilisé après sa naissance, il peut aussi investir son
propre passé !
A propos de Sherlock Holmes, la comparaison des deux
textes suivants pourra mettre en évidence la parodie
à laquelle se livre le second et faire utilement réfléchir
à la notion de mythe littéraire : voué à être incessamment
réutilisé après sa naissance, il peut aussi investir son
propre passé !
 |
Arthur
Conan Doyle (1859-1930)
Le Chien des Baskerville, (1902), I
(extrait)
[Un visiteur
s'est présenté chez Sherlock Holmes en son absence
et y a oublié sa canne. Imitant la méthode du
détective, le docteur Watson entreprend de deviner
l'homme d'après l'objet. Holmes le félicite
d'abord.]
|
 |
Umberto
Eco (né en
1932)
Le Nom de la Rose (1980), Prime,
(extrait)
[Le jeune
Adso de Melk arrive avec son maître, Guillaume de
Baskerville, en vue d'une abbaye. Ils croisent
soudain une troupe de servants et de moines en
grand émoi. Le cellérier qui les conduit prend le
temps de saluer nos deux voyageurs.]
|
|
Jamais il ne
m'en avait tant dit ! Je conviens que ce langage me
causa un vif plaisir. Souvent en effet j'avais
éprouvé une sorte d'amertume devant l'indifférence
qu'il manifestait à l'égard de mon admiration et de
mes efforts pour vulgariser ses méthodes. Par
ailleurs je n'étais pas peu fier de me dire que je
possédais suffisamment à fond son système pour
l'appliquer d'une manière qui avait mérité son
approbation. Il me prit la canne des mains et
l'observa quelques instants à l'œil
nu. Tout à coup, intéressé par un détail, il posa sa
cigarette, s'empara d'une loupe, et se rapprocha de
la fenêtre.
- Curieux, mais élémentaire ! fit-il en
revenant s'asseoir sur le canapé qu'il
affectionnait. Voyez-vous, Watson, sur cette canne
je remarque un ou deux indices : assez pour nous
fournir le point de départ de plusieurs déductions.
- Une petite chose m'aurait-elle échappé ?
demandai-je avec quelque suffisance. J'espère
n'avoir rien négligé d'important ?
- J'ai peur, mon cher Watson, que la plupart
de vos conclusions ne soient erronées. Quand je
disais que vous me stimuliez, j'entendais par là,
pour être tout à fait franc, qu'en relevant vos
erreurs j'étais fréquemment guidé vers la vérité.
Non pas que vous vous soyez trompé du tout au tout
dans ce cas précis. Il s'agit certainement d'un
médecin de campagne. Et d'un grand marcheur.
- Donc j'avais raison.
- Jusque-là, oui.
- Mais il n'y a rien d'autre...
- Si, si, mon cher Watson ! Il y a autre
chose. D'autres choses. J'inclinerais volontiers à
penser, par exemple, qu'un cadeau fait à un médecin
provient plutôt d'un hôpital que d'une société de
chasse; quand les initiales "C.C." sont placées
devant le "H" de Hospital, les mots "Charing-Cross"
me viennent naturellement en tête.
- C'est une hypothèse.
- Je n'ai probablement pas tort. Si nous
prenons cette hypothèse pour base, nous allons
procéder à une reconstitution très différente de
notre visiteur inconnu.
- Eh bien, en supposant que "C.C.H." signifie
"Charing-Cross Hospital", que voulez-vous que nous
déduisions de plus ?
- Vous ne voyez pas ? Puisque vous connaissez
mes méthodes, appliquez-les !
- Je ne vois rien à déduire, sinon que cet
homme a exercé en ville avant de devenir médecin de
campagne.
- Il me semble que nous pouvons nous hasarder
davantage. Considérez les faits sous ce nouvel
angle. En quelle occasion un tel cadeau a-t-il pu
être fait ? Quand des amis se sont-ils réunis pour
offrir ce témoignage d'estime ? De toute évidence à
l'époque où le docteur Mortimer a quitté le service
hospitalier pour ouvrir un cabinet. Nous savons
qu'il y a eu cadeau. nous croyons qu'il y a eu
départ d'un hôpital londonien pour une installation
à la campagne. Est-il téméraire de déduire que le
cadeau lui a été offert à l'occasion de son départ ?
- Certainement pas.
- Mais convenez aussi avec moi, Watson, qu'il
ne peut s'agir de l'un des "patrons" de l'hôpital :
un patron en effet est un homme bien établi avec une
clientèle à Londres, et il n'abandonnerait pas ces
avantages pour un poste de médecin de campagne. Si
donc notre visiteur travaillait dans un hôpital sans
être patron, nous avons affaire à un interne en
médecine ou en chirurgie à peine plus âgé qu'un
étudiant. il a quitté ses fonctions voici cinq ans :
la date est gravée sur la canne. Si bien que votre
médecin d'un certain âge, grave et patriarcal,
disparaît en fumée, mon cher Watson, pour faire
place à un homme d'une trentaine d'années, aimable,
sans ambition, distrait, qui possède un chien favori
dont j'affirme qu'il est plus gros qu'un fox-terrier
et plus petit qu'un dogue.
J'éclatais d'un rire incrédule pendant que
Holmes se renfonçait dans le canapé et soufflait
vers le plafond quelques anneaux bleus.
- En ce qui concerne votre dernière
déduction, dis-je, je suis incapable de la vérifier.
Mais il m'est facile de rechercher quelques détails
sur l'âge et la carrière professionnelle de notre
visiteur.
J'attrapai mon annuaire médical et le
feuilletai. il existait plusieurs Mortimer, mais un
seul correspondait à notre inconnu. Je lus à haute
voix les lignes qui lui étaient consacrées.
- Mortimer, James, M.R.C.S. 1882,
Grimpen, Dartmoor, Devon. Interne en chirurgie de
1882 à 1884, au Charing-Cross Hospital. Lauréat du
prix Jackson de pathologie. [...] Médecin
sanitaire des paroisses de Grimpen, Thorsley, et
High Barrow.
- Pas question de société de chasse, Watson !
observa Holmes avec un sourire malicieux. Uniquement
d'un médecin de campagne, comme vous l'aviez très
astucieusement deviné. Je crois que mes déductions
sont à peu près confirmées. Quant aux qualificatifs,
j'ai dit, si je me souviens bien, aimable, sans
ambition, distrait. Par expérience je sais qu'en ce
monde seul un homme aimable peut recevoir des
présents, que seul un médecin sans ambition peut
renoncer à faire carrière à Londres pour exercer à
la campagne, et que seul un visiteur distrait peut
laisser sa canne et non sa carte de visite après
vous avoir attendu une heure.
- Et le chien ?
- Le chien a été dressé à tenir cette canne
derrière son maître. comme la canne est lourde, le
chien la serre fortement par le milieu, et les
traces de ses dents sont visibles. La mâchoire du
chien, telle qu'on peut se la représenter d'après
les espaces entre ces marques, est à mon avis trop
large pour un dogue. Ce serait donc...oui, c'est
bien un épagneul à poils bouclés.
Tout en parlant il s'était levé pour arpenter
la pièce et s'était arrêté derrière la fenêtre. Sa
voix avait exprimé une conviction si forte que je le
regardai avec surprise.
- Mon cher ami, comment pouvez-vous
parler avec tant d'assurance ?
- Pour la bonne raison que je vois le chien
devant notre porte et que son propriétaire vient de
sonner.
|
« - Je vous
remercie, seigneur cellérier, répondit cordialement
mon maître, et j'apprécie d'autant plus votre
courtoisie que pour me saluer vous avez interrompu
votre poursuite. Mais n'ayez crainte, le cheval est
passé par ici et a pris le sentier de droite. Il ne
pourra pas aller bien loin car, arrivé au dépôt des
litières, il devra s'arrêter. II est trop
intelligent pour se précipiter le long du terrain
abrupt...
- Quand l'avez-vous vu ? demanda le cellérier.
- Nous ne l'avons pas vu du tout, n'est-ce pas, Adso
? dit Guillaume en se tournant vers moi d'un air
amusé. Mais si vous cherchez Brunel, l'animal ne
peut être que là où j'ai dit.»
Le cellérier hésita. Il regarda Guillaume,
puis le sentier, et enfin demanda : « Brunel ?
Comment savez-vous ?
- Allons, allons, dit Guillaume, il est évident que
vous êtes en train de chercher Brunel, le cheval
préféré de l'Abbé, le meilleur galopeur de votre
écurie, avec sa robe noire, ses cinq pieds de haut,
sa queue somptueuse, son sabot petit et rond mais au
galop très régulier; tête menue, oreilles étroites
mais grands yeux. Il a pris à droite, je vous dis,
et dépêchez-vous, en tout cas. »
Le cellérier eut un moment d'hésitation, puis
il fit un signe aux siens et se précipita dans le
sentier de droite, tandis que nos mulets se
remettaient à monter. Alors que, piqué de curiosité,
j'allais interroger Guillaume, il me fit signe
d'attendre : et de fait, après quelques brèves
minutes, nous entendîmes des cris de jubilation, et
au tournant du sentier réapparurent moines et
servants qui ramenaient le cheval par le mors. Ils
repassèrent à côté de nous en continuant de nous
regarder d'un air plutôt ahuri, et ils nous
précédèrent sur le chemin de l'abbaye. Je crois que
Guillaume ralentissait le pas de sa monture pour
leur permettre de raconter ce qui était arrivé. De
fait j'avais eu l'occasion de me rendre compte que
mon maître, à tous égards homme de suprême vertu,
s'abandonnait au vice de la vanité quand il
s'agissait de donner la preuve de son acuité
d'esprit et, comme j'en avais déjà apprécié les dons
de subtil diplomate, je compris qu'il voulait
arriver au but précédé d'une solide renommée d'homme
savant.
« Et maintenant, dites-moi (à la fin je ne sus
me retenir), comment avez-vous fait pour savoir ?
- Mon bon Adso, dit le maître. J'ai passé tout notre
voyage à t'apprendre à reconnaître les traces par
lesquelles le monde nous parle comme un grand livre.
[...] Mais l'univers est encore plus loquace : non
seulement il parle des choses dernières (en ce
cas-là, il le fait d'une manière obscure), mais
aussi des choses proches, et alors là d'une façon
lumineuse. J'ai presque honte de te répéter ce que
tu devrais savoir. Au croisement, sur la neige
encore fraîche, se dessinaient avec grande clarté
les empreintes des sabots d'un cheval, qui
pointaient vers le sentier à main gauche. A belle et
égale distance l'un de l'autre, ces signes disaient
que le sabot était petit et rond, et le galop d'une
grande régularité - j'en déduisis ainsi la nature du
cheval et le fait qu'il ne courait pas
désordonnément comme fait un cheval emballé. Là où
les pins formaient comme un appentis naturel, des
branches avaient été fraîchement cassées juste à la
hauteur de cinq pieds. Un des buissons de mûres, là
où l'animal doit avoir tourné pour enfiler le
sentier à sa droite, alors qu'il secouait fièrement
sa belle queue, retenait encore dans ses épines de
longs crins de jais... Enfin tu ne me diras pas que
tu ne sais pas que ce sentier mène au dépôt des
litières, car en grimpant par le tournant inférieur,
nous avons vu la bave des détritus descendre à pic
au pied de la tour méridionale, laissant des
salissures sur la neige; et d'après la situation du
carrefour, le sentier ne pouvait que mener dans
cette direction.
- Oui, dis-je, mais la tête menue, les oreilles
pointues, les grands yeux...
- Je ne sais pas s'il en est pourvu, mais à coup sûr
les moines le croient fermement. [...] Si le cheval
dont j'ai deviné le passage n'avait pas été vraiment
le meilleur de l'écurie, on aurait peine à expliquer
pourquoi ne le poursuivaient pas les seuls
palefreniers, mais que se soit dérangé le cellérier
en personne. Et un moine qui juge un cheval
excellent, au-delà des formes naturelles, ne peut
pas ne pas le voir exactement comme les
auctoritates1 le lui ont décrit,
surtout si (et là il sourit avec malice à mon
endroit) c'est un docte bénédictin...
- Entendu, dis-je, mais pourquoi Brunel ?
- Que l'Esprit Saint te mette un peu plus de plomb
dans la tête, mon fils ! s'exclama le maître. Quel
autre nom lui aurais-tu donné si le grand Buridan en
personne, qui est en passe de devenir recteur à
Paris, devant parler d'un beau cheval, ne trouva nom
plus naturel ?»
Tel était mon maître. Non seulement il savait
lire dans le grand livre de la nature, mais aussi de
la façon que les moines lisaient les livres de
l'Écriture, et pensaient à travers ceux-ci. Dons
qui, comme nous verrons, devaient s'avérer pour lui
fort utiles dans les jours qui suivraient. En outre
son explication me sembla à ce point-là si évidente
que l'humiliation de ne l'avoir pas trouvée tout
seul céda le pas à l'orgueil d'être dans le coup et
il s'en fallait de peu que je ne me félicitasse
moi-même pour ma finesse d'esprit. Telle est la
force du vrai qui, comme le bien, se diffuse de
soi-même. Et soit loué le nom saint de Notre
Seigneur Jésus-Christ pour cette belle révélation
que j'eus.
1. les autorités
religieuses.
|
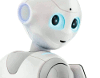
|
Si le détective est un mythe à la gloire de la
raison humaine, le robot, androïde capable
d'exécuter des travaux à la place de l'homme,
pourrait bien, lui, être né de la méfiance
qu'inspirent des conquêtes technologiques de
plus en plus sophistiquées. Ce
mythe de défaite marque très tôt l'histoire de
l'humanité : n'est-ce pas déjà l'histoire de Pygmalion,
racontée par Ovide dans ses Métamorphoses
? Ou bien celle de ces esclaves
d'or forgés par Héphaïstos,
que rapporte Hésiode dans Les Travaux et
les Jours ? Ou encore celle de
l'Apprenti sorcier dans le poème de Goethe
(1797), celle du Golem pragois dont beaucoup
de textes nous entretiennent avant Gustav
Meyrink ? En tout cas, s'il préexiste à l'ère
du machinisme pendant laquelle le tchèque
Karel Čapek invente le mot à partir du
substantif robota (corvée),
ce mythe connaît une fortune littéraire et
surtout cinématographique au moment où la
machine gagne une relative autonomie.
L'intelligence artificielle (dont le corpus est gigantesque) gouvernant le
travail des hommes finit par inspirer la peur
de l'asservissement et du totalitarisme le
plus aveugle. Ce fantasme est bien
caractéristique du pouvoir que détient le
mythe de condenser nos terreurs et de nous les
renvoyer dans l'espoir de quelque catharsis.
|
|

Hermann Mac Coolish
Rotenberg Caistria : L’homme épingle
(1809)
Ernest Théodore Amadeus Hoffmann : L'Homme
au sable (1817)
(1817)
Mary Shelley : Frankenstein
ou Le Prométhée moderne (1818)
(1818)
Edward S. Ellis : Steam Man of the Prairies
(1865)
Luis Senarens : L’Homme électrique
(1885)
Filippo Tommaso Marinetti : Poupées
électriques (Elettricita) (1909)
(Elettricita) (1909)
George Bernard Shaw : Pygmalion (1913)
(1913)
Gustav Meyrink :Le
Golem (1915)
(1915)
Karel Čapek : Rossum's
Universal Robots (1920)
(1920)
Isaac Asimov : Les
Robots (1950).
(1950).
Les
Cavernes d'acier (1954)
(1954)
Philip K. Dick : Les
androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (1966)
Arthur C. Clarke : 2001
: L'Odyssée de l'espace (1968)
(1968)
Brian W. Aldiss : Des
jouets pour l'été (A.I.) (1969)
(A.I.) (1969)
Stanislaw Lem : Golem
XIV (1981)
(1981)
Neil Stephenson : The
Diamond Age (1995)
(1995)
Paul Anderson : Nanodreams (1995). |

|
L'ogre est un personnage traditionnel des
légendes universelles. Géant anthropophage,
particulièrement friand de la chair des enfants,
il puise ses racines, comme le loup, au plus
profond des peurs ataviques. Déjà présent dans
l'Antiquité (son nom serait dérivé du latin Orcus,
l'Enfer, et le dieu grec Cronos en fournit un
effrayant archétype paternel), il peuple dans
nombre de cultures les traditions carnavalesques
et gigantales. En Europe, la forme qu'on lui
connaît se précise dans les contes merveilleux.
Doté d'une puissance surhumaine, il ne brille
pas toutefois par son esprit. Il est en effet
facilement berné : déjà Cronos engloutit une
pierre qu'il pense être son dernier-né, et l'on
connaît la manière avec laquelle, dans le conte
de Perrault, le petit Poucet réussit à triompher
de lui. Cette balourdise finit d'ailleurs par
rendre le personnage presque sympathique et le
cinéma ne s'est pas privé de décliner cet aspect
sous diverses formes. Nous ne retiendrons pas
dans la bibliographie ci-dessous les œuvres –
très nombreuses – appartenant à la littérature
de jeunesse (on pourra à ce propos utilement
consulter cette
page). Nous préférons recenser les textes
où le personnage de l'ogre se construit en marge
de ses motifs traditionnels, éprouvant par là la
richesse du mythe.
|
|

Charles Perrault
: Histoires
ou contes du temps passé
(1697)
Mme d'Aulnoy : Les
Contes de fées (1698)
Jacob
et Wilhelm Grimm : Contes
(1857)
Victor
Hugo :
Bon conseil aux amants (Toute La Lyre,
1888)
Michel
Tournier : Le
Roi des Aulnes (1970)
(1970)
La fugue du petit Poucet (Le Coq de
bruyère, 1978)
Jacques Chessex : L'Ogre
(1973)
Daniel Pennac : Au
bonheur des ogres (1985)
Claude-Louis Combet : La Maison des
marmousets
in Augias
et autres infamies (1993)
Pascal Bruckner : Les
Ogres anonymes (1998)
Pierre Péju : Le
rire de l'ogre (2005)
Leila Slimani : Dans
le jardin de l'ogre (2018).
|
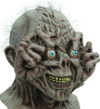
|
Les mythes, les contes sont traditionnellement
habités par toutes sortes de créatures
fabuleuses plus ou moins épouvantables (Cerbère,
Cyclope, Méduse, Géants...). Mais,
à côté du « merveilleux » des contes de fées ou des épopées, genres où
ces êtres évoluent parmi les hommes sans nulle
rupture, naturellement insérés dans un mode
cohérent, il appartenait à la littérature de
créer le fantastique
: ici, la rupture soudaine dans la cohérence
de cet univers est responsable de la vraie
peur, celle que l'on ressent devant
l'inexplicable. Le monstre (étymologiquement :
ce qui avertit) fait en effet
irruption dans un univers "normal" et sème le
doute sur la validité de nos représentations.
Ces créatures (vampires, loups-garous,
fantômes, extra-terrestres...) semblent sortir
tout droit de nos cauchemars, où gisent des
peurs ataviques.
Mais le plus redoutable de ces
monstres, c'est notre moi profond, cette part
d'ombre prête à s'éveiller en dépit de tous
nos efforts de rationalité. Freud parle à son
propos d'«inquiétante étrangeté» (« Das
Unheimliche ). Les œuvres littéraires
les plus marquantes (nous n'en citons que
quelques-unes : le corpus est énorme) se
déploient précisément au moment où les
sociétés sanglées dans leur rationalité et
leurs codes moraux (par exemple, l'Angleterre
victorienne) manifestent le plus d'arrogance,
comme s'il s'agissait de les rappeler à la
modestie.
|
|

Mary Shelley : Frankenstein
ou Le Prométhée moderne (1818)
(1818)
Victor Hugo : Notre-Dame
de Paris (1831)
(1831)
L'Homme
qui rit (1869)
(1869)
Théophile Gautier, La
Morte amoureuse (1836)
(1836)
Robert-Louis Stevenson : L'étrange
cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde (1886)
(1886)
Guy de Maupassant : Le
Horla (1886)
(1886)
Émile Zola : La
Bête humaine (1890)
(1890)
Oscar Wilde : Le
Portrait de Dorian Gray (1890)
(1890)
Herbert George Wells : L'Île
du docteur Moreau (1896)
(1896)
Bram Stoker : Dracula (1897)
(1897)
Franz Kafka : La
Métamorphose (1912)
(1912)
Howard-Philips Lovecraft : Je
suis d'ailleurs (1926)
(1926)
Dagon (1927)
(1927)
Mircea Eliade : Mademoiselle
Christina (1936)
(1936)
Jean Giono : Un
Roi sans divertissement (1947)
(1947)
Richard Matheson : Le
Journal d'un monstre (1950)
(1950)
Je
suis une légende (1955)
(1955)
Claude Klotz : Paris-vampire
(Dracula père et fils) (1970)
(1970)
Anne Rice : Entretiens
avec un vampire (1976).
(1976). |
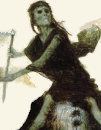

Cet archétype où se mêlent le Sexe et la Mort
est tapi dans toutes les mythologies. Pandore,
Lilith, Eve et tant d'autres incarnent la
terreur masculine de la femelle castratrice et
alimentent en l'homme une bonne part de sa
misogynie. C’est sur ce fond que se détache la
figure de la femme fatale, personnage central de
sombres récits dans lesquels l’homme succombe
aux sortilèges d’une séductrice. Dans le cadre
littéraire, c'est au détour du XIXème siècle que
le mythe a pris corps, avant de s'épanouir au
cinéma, favorisant une interrogation d'ordre
psychanalytique et social sur la « nature » de
la femme. En effet, si celle-ci incarne le
destin, c'est par la force brutale de sa
sexualité, dont l'homme éprouve alors, dans des
récits à la première personne, le mystère
dévastateur.
La « vamp » des polars noirs américains
reste pour cela la cible des ligues féministes
qui voudraient bien voir disparaître ce qu'elles
considèrent comme un pur produit du machisme.
C'est ignorer combien reste et restera prégnant
dans toutes les cultures ce motif fondamental.
Les luttes sociales n'ont pas souvent ce pouvoir
d'évacuer du psychisme humain ces archétypes
dont Gilbert Durand disait : « Les rationalismes
et les démarches pragmatiques des sciences ne se
débarrassent jamais complètement du halo
imaginaire et tout rationalisme, tout système de
raisons porte en lui ses fantasmes propres.» (Les
Structures anthropologiques de l’Imaginaire :
introduction à l’archétypologie générale).
L'importance du corpus, notamment dans le
cadre du roman policier, exclut évidemment que
l'on soit exhaustif. On trouvera ci-contre une
sélection d'ouvrages majeurs sur le sujet, mais
on n'en ignore ni la limite ni la subjectivité.
|
|

Antoine François Prévost : Manon
Lescaut (1731)
(1731)
Eugène Sue : Cécile
ou une femme heureuse (1835)
(1835)
Heinrich Heine, Atta
Troll, rêve d'une nuit d'été (1846)
(1846)
Prosper Mérimée : Carmen (1847)
(1847)
Charles Baudelaire : La
Fanfarlo (1869)
(1869)
Leopold de Sacher-Masoch : La
Vénus à la fourrure (1870)
(1870)
Gustave Flaubert : Trois
contes, Hérodias (1877)
(1877)
Pierre Loti : Aziyadé (1879)
(1879)
Emile Zola : Nana (1880)
(1880)
Auguste de Villiers de l’Isle-Adam : L'Ève
future (1886)
(1886)
Stéphane Mallarmé : Hérodiade (1887)
(1887)
Guy de Maupassant : Allouma (1889)
(1889)
Oscar Wilde : Salomé (1891)
(1891)
Pierre Louÿs : La
Femme et le pantin (1898)
(1898)
Heinrich Mann : Professeur
Unrat (L'Ange bleu) (1905)
(1905)
Pierre Benoit : L'Atlantide (1919)
Pierre-Jean Jouve : Aventure
de Catherine Crachat (1928)
(1928)
James Hadley Chase : Eva
(1945)
William Irish : La
sirène du Mississipi (1947)
(1947)
David Goodis : Cassidy's
girl (1951)
(1951)
Paul Morand : Hécate
et ses chiens (1954)
(1954)
Gil Brewer : Satan
est une femme (1954)
Jason Manor : Ouvrage
de dame (1955)
Erskine Caldwell : Amour
et argent (1956)
Charles Williams : L'Ange
du foyer (1965)
Paul Auster : Fausse
balle (1982)
Joyce Carol Oates : Fleur
Vénéneuse (1997)
Pascal Quignard : Vie
secrète
(1998)
Alina Reyes : Lilith (1999). |
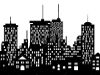
L’urbanisation
grandissante génère à partir du XVIIIème siècle un regard
nouveau sur la ville : la cité prend une ampleur de plus
en plus démesurée où les humains finissent par perdre leur
individualité. Cette fourmilière devient labyrinthique :
des destins se croisent, des rencontres s’opèrent, selon
les lois douteuses du hasard ou les caprices de quelque
obscure volonté. Le Paris
des surréalistes fournit un excellent exemple de cette
mythification, dont Balzac et Nerval avaient déjà fixé les
contours. La ville y apparaît comme une entité fantastique
où les humains, perdus dans une forêt de signes, ne sont
plus que des unités indistinctes. Comment l’écriture
romanesque ou les formes lyriques contemporaines
donnent-elles vie à la Ville ? Quelles visions de la
modernité communiquent-elles ? Quelle place occupe
l’individu dans ce monde aux dimensions colossales,
souvent énigmatique et réifié ? Telles sont les questions
qui gisent au cœur du roman et de la poésie modernes. Nous
réduisons l'énormité du corpus à la littérature
francophone.
|

|
G. APOLLINAIRE : Alcools : « La Chanson du Mal-Aimé ». « Zone ».
: « La Chanson du Mal-Aimé ». « Zone ».
Calligrammes : « Les Fenêtres ».
: « Les Fenêtres ».
L. ARAGON : Le
Paysan de Paris
Le
Roman inachevé : « Rappelez-vous ce que de Londres... »
: « Rappelez-vous ce que de Londres... »
«
Il ne m'est Paris que d'Elsa. »
H. DE BALZAC : Scènes
de la vie parisienne
Ch. BAUDELAIRE : Les
Fleurs du Mal « Rêve parisien »« A une passante », « Les
Fenêtres »
« Rêve parisien »« A une passante », « Les
Fenêtres »
« Paysage »,
Petits
poèmes en prose « Les Sept
Vieillards », « Les Foules », « Les Petites
vieilles »
A. BERTRAND : Gaspard
de la nuit « Harlem »
« Harlem »
A. BRETON : Clair
de terre « Tournesol »
« Tournesol »
Nadja
L'Amour
fou
M. BUTOR : L'Emploi
du temps
B. CENDRARS : Dix-neuf
poèmes élastiques « Contrastes », « Les Pâques à New-York »
« Contrastes », « Les Pâques à New-York »
Documentaires .
.
F. COPPÉE : Intimités « Je suis un pâle enfant du vieux Paris... »
« Je suis un pâle enfant du vieux Paris... »
Ch. CROS : Le
Coffret de santal « Plainte ».
« Plainte ».
R. DESNOS : Corps
et biens « Vie d'ébène » « Couplet de la rue de
Bagnolet »
« Vie d'ébène » « Couplet de la rue de
Bagnolet »
M. DIB : Ombre
gardienne « Port »
« Port »
L. DIETRICH : L'Apprentissage
de la ville
J. DU BELLAY : Les
Antiquités de Rome « Nouveau venu qui cherches... »
« Nouveau venu qui cherches... »
L.-P. FARGUE : Le
Piéton de Paris
M. FOMBEURE : Greniers
des saisons « Solitude »
« Solitude »
J. GRACQ : La
Forme d'une ville
A. HARDELLET : La
Cité Montgol « La Ronde de nuit »
« La Ronde de nuit »
V. HUGO : Les
Orientales « Rêverie »
« Rêverie »
Notre-Dame
de Paris
Les
Misérables
Ph. JACCOTTET : L'Effraie « Les Nouvelles du soir ».
« Les Nouvelles du soir ».
LAUTRÉAMONT, Les
Chants de Maldoror (les voyageurs de l'omnibus, la rue
Vivienne)
(les voyageurs de l'omnibus, la rue
Vivienne)
P. MODIANO : Quartier
perdu
G. de NERVAL : Les
Nuits d'Octobre
C. NOUGARO : Chansons « Ô Toulouse », « Paris mai ».
« Ô Toulouse », « Paris mai ».
R. QUENEAU : Courir
les rues... « Grand Standings », « Mon beau Paris »
« Grand Standings », « Mon beau Paris »
G. PEREC : Tentative
d'épuisement d'un lieu parisien
J. PREVERT : Paroles « Chanson de la Seine »
« Chanson de la Seine »
Histoires « Enfants de la haute ville »
« Enfants de la haute ville »
Choses
et autres « La Seine a rencontré Paris »
« La Seine a rencontré Paris »
J. REDA : Les
Ruines de Paris
N. RESTIF DE LA BRETONNE : Les
Nuits de Paris
P. REVERDY : La
Lucarne ovale « D'un autre ciel ».
A. RIMBAUD : Illuminations « Villes », « Les Ponts ».
« Villes », « Les Ponts ».
G. RODENBACH : Bruges-la-Morte « Ô ville, toi ma sœur à qui je suis
pareil... »
« Ô ville, toi ma sœur à qui je suis
pareil... »
« La ville est morte, morte,
irréparablement... »
J. ROMAINS : La
Vie unanime
J. ROUBAUD :
La forme d'une ville change plus vite,
hélas, que le cœur des humains
C. ROY : Complainte
du réseau métropolitain
SAINT-JOHN PERSE : Éloges
/ Images à Crusoé « La Ville »
« La Ville »
L.S. SENGHOR : Éthiopiques « New-York »
« New-York »
E. SUE : Les
Mystères de Paris
J. SUPERVIELLE : Débarcadères « Marseille ».
« Marseille ».
E. VERHAEREN : Les
Villes tentaculaires « La Ville »
« La Ville »
Les
Campagnes hallucinées
P. VERLAINE : La
Bonne chanson « Le Bruit des cabarets »
« Le Bruit des cabarets »
Sagesse : « Le ciel est par-dessus le toit »
: « Le ciel est par-dessus le toit »
B. VIAN : Chansons
« La rue Watt », « Les villes ten-ten, les villes
ta-ta, les villes cu-cu » »
A. de VIGNY : Poèmes
antiques et modernes : « Paris »
: « Paris »
E. ZOLA : Les
Rougon-Macquart
Les
Trois Villes.
|
|
 LIENS
LIENS
|
 
|